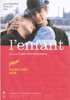
L’enfant - Luc et Jean-Pierre Dardenne.Western antique au cur du réel.
L’enfant du fils de Rosetta aura-t-il tenu promesse ? Bingo si l’on en juge le jeune couple formé par Sonia et Bruno dans un réel en friche, un univers de non-lieux que les adultes semblent avoir fui pour de bon. Maîtrise formelle, épure de la mise en scène et radicalité du propos font de L’enfant un chef d’uvre antique plaçant une nouvelle fois au centre la question de la faute, de sa reconnaissance, de son affranchissement. Sauf que l’acte témoigne ici comme d’un malaise dans la civilisation. Comment vendre son enfant ? Au-delà du refus de filiation, les Dardenne signent un film bouleversant, implacable et lumineux. Sous forme de conte initiatique moderne, une invitation pour survivre à l’adulescence et faire l’expérience de sa dépendance symbolique à l’autre.Dès les premières secondes, l’univers des Dardenne est planté. Sonia, son bébé dans les bras, cogne contre une porte et réclame qu’on lui ouvre. C’est la porte de chez elle, mais elle n’entrera pas. Quelques minutes plus tard, elle se baisse jusqu’au sol et ramasse ce qu’on vient de lui balancer par terre - un chargeur de portable.
Une ouverture brillante puisqu’elle tient tout le film. Déjà l’absence du père, la parole coupée, la séparation des corps. Seule dans sa cage d’escalier, exclue de chez elle, Sonia vit sur le mode macro l’exclusion à l’uvre dans l’intime et le social, point de départ des Dardenne.
De départ uniquement. Car l’étiquette sociale sera vite balayée par la force du regard et de la mise en scène. Un cadre qui, du Fils à L’enfant, marque l’apparition du couple dans le cinéma des Dardenne. Et donc une ouverture à la vie, aux couleurs, s’ouvrant en plus des personnages enfermés sur eux-mêmes, à des corps qui se cherchent, se cognent, se trahissent et se perdent, avant de lentement renaître.
« Ouvre, mais ouvre ! », tels sont les premiers mots de Sonia qui résonnent dans la cage d’escalier. L’histoire d’une ouverture à l’autre, de sa reconnaissance. Comment Bruno, père absent dès l’ouverture du film, peut-il redevenir, après avoir commis l’inconcevable, ce qu’il était supposé être de fait, à savoir adulte et père ?
Petite hyperbole du capitalisme.
Bruno a loué l’appartement pendant que Sonia accouchait à l’hôpital. On le croise une première fois au milieu d’une rue, en train de mendier entre des voitures. Il surveille en même temps un café, l’oreille vissée à son portable. Bruno est enfermé dans l’instant, sa vie, son business. Son fils ne fait pas partie de sa vie. Il ne le regarde pas, ne le tient pas dans ses bras, ne l’embrasse pas. Ce fils n’existe pas, c’est un objet.
Bruno se revendique dans la marge mais participe au centre. Exclu volontaire du système, il en reproduit le principe fondateur. Tout se vend, tout s’achète, le marché s’autorégulant selon l’offre et la demande.
La machine est lancée. Petit voleur, artisan de débrouille calé en permanence sur l’urgence, épaulé par des enfants pour ses trafics, Bruno incarne tous les fondamentaux du capitalisme moderne. Flexibilité, rendement à outrance, absence de régulation par la loi, déni physiologique du corps, primauté accordée à la reproduction mécanique du même, assimilation du corps à l’espace qui l’entoure, avec au centre du système un seul but, le profit.
Il y a l’art et la manière. Le génie des Dardenne passe d’abord par le radicalisme du propos, mais surtout, par la façon toute progressive, presque naturelle, sans heurt et sans violence, de parvenir à l’inconcevable : un père vend son enfant à l’insu de sa mère. Ils représentent ainsi le paradoxe d’une logique (celle du capitalisme) poussée jusqu’à son terme par un personnage aussi cupide et naïf qu’opportuniste.
Bruno, l’innocence ou la cupidité. Au delà du bien et du mal.
L’innocence est au cur de L’enfant. On s’aperçoit très vite que le titre se dédouble sous les traits du père et du fils. Bruno ne se rend pas compte. Comment être responsable quand cette notion même de responsabilité lui est étrangère ? « Je pensais qu’on en referait un autre, c’est tout ».
S’il utilise des enfants dans sa bande, c’est d’abord qu’il partage leur univers. Il en garde le rire, la légèreté, la naïveté surtout. Piétiner une flaque de boue pour sauter sur un mur, jouer au Jedi dans l’eau avec une barre de fer, rire de l’odeur d’un pet.
Une naïveté inséparable d’un certain archaïsme qu’on retrouvera plus loin. Pour réparer un arceau du landau, il tape avec un caillou sur un fil de fer pour le tordre. Il jette sa tige de fer comme un javelot dans l’eau. Il s’exécute à l’instinct, sans aucun espèce de distance avec la réalité. Et l’on s’aperçoit avec frayeur que semblent naître en lui, du même lieu, l’élan amoureux comme l’élan du profit.
Fluidité tendue, mise en scène à l’épure.
Lorsqu’à la demande répétée de Sonia, Bruno consent à reconnaître l’enfant, c’est donc hors de tout ordre symbolique. L’acte en soi ne revêt alors aucune espèce d’importance, si ce n’est peu après dans la rue lorsqu’il réalise sa valeur financière : il est plus lucratif de faire la manche avec un landau plutôt que sans ! Ainsi, presque naturellement, sans hésiter, il se décide à vendre l’enfant. Au delà du bien et du mal, sans qu’à aucun moment ne se pose pour lui la question de sa responsabilité morale.
Où l’on s’aperçoit, par leur mise en scène, de cette fluidité tendue qui domine la réalisation des Dardenne. Dans une pièce nue, éclairée par les seuls rideaux orangées qui reçoivent la lumière du soleil, Bruno dépose son enfant par terre, sur son blouson. Avant de changer de pièce pour attendre l’argent en échange.
L’argent en échange. Un monde exclusivement matériel que les Dardenne illustrent par une mise en scène de non-lieux. Tout se joue entre cages d’escaliers, couloirs, halls d’immeubles, garages, refuge sous un pont, appartement vide, longues traversées urbaines, etc. Des lieux sans vie propre, que l’on traverse sans habiter, des lieux tous caractérisés par le passage et l’absence du côté visuel, par le bruit, les stridences en ce qui concerne les sons.
Horizontalité de l’espace et non-lieu.
Dfficile avec les Dardenne de ne pas parler généalogie, progression, trajectoire. D’abord parce que le mouvement, celui de la vie, se trouve à l’origine de leur projet de cinéma. Filmer la vie au plus près du réel, des personnages, de leur réalité physique, mais également observer les mouvements de la marge jusqu’au centre, d’un monde régit par l’horizontalité.
Le vertical, la religiosité, l’ascension sont bien absents de leur univers. Oublier la transcendance pour venir bas sur le sol, vers les femmes et les hommes. C’est bien d’ici en effet d’où l’on part : écrites en transparence à l’envers sur le plastique de la cabine téléphonique d’où Sonia appelle Bruno pour la première fois, trois lettres : BAS. La bonne prise au réel.
Exit la verticalité, donc. Lorsque Bruno doit monter dans l’appartement vide de l’immeuble pour déposer l’enfant, l’ascenseur ne marche pas. C’est donc à l’escalier, par le mouvement, que Bruno tient sa vie. Impossible de penser pour celui qui réagit dans l’urgence, l’impulsion, le mouvement de l’instant. « Je préfère tout de suite » indique-t-il aux acheteurs par téléphone. Quelque soit le lieu - l’appartement, le refuge, l’hôpital, le foyer, Bruno doit déplacer son corps, imprimer un mouvement, comme sur le mur sur lequel il laisse l’empreinte de son pied.
Etre immobile c’est être mort. Ce présupposé, s’il définit le personnage, tisse également la structure du film. Car s’il bouge physiquement en permanence, Bruno tient sa tête immobile. Un contraste rendu par l’oscillation entre le mouvement et l’arrêt, toujours à l’uvre dans la répétition. Un film du mouvement des corps, des véhicules, où chaque pose, chaque arrêt, marque donc par contraste un moment important dans l’évolution du personnage.
Faire surgir l’immobile dans l’urgence.
Face à sa réalité physique du mouvement, l’arrêt chez Bruno est d’ordre mental, psychique. Un personnage coincé dans l’enfance, raison pour laquelle justement il n’est pas disposé à accepter la venue de Jimmy, l’autre enfant, le vrai, l’intrus.
A plusieurs reprises dans le film, il se retrouve seul face à la porte close de Sonia. Une répétition comme signal de quelque chose qui ne passe pas, une porte close renvoyant à l’impasse. Bruno se débat dans la débrouille mais il reste seul, l’autre n’a toujours pas de place dans sa vie. De l’autre côté de la porte, il ne parle d’ailleurs pas à Sonia mais, pointe ironique, lui demande une carte téléphonique, de l’argent, de la nourriture. Un lien de dépendance physique inactivé sur le plan symbolique ; ce n’est qu’en dernier qu’il finit par demander pardon.
Cette réalité psychique de l’arrêt intervient également dans les deux scènes jumelles de l’échange. Qu’il vende ou récupère l’enfant, Bruno se retrouve dans les deux cas confronté à l’arrêt. Alors qu’il semble hésiter, le spectateur se demande s’il va stopper à temps, comprendre enfin la portée de son geste.
Or cette bascule vers la responsabilité n’aura lieu qu’avec les deux derniers moments d’arrêt du film. Lorsque d’abord, dans une époustouflante séquence, il s’immerge dans le fleuve avec Steve pour échapper à leurs poursuivants, puis lorsqu’il se couche d’épuisement au refuge sous un linceul en carton. Ces mouvements de descente jusqu’au dernier cran, l’un physique et l’autre social, constituent donc les deux passages par dessous, les deux morts symboliques nécessaires à sa prise de conscience.
Caméra-peau, mouvement-pose.
Au niveau de la mise en scène, cette collusion de la caméra-corps au mouvement participe depuis La promesse à cette manière Dardenne de faire du cinéma, brusque et intense. Si dans L’Enfant la caméra-peau suit toujours ses personnages au plus près, on remarque désormais davantage de plans d’ensemble qui viennent ouvrir le regard, le décoller de la caméra subjective.
Un cadre à l’unisson du personnage, lui aussi momentanément en arrêt, qui transfère simplement le mouvement de l’extérieur vers l’intérieur. Non pas à la place mais en plus d’une caméra suivant à la trace un être ceinturé dans sa vie (Le fils), l’objectif peut donc désormais se fixer pour saisir plusieurs personnages de plein pied, leurs mouvement, leur façon d’être à la vie. Comme si les frères Dardenne apprenaient eux aussi à n’être plus uniquement dans l’urgence, mais aussi dans le plaisir.
Cette alternance mouvement/pause dans la mise en scène fonctionne à merveille lors de la poursuite entre Bruno et Sonia entre les tables de pique-nique, une des scènes les plus merveilleuses du film. Elle marque également une première : les Dardenne filment l’amour, ou plutôt l’état amoureux. A leur manière bien sûr. Pas de lit ni de draps, mais une aire d’autoroute. Des amants qui se coursent par la peau, s’attrapent, se font tomber, s’embrassent entre morsures, zigzags et cris d’ados. Un amour vif, nerveux, vivant comme le cinéma dans lequel il s’inscrit.
Filmer l’amour en couleurs : de l’idylle au drame shakespearien.
C’est donc un cinéma de la vie, qui vient soulever tout le fond noir du décor. Ainsi en va-t-il du traitement de la couleur. Face au gris qui ceinture l’espace immobile des décors industriels, les personnages non seulement sont en mouvement, mais en couleurs.
Le vert et le rouge pénètrent ainsi tout le film et semblent presque, malgré le déni des premiers concernés (Cf interview), se distribuer dans l’intrigue de manière signifiante. A Bruno le vert des jeunes pousses, de la vie dans un sac, brusque et changeante qu’il plie comme il l’entend, contre le rouge de Sonia, égérie amoureuse et sexy qui porte pourtant déjà sur elle la couleur du drame à venir, sa réaction violente, archaïque, sans l’once d’une médiation.
Qu’on ouvre l’il et cette distribution du vert est manifeste dans toute la première partie du film. Les pelouses du gazon, la cuisine de l’appartement, le t-shirt de Bruno, tout concourt à l’harmonie, la vie possible ensemble. Mais à partir de l’échange, un principe d’inversion vient retourner l’intrigue pour une bascule de la romance au drame.
Cette bascule s’opère également au niveau des couleurs. Sonia disparaît du cadre au propre comme au figuré par l’évanouissement. Quant à Bruno, expulsé de son univers naïf, adolescent peint en vert, il change de vêtements pour se parer de rouge.
Le son, la lumière en jumeaux.
L’important n’est pas l’acte en soi mais la manière dont il nous transforme. Bruno récupère l’enfant aussi vite qu’il l’avait vendu, or il ne se passe rien. Il ne prend pas la mesure, il n’est pas transformé. Durant toute la seconde partie du film, il s’enfonce en lui même jusqu’à l’impasse finale rendant possible sa prise de conscience.
Tout était pourtant présent dans la scène du rachat de l’enfant, avec une mise en scène épurée un cran au dessus face à la scène jumelle de la vente. On passe ainsi de la lumière orange tamisée de la fenêtre à l’obscurité presque totale du garage, de la porte vitrée entrouverte à la tôle en fer rabattue jusqu’au sol.
Ce passage de la chambre au garage, de l’étage au sous-sol est décuplé par le travail du son. Bruno est non seulement contraint de s’arrêter, physiquement, mais il est surtout soumis à une réalité, à un ordre des choses qu’il ne maîtrise pas.
Ces deux scènes jumelles sont également les seules où il est contraint d’écouter ce qui se passe à l’extérieur, c’est à dire d’être à l’écoute, de sortir hors de lui-même. Scène capitale puisqu’elle annonce sa future prise de conscience, c’est aussi un intense moment de cinéma. L’expérience d’un pur suspens, d’un temps suspendu, où le regard s’efface pour laisser place aux sons, et faire entrer ce hors-champ à l’intérieur du cadre.
Western humain pour drame antique.
Pourquoi parler western ou drame antique, ce qui revient au même ? D’abord par l’absence de médiation. Les personnages, plongés en plein cur de l’action, réagissent dans l’urgence avec passion, de manière instinctive. La réussite des acteurs, à travers la direction behavioriste des Dardenne, tient à la mise en adéquation de leur corps avec les sentiments exacerbés. Trouver la distance juste, "le vivant" comme dit Jean-Pierre Dardenne, ce quelque chose de brut, de non-feint si présent dans la texture de leurs films.
De l’archaïsme déjà évoqué, toute une palette de sentiments dont l’origine se trouve dans les grands drames antiques (amour, haine, trahison, abandon, renaissance), s’incarne par touches successives et en désordre dans le jeu magnifique de Jérémie Renier et Déborah François. Un seul échappe à la cosmogonie Dardenne, celui de la vengeance.
On retrouve aussi du drame antique cette propension des personnages à aller jusqu’au bout, à transgresser les frontières. Sonia, dans sa haine de mère trahie, aurait sans hésiter pu tuer Bruno comme celui-ci vend leur fils.
Mais le drame antiqsue se dispute parfois la palme au western. Bruno le hors-la-loi jouit durant presque tout le film d’une impunité, d’une liberté surtout quasi totale. Cette liberté permet bien sûr de l’identifier à la figure du héros rebelle : un homme libre dans son désir puisque sans entraves, qui dépense comme bon lui semble son temps et son argent.
La chevauchée réaliste.
Un cabriolet, un sandwich et un blouson de cuir. Il suffit d’une virée sur autoroute, mêlant grand amour et liberté, pour ancrer Bruno de manière positive chez le spectateur, avant que la scène de l’échange n’amène ambivalence et rejet. Un salaud qu’on ne peut s’empêcher d’aimer. Clint Eastwood, ça ne vous dit rien ?
Avec la figure imposée de la poursuite, les frères Dardenne filment un véritable western contemporain. Exit les paysages de La chevauchée fantastique broyés dans un reste de friches industrielles, il ne reste que les corps, le mouvement des montures, et surtout les sons, ultime hommage au passé sidérurgiste.
Scooters, voitures, allées et venues le long des rives et de la route près du fleuve ne cessent de manifester tout au long de cette séquence l’immense plaisir qu’ont les cinéastes de filmer Jérémie Renier neuf ans après son rôle d’Igor dans La promesse.
La toute puissance de l’enfant.
L’intelligence narrative des Dardenne consiste à reporter tout au long du film la prise de conscience de Bruno. Un effet delay jouant d’ailleurs à plusieurs niveaux. Le rachat de l’enfant préfigure le sien propre, en même temps qu’il affirme la rapport d’égalité entre les deux.
Bruno est un enfant menant une vie d’adulte autour d’autres enfants, mais il ne vit au fond sa liberté qu’au dépend de celle des autres. Sans projet sinon dans celui de l’assouvissement de ses désirs, Bruno semble en réalité prisonnier de lui-même, coincé dans l’enfance et son fantasme d’une liberté totale, d’une toute puissance dont il refuse de faire le deuil.
Cet attachement au même, au fusionnel, à l’indivision se retrouve par exemple dans l’achat des deux blousons identiques. Or l’il ouvert on note sur la manche en dessous d’un drapeau anglais les initiales PWR (power) cousues sur un écussons. Parfait hasard ? Comme il fait bien les choses !
Le salut par la perte.
Après avoir bradé le blouson de Sonia pour un euro symbolique, il se sépare du sien pour endosser un gilet rouge. Or tien, hasard encore, c’est bien à cet instant précis qu’il ouvre sa descente, sa perte de pouvoir rendue manifeste par ses moyens de locomotions. Il passe ainsi du cabriolet au scooter, puis à la course, avant de finir immobile dans l’eau froide sous une passerelle éventrée.
Signe manifeste et littéral de cette perte de puissance, le scooter accidenté qu’il ramènera à pied, non comme on porte une croix mais simplement un corps mort, et que Bruno prendra soin, bien qu’il ne vaille plus rien, de ramener à son propriétaire.
Ces multiples passages de la vente de l’enfant à son rachat, du vol à la restitution, de l’abandon des quais à la confrontation du poste de police, préparent donc le climax de la reconnaissance de la faute. Laquelle se dédouble à nouveau entre la reconnaissance verbale, sobrement articulée au commissariat (« C’est moi »), et la reconnaissance émotive, physique, qui aura lieu dans la prison. Et c’est seulement après que Bruno pourra prendre conscience d’une limite, accepter d’être Un parmi les autres, avec la perte et l’incomplétude fondamentale qui en découlent.
Un western belge et flamboyant parce qu’il reste avant tout humain. Le très beau plan du duel final sous forme de confrontation entre Jérémie Renier et Déborah François n’a lieu que parce que le hors-la-loi s’est résolu de lui même à purger son rachat. On retrouve chez les Dardenne cette volonté de mettre au premier plan le libre arbitre pour signifier l’espoir et réaffirmer leur croyance en l’humain.
Ecce Homo.
En refusant de faire mourir leur personnage pour condamner la société à laquelle il appartient, les Dardenne prennent donc le contre-pied inverse de Vincenzo Marra dans Vento di Terra. La transformation de Bruno demeure l’aboutissement d’un parcours, d’une initiation contemporaine en ce qu’elle s’effectue sans l’intervention des adultes, puisque les pères, morts ou absents, incarnent la défaillance.
Définissant à travers leur personnage l’adultescence contemporaine d’une société qui refuse toute notion de perte, de privation, de limite, les Dardenne ouvrent à travers L’enfant une réflexion des plus passionnantes sur notre monde d’aujourd’hui.
Avec ce western antique au cur même du réel, ce silex à l’épure tranchante, les Dardenne continuent l’air de rien à creuser leur sillon. En plaçant non seulement le couple mais le refus de filiation au centre de leur film, c’est un regard lucide en même tant qu’implacable qu’ils posent sur l’époque, contrebalancé par une force de vie et d’espoir d’autant plus magnifique. Quant à l’ultime scène des grandes eaux, on dirait presque pour les cinéastes une clôture en forme de défi. Bientôt, c’est sûr, leurs personnages pourront parler.
Stéphane MasVoir aussi, sur peauneuve.net : Du réel au vivant, en route vers la parole - une interview de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Articles récents
Goya, les peintures noires - Yves Bonnefoy
I don’t want to sleep alone - Tsai Ming-liang
Les climats (Iklimler) - Nuri Bilge Ceylan
En avant, Jeunesse ! Juventude em marcha - Pedro Costa
Babel - Alejandro Gonzales Inarritu
The Host, conte écologique sur la paternité
Saimir - Francesco Munzi
© 2005 peauneuve.net - archives - liens - - haut de page


