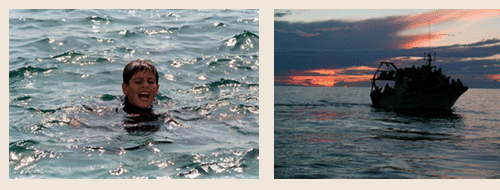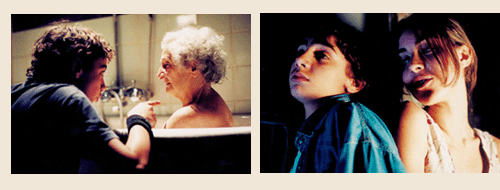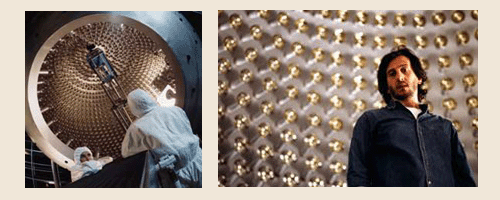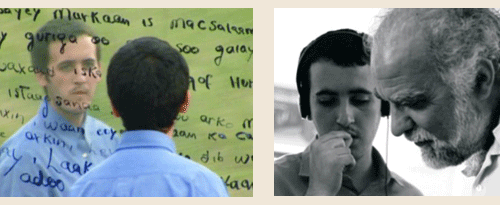Festival du Cinéma Italien d?Annecy - 23ème éditionBolognaise grand écart du réel au burlesque.
Le Festival de Cinéma Italien d?Annecy reprend l?histoire au pied de la lettre. Sans doute cela peut-il paraître inconfortable. Il semble pourtant bien qu?apparaissent deux cinémas. L?un dur et social, au plus près de la terre et des hommes, hérité du néo-réalisme, traquant la grande histoire pour se frayer un chemin, une lecture, un discours politique. Un cinéma des corps et de l?espace, tandis que l?autre, pris du vertige des comédies napolitaines, capte la vie par le rire, le rythme et la parole. Un festival pour embrasser à la fois l?Italie et tout son cinéma. Des bras immenses, donc.Après avoir été durant des décennies une terre d?émigration, l?Italie vit de façon problématique l?inversion du mouvement qui la désigne désormais comme un des pays les plus attractifs de la communauté Européenne. La faute à sa proximité avec l?Europe orientale et ses milliers de kilomètres de côte.
La mer est d?ailleurs au centre de Quando sei nato non puoi piu nasconderti, dernier film très attendu de Marco Tullio Giordana après son très beau (et long) Nos meilleurs années. C?est là que disparaît, lors d?une croisière en voilier avec son père, riche industriel, Alessandro, âgé de treize ans. Où il suffit d?une rafale en pleine nuit pour se trouver plouf-plouf au milieu de la méditerranée, à demi inconscient, comme une aiguille plantée à la verticale dans l?eau. Recueilli par un ancien chalut transformé en boat people pour immigrés clandestins, Sandro découvre un univers qu?il n?imaginait pas. La faim, la violence, la soif et la peur. De leurs soutes en égouts, les tôliers mènent leur épave flottante à quelques miles des côtes, abandonnant leurs passagers comme de vulgaires colis dans les bras de la police des frontières.
Sans doute parce que plus resserrée, plus instable, cette partie du film possède une force narrative, une tension qu?on aurait aimé retrouver ailleurs. Sandro expérience le cynisme, la vie dure, mais aussi l?amitié. Une fois rentré à terre, le film s?ouvre alors trop vite au pathos et y perd son propos. L?intrigue se dilue, les lieux se multiplient, le cadre devenant plus large, intermédiaire, télévisuel.
Peut-être s?agit-il d?une question de point de vue. Giordana semble tout du long incapable de s?en tenir à un seul sujet. Immigration, adolescence, filiation, amitié, initiation, le film prend des airs de filet dont le cinéaste ne parvient pas à resserrer les mailles. Comme s?il restait trop à distance des uns et des autres en cherchant tous à les inclure dans un même cadre, Giordana perd ses personnages et son film à force de trop en dire, trop en faire, trop en montrer.
Un jeu d?enfant tout près de la mort.
On retrouve d?ailleurs ce travers dans Certi Bambini d?Andrea et Antonio Frazzi. Un regard placé là aussi au cur de l?enfance et de l?Italie. Rosario ne va plus à l?école et passe son temps dans les rues à voler, à attendre et jouer sa vie comme par défi. L?ouverture du film est en ce sens admirable. Postés de part et d?autre des rambardes de sécurité, les membres de sa bande doivent un à un franchir en courrant la voie express à quatre voies sur laquelle dévissent les voitures à toute allure.
Le film reprend de manière fragmentée toutes les défaillances, les trahisons, les espoirs déçus qui mèneront Rosario sur une mécanique du pire. Qu?il s?agisse des parents, de son éducateur où de la jeune femme plus âgée que laquelle dont il tombe amoureux dans une maison familiale, tous les adultes semblent voués à le trahir, l?abandonner, le laissant seul pour déchiffrer ce qui se joue autour de lui.
Pas encore adulte et résolument coupé de l?enfance, Rosario erre entre les mondes. Les frères Frazzi matérialisent cette errance dans les scènes très réussies du métro. Le travail sur la photo, la lumière, témoigne d?ailleurs d?un savoir faire visuel qui paraît d?autant plus gâché que le film tourne à vide. Aucun personnage n?évolue, chacun s?essoufflant dans sa roue de hamster. Qu?il s?agisse de la forme ou du contenu, les réalisateurs finissent par souscrire au fatalisme de leur scénario - clinquant et vain. En ne montrant qu?une mécanique de violence sans issue de secours, les frères Frazzi doublent en réalité par le cinéma ce qu?ils dénoncent de la mafia : utiliser l?enfance pour s?en faire un business.
Ces deux films centrés sur l?enfance sont d?autant plus décevants lorsqu?on les compare au lauréat du grand prix du festival, Saimir, de Francesco Munzi. Une perspective inversée où le point de vue principal n?est plus celui d?un Italien mais d?un adolescent d?origine albanaise. En choisissant de réduire son sujet au territoire occupé par les immigrés, à leur vie de part et d?autres de la frontière intérieure du droit, Munzi évite les travers du film de Giordana et gagne en profondeur ce que ce dernier perd en surface.
Un film où l?attention portée aux détails révèle un travail magnifique sur l?espace. Aux antipodes à l?esthétisme de glacis présent dans Certi Bambini, chaque bout d?espace est ici signifiant et trouve une résonance dans les différents personnages. Le film pose dès le départ la mort effective du patriarcat : les hommes sont des ruines, des monstres ou des lâches. Face à cet univers où le banal touche souvent au sordide, Saimir incarne l?adolescence de façon presque archétypique.
Il avance, provoque, goûte et transgresse les frontières pour se faire un passage, se construire à mesure. Mais sans en faire trop, souvent par à coup, mêlant violence et tendresse avec une sobriété, un calme impressionnants. Qu?il rencontre l?amour ou se mesure à son père, c?est un corps en mouvance qui s?oppose à l?ancien ordre en butée, forçant les portes pour ouvrir la parole. Un film qui, à l?image de son personnage principal et de sa mise en scène, fait montre d?une ferveur, d?une beauté âpres et bouleversantes.
Descente et renaissance. Petite fabrique du mythe.
Enfin, ce qui étonne dans Saimir est aussi cette manière blanche de traiter l?initiation, le passage d?un ordre à un autre, en même temps que la trahison, la culpabilité des fils héritée des pères défaillants. Daniele Vicari signe quant à lui avec L?Orizzonte degli eventi un second long métrage qui poursuit avec brio ce mariage de l?ultra contemporain avec des thèmes plus antiques. Ici, orgueil et quête de pouvoir s?entremêlent autour du destin d?un scientifique qui, à partir d?un impair professionnel, voit toute sa vie basculer.
Qui est cet homme ? De quoi parle-ton ? Qui recherche quoi ? Vicari n?est pas du genre à tout mâcher. Au spectateur de suivre et démêler ces nuds. De l?ultra moderne solitude à la compagnie d?un berger albanais, Max fait l?expérience d?une cassure. Intime, mythologique, esthétique. Prince déchu passé par les cendres, il réapprend à vivre et considérer l?autre comme être à part entière. En partant d?un canevas narratif proche du conte, mais un conte pour adultes, noir et tendu, Vicari replace l?humain au centre d?un tout-technologique qu?il semble in fine considérer d?un mauvais il.
Faut-il voir le film comme un discours simpliste visant à vilipender la science au nom d?un retour (impossible) à une nature Rousseauiste ? Certainement pas. La malice de Vicari tient d?abord à la nature métaphorique de son récit. Film ouvreur de parole, il demeure avant tout le portrait d?un personnage en crise, mu par des pulsions qui le dépassent. Outre le travail plastique admirable, la mise en scène au couteau servie par d?excellents acteurs, c?est donc ce retour au mythe, sa rigueur classique qui impressionnent.
Tout au réel, tout au cinéma.
Un retour que l?on retrouve également avec Vento di Terra, de Vincenzo Marra. Un film faisant sien tout l?héritage néo-réaliste pour montrer la vie d?une famille ouvrière pauvre de Naples. Son personnage principal, Vincenzo, à la suite de son père, apparaît comme ultime vestige de droiture dans un monde voué à sa perte. Dans une progression tragique où sa famille entière finit emportée par la corruption du monde, le film est une lente plongée vers le désespoir et l?absurde : plus Vincenzo s?approchera du droit et de la loi, plus il en paiera les conséquences dans sa chair. Un film politique sous forme de mélodrame social dont le jusque-boutisme revendiqué fait la force et l?incandescence. Une gifle froide qu?adresse V.Marra au paysage cinématographique et politique ambiant, pour un cinéma social au marteau bien en gorge, dont la sobriété et la droiture, à l?instar de son personnage, lui confèrent une force toute particulière.
Réel, histoire et cinéma, soit. Mais qu?advient-il donc du couple ? Quid de l?amour, des vespas, de la dolce vita ? Le cadre n?est certes pas en reste. Avec La vita che vorrei, Giuseppe Piccioni base entièrement son film sur la mise en abyme. Federico, acteur reconnu et admiré, a pour partenaire dans son nouveau film Laura, inexpérimentée mais pleine de vie. Soit le doublé idéal pour une romance dix-neuvièmiste sur l?amour impossible, thème du film dans le film pour lequel nos deux héros sont engagés.
A travers le texte de leurs rôles respectifs, des premières lectures de script jusqu?au tournage, en passant par les répétitions, Federico et Laura tombent peu à peu amoureux l?un de l?autre. La frontière entre le (vrai) jeu et le (faux) vrai, ou le vrai du faux dans le vrai rendra bien vite poreuses les frontières entre la vraie (fausse) vie des acteurs et leurs rôles respectifs dans la fiction qu?ils tournent. En filmant ses comédiens dans leur monde, où être et paraître se mêlent dans un même désir d?être vu et aimé, Piccioni nous montre donc surtout le cinéma des acteurs.
La vie que je voudrais. Le cinéma comme art de toupie.
Tandis que l?on suit l?ascension de Laura dans le Landerneau du cinéma romain, Piccioni, virtuose ironique, filme le ballet des producteurs et des agents, entre embrassades, sourires, convoitise et double-jeu. Mais ce qu?il capte le mieux reste l?agitation des plateaux, l?affairement des techniciens, maquilleurs, costumiers et figurants entre lesquels sa caméra se glisse avec grâce.
La scène du bal offre ainsi un pur moment de jouissance rance et cinématographique. L?intelligence narrative et visuelle de Piccioni fait en effet se mêler (fausse) fiction et (fausse) réalité dans un (faux) salon viennois bercé évidemment par une (vraie) valse de Strauss. A travers les costumes, les lumières, le mouvement circulaire des corps sous la musique jusqu?à la scène sur codée de l?évanouissement, ce remake de Sissi mis par l?abyme se mue en métaphore tautologique du cinéma lui-même. Pour Piccioni, une véritable déclaration d?amour à cet art en même temps qu?un aveu du fétichisme qui lui est intrinsèque. Pour le spectateur, l?essence même du plaisir d?être autre le temps d?un film, et de tourner, tourner dans ce rêve-là, jusqu?à sortir de la salle hébété comme une toupie en fin de course.
Double film, double rêve au glamour assez sombre, La vita che vorei déçoit pourtant dans sa dernière partie. Soit, la romance des deux acteurs ne tiendra pas. Mais pourquoi céder à la redite en surlignant de trop la vanité, l?égoïsme, la jalousie des acteurs ? Lorsque arrive le dernier événement peu vraisemblable du film, difficile de ne pas être un peu navré par ce couple qui, dans la (fausse) vraie vie, sonne aussi faux que les personnages d?un autre siècle qu?ils incarnaient derrière la caméra. Reste un très beau film d?amoureux du cinéma sur le cinéma, lucide et cruel, en même temps qu?une déclaration d?amour-haine à tous ses acteurs.
Une fièvre au goût de romance sous acides.
Le couple encore mais sous des feux plus heureux. Avec La Febbre, Alessandro D?Alatri définit lui même son film comme une déclaration d?amour et de rage envers son pays. L?amour d?abord, où les plus vieux clichés peuvent parfois s?avérer les meilleurs. D?Alatri convoque pelle mêle vespa, poèmes et promenade en barque. Tous deux sont beaux, jeunes, et souriants. Lui, apprenti architecte qui bâtie, invente, rêve et vit toujours chez sa mère. Elle, go-go danseuse la nuit, s?apprête à partir aux Etats-Unis finir sa thèse sur le poète Derek Walcott. Un fils sort des jupes de sa mère pour se glisser sous celles de sa copine. Un couple se sépare dans une gare puis se retrouve et s?aime. C?est aussi ça le cinéma : un film de lucioles pour mieux aimer la vie.
L?amour sans oublier la rage. Au moment où il rencontre sa belle, Mario découvre la joie solaire du fonctionnaire. Dans la mairie, un univers de lustres, de parquets cirés, de mesquinerie. Il y découvre la mort chez les vivants. Sa gentillesse, sa bonne humeur lui valent d?ailleurs d?être persécuté du soir au matin par son supérieur, avant qu?il ne soit tout simplement relégué au cadastre des cimetières. Une descente au goût pissenlits, dont D?alatri filme les allées, les galeries de visages sépias, les cadres photos et leur forme ovoïde reprise partout sur les décors du film.
Car s?il manie l?ironie légère et cinglante, D?alatri n?oublie pas d?être cinéaste. Passant du vert des cimetières aux moisissures de bas d?immeubles, d?une nuit d?ivresse sur un trottoir à la blancheur d?une chambre d?hôpital, le réalisateur italien fait preuve d?une virtuosité qui n?est pas sans rappeler le Tim Burton des débuts. Une proximité entre burlesque et mélancolie où le rêve bascule vite au plancher pour finir sur le rire. Où rien n?est impossible pour se faire bon laquais. Où l?on s?occupe des morts comme de joufflus nouveaux-nés. Satire au vitriol d?une administration grande castratrice, figure éternelle de la mama italienne, La Fièvre, fable amoureuse à l?humour pétillant d?acides, aura brillé par sa fraîcheur. En recevant le prix Sergio Leone du festival, D?alatri confirme donc son talent de réalisateur de premier ordre. En affirmant l?art comme soupape à la nécrose, il signe une merveille de comédie, tout à la fois intelligente, populaire et universelle.
Un silence particulier : l?amour et l?autisme.
« J?éprouve de la souffrance. Pour cette fille j?ai souffert dans ma chair. J?ai appris à vivre aussi. » On comprend vite que le film de Stefano Rulli sera particulier et rare. Parce qu?il filme des trisomiques, parce qu?il se filme lui-même, parce qu?il filme sa femme, parce qu?il filme Matteo, leur fils autiste âgé de 25 ans. A voir tous ces corps vivre dans une maison d?accueil, on perçoit d?emblée une distance juste, à la fois intime et nécessairement lointaine. Intime d?abord par leur parole. Stefano Rulli, parce qu?il est père de l?un des leurs, est accepté de front, et nous spectateurs avec, mis dans la confidence, propulsés dans l?intime. Comme si l?hésitation, la méfiance, la façade télévisuelle des autistes avaient ici disparu, conférant à tous ces mots, ces confidences, une force brute, une intensité rares.
C?est en ne trichant pas que Stefano Rulli signe un film immense. L?intimité de fait ne cache pas l?éloignement, la différence fondamentale. Le film bascule en permanence entre ces deux options. On les regarde s?aimer, eux qui semblent plus libres et plus fragiles face à leurs émotions. Rulli filme des amours, des mariages qui se font puis s?étirent. Il les filme danser, rire et parler surtout. Ils sont là en égal. Aussi fous d?amours et blessés par la mort que nous pouvons tous l?être. Où l?on revoit Carlotta, filmée lors d?une autre fête, avant qu?elle ne décède, et qu?on lise ces poèmes. « La mort arrive, lente. Adieu pour toujours. Je veux que vous me quittiez, pour toujours ».
Une force de la parole que vient parfois concurrencer celle des images. Un corps d?enfant penché sur une piscine éclairée sous l?eau, un fils qui observe l?état des yeux de son père tandis qu?on chante derrière Father & Son de Cat Stevens. Ou les mêmes à quatre pattes dans un champs couvert de grands miroirs posés sur l?herbe. Car c?est bien là, au cur du cinéma, par les images, le scénario, la mise en scène que le projet prend corps. A la toute fin du film par exemple, lorsque Matteo assis près du feu se voit confier un nourrisson. D?un coup, la tension dramatique monte et se rapproche des flammes. Rulli, de l?autre côté de la pièce, filme la scène en s?approchant peu à peu. Matteo berce l?enfant, sourit, et chantonne très doucement.
Tout passe par la croyance, l?espoir et son versant plus sombre. Rulli filme l?ensemble, sa vie, son couple, son fils. L?histoire de parents condamnés à chercher, comprendre et peut être ne pas tout se rappeler. Qu?ils peuvent se faire pousser, rejeter, frapper légèrement par leur propre fils. Et qu?il suffit d?un rien. Un bruit à peine trop fort ou le souffle du vent, et tout devient épreuve. Se calmer, se laver, se coucher. La bascule du bonheur à l?angoisse en un fragment de seconde. Un film bouleversant par ce qu?il montre de l?amour, de la patience, de la souffrance qui tout du long traversent ces êtres.
La vie en quelque sorte, poussée plus loin par le prisme d?un cadre. Le festival aura pris cette mesure. Une édition forte par sa mise au réel, son engagement face au présent, aussi bien au centre qu?à la marge. Qu?il s?agisse des comédies, des drames ou des documentaires, le constat demeure au fond identique. C?est lorsqu?il se fait radical à l?intérieur d?un genre que ce cinéma-là nous prend. Reste à giffler l?image pour tenir l?avant-poste.
Stéphane Mas
Articles récents
7 ans - Jean Pascal Hattu
Goya, les peintures noires - Yves Bonnefoy
I don?t want to sleep alone - Tsai Ming-liang
Les climats (Iklimler) - Nuri Bilge Ceylan
En avant, Jeunesse ! Juventude em marcha - Pedro Costa
Babel - Alejandro Gonzales Inarritu
The Host, conte écologique sur la paternité
© 2005 peauneuve.net - archives - liens - - haut de page