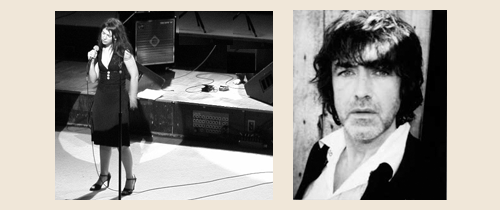Festival rock au château : Sédières brûle-t-il ?Petits oiseaux et grand alligator.
Comment jouer dans une grange ? Se faire capitaine au rouleau pour une féroce bataille, se ruer sans merci pour un Kama sutra champêtre, simplement mettre les bottes en l?air et craquer l?allumette, quitte à bafouer St jean : affiche renversante au Festival de Sédières et triple claque en une seule nuit : Alamo Race Track, The National et The Wedding Present. Récit d?un festival qui va faire des envieux.D?abord un lieu : château, étangs, allées, coursives, granges. A l?instar de ses congénères, Sédières n?est pas qu?un champs délaissé quelques jours à de jeunes vautours le bec en forme d?oreilles. On parle ici opéra, théâtre équestre, peinture, jeune public et musiques actuelles. Un mot savant pour dire le diapason tatapoum qui durant quatre jours réveille ces terres d?eau et de forêts dans un décor grandiose. Pour la musique de manants, celle à guitares, l?étape se trouve aux granges.
Une salle immense, le plafond lamé de bois comme une vieille église de Nouvelle Angleterre, sauf qu?on y trouve ici, comme des cymbales posées sur l?air, d?énormes caissons de basse en attente. Signe d?un geste inversé, tout comme ce festival lui même à l?envers de son nom. Il n?y a donc rien d?hier mais plutôt de demain pour une programmation qui, en plus des icônes (Wedding Present, Murat, Devendra Banhart) aura fait la part belle aux jeunes pousses en devenir (Quidam, Gecko Palace).
Banhart vs. Mugison : prairie contre ouragan.
Pour ouvrir le bal, Banhart avait convié sa troupe de slackers au look échappé d?un disque de Spirit à mettre les formes et le couvert. Au menu, un véritable festin d?oreilles en plein cur de l?americana, folk teinté soul grâce à une section rythmique enfin à la hauteur. Apôtre neo-folk sur ses disques, la fine fleur nomade aura surtout impressionné, outre son aisance aérienne, par un soft groove qu?on ne lui connaissait pas mais qui lui va comme un gant. Survolant très haut perché ses petites sucreries dansantes, Banhart, frère d?un soir de Johnny Horton, Steve Cropper ou Reggie Young, aura livré un set comme une chupachup en bouche : un régal.
Autant dire que l?apparition du premier bûcheron d?islande servira de contraste. Mugison, auteur d?un très beau disque d?aventure low-fi alliant marteau piqueur et féerie acoustique, s?était mis pile à la jonction d?une route que partagent Tom Waits et Dany Cohen, ou peut-être Pavement et Daniel Johnston, allez savoir. Bête en cage et one man band se jetant plein de fureur sur son laptop et sa guitare, Mugison transforme la scène en lieu de performance. Ouragan sonore de toute une vie à crue, il se livre entier, sans barrière, et réussit le tour de force d?être bouleversant.
Las Ondas Marteles vs. Bumcello : l?âme au cur et le monstre griot.
Cette façon d?incarner, d?être tout à son art, Mugison la partage sans doute avec feu Miguel Angel Ruiz, poète à l?origine du projet Las Ondas Marteles. Et ce n?est pas leur seul lien, tant l?âme du trio des frères Martel repose sur l?épure, la ligne tendue d?une âme cubaine passant d?abord par la voix, le corps et la musique dans son plus simple appareil, à des années lumières du maquillage world pop d?un Raoul Paz. Silvio Rodriguez se retourne -t-il ? Ce que l?on tient là, suffisamment rare pour être apprécié, est un concert de théâtre : minimaliste, serré, poignant par les mélopées de Miguel Angel Ruiz, le jeu sur les aigus, la voix et le corps de Nicolas Martel, la contrebasse ample de Sarah Murcia et le son de Sébastien, plus électrique que sur Y despues de Todo, se rapprochant à mesure du maître Marc Ribot. Un set étincelant par sa sobriété, son romantisme à fleur d?os, qu?on aimerait voir autant de fois qu?on a fini nos nuits sur l?album. Inutile de compter.
A faire cohabiter l?impossible, disons que, s?ils sont amis de longue date, l?ethno magma trip de Bumcello fait un peu figure d?intrus après les boléros des Ondas Marteles. Un intrus qui s?inviterait chez vous pour tout dévorer, tant il s?avère difficile de parler demi-mesure à propos de Cyril Atef. Orgie de poignets, de coudes et de pieds, le batteur-griot poursuit son initiation transformiste ès rythmes avec une ahurissante dextérité. Comment résister ? Le mariage transgenre de ses percussions glanées aux quatre coins du monde avec le violoncelle de Vincent Segal fonctionne toujours à merveille lorsqu?il touche à la corne, au tribal. D?où l?incompréhension lorsque ce dernier délaisse le son de contrebasse pour se faire clone de Satriani. Ah, l?art pénible d?être prodige ! Les poutres de Sédières ne sont pas près d?oublier : en pleine possession de ses moyens, le bouffon Bum, dont la perfusion punk de ses tendres années aura lentement mué en feu d?artifice nous aura, une fois de plus, mis la tête à l?envers.
Un peu comme les jeunes hollandais d?Alamo Race track, dont le premier album Birds at home continue à nous faire attendre dans le calme la sortie du nouveau Sparklehorse. Peu s?attendaient donc à un set faisant passer les Hot Snakes pour un groupe de quinquas sous prozac. Et pourtant. Entre un batteur frustré de n?avoir pu sur l?album achever son identification héroïque à Mike Tyson et un Ralph Mulder au chant incroyable de maîtrise, les quatre cowboys à tulipes n?auront fait qu?une flambée de Sédières : déchaînement tellurique après de longues montées retenues par une voix rappelant Morrison à notre bon souvenir, une petite bande férue de rock sexuel dont on reparlera très vite.
The National vs. Grand National : K.O par transparence.
Impossible d?hésiter passées les quelques secondes d?usage. Oublier la pop en soupe des anglais pour se focaliser sur un des concerts les plus tendus du festival. Nul doute que l?embolie dentaire virtuelle dont Matt Berninger fut victime eut sur lui l?effet d?un puissant alcaloïde. Malgré son poing retenant la mâchoire durant toute la durée du concert, jamais le leader des National n?aura paru si entier sous camisole Jack Daniels. Acoquiné de ses deux paires de frères préférés, Scott & Bryan Devendorf (guitare, batterie) contre Bryce & Aaron Dessner (guitare bass), c?est bien d?une autre histoire de famille dont il s?agit, où se dire complices n?a rien du cliché.
La preuve au dialogue incessant d?instruments dont la puissance se répond, se partage, s?échange pour une longue construction de morceaux plus tendus, plus rapides que sur disque. Et si les fans du groupe se comptent d?habitude parmi des trentenaires à l?équilibre psychique instable ou de jeunes étudiantes lettrées passant leurs dimanches à décortiquer le spleen urbain des textes, joie ! On aura pu goûter une version plus franche, plus dure d?un groupe en pleine mutation d?écailles.
David Gedge, seigneur du rock.
Est-ce parce qu?il considère les Wedding Present comme the best rock?roll band on earth que Matt Berningeer s?est ainsi surpassé, agitant toute sa troupe à sa suite ? Reste que pour une de ses rares prestations scéniques de l?été, le groupe de David Gedge aura fait sursauter les quelques morts du coin. Entrés tard dans la nuit pour un set au volume ahurissant, prêt à décorner les quelques Salers venues alentour se mêler au public déjà mis à terre par les prestations précédentes, le trio se mit en tête une idée simple : achever ce qui restait des troupes.
A l?accoutrement sobre des trois anglais, mention spéciale pour la bassiste. Rien qu?à ses hautes bottes rouge et sa mini jupe en cuir noir fendue, on pouvait deviner l?air de punition qui traînait dans la grange : dominante, sauvage à dispenser sa sentence et faire rebondir les lignes tranchées de sieur David Gedge. Lequel, malgré sa gloire passée au pays d?Albion, resta fort gentilhomme, s?appliquant en français pour introduire sa suite de météores faisant pleine cible à chaque coup.
David Gedge est un implacable maître archer. Des titres à la pointe de curare, choisis de ses meilleurs albums au petit dernier, il n?y aura rien à jeter, mais rien. Une formule simple : un matraquage serré de batterie sur un couple basse-guitare coupant de larges parts de gras : l?art d?être boucher peut servir de grandes causes. Peu d?ailleurs se remettront de cette rage à faire tomber les murs, bien plus incisive live que sur Take Fountains. Un set ayant la force d?un ouragan, sans fioritures et sans pose, reléguant Placebo au rang de gentils biberonneurs, tandis que les National, tous en clan devant la scène à l?issu du concert, discuteront longtemps de la claque reçue, un sourire béat sur la face.
Egéries, masques et chandelles.
On aurait dit que Fabrice Ponthier avait presque prévu le terrassement tatapoum de la soirée parrainée par les Inrocks. Parlons donc de lendemains qui chantent avec deux égéries aux antipodes l?une de l?autre. Kelly de Martino, lorsqu?elle est seule à l?orgue, tisse ses comptines au seuil de l?intime : mots porcelaine effleurés sur la brèche d?une voix proche, funambule, s?agrippant sur l?aigu avant de revenir aux graves. Pieds nus sur scène, le charme nature d?une petite femme de verre entourée d?une contrebasse et d?un guitariste travaillant ses effets. Un contraste sans mesure avec sa rivale d?un soir, Jennifer Charles, égérie cosmo-pop d?Elysian Fields, des talons hauts de glace pour une jupe à lacet tirée droit du Lolita de Kubrick.
Rêve, désir et mort : Guignol, Muholland drive, champs élysées.
Petite bouffée d?adoration d?idole ? Ce n?est pas peu dire. Jennifer Charles à elle seule concentre toute l?imagerie star des années cinquante, à commencer par la plus mutine d?entre elles, Betty Page. Sauf qu?au naturel de la queen of pin-ups de Nashville, Jennifer offre d?emblée des reflets tocs sur-étudiés. Un corps entier suspendu à un film, une image, une pellicule de vide glacée pour ceux d?en face. Cette façon de s?identifier à une pose, une figure, dépasse même la notion d?exhibitionnisme : à ce stade là, Jennifer ne joue plus, elle s?incarne dans son rôle d?être-image, jusqu?à complètement disparaître.
On commence donc par rire. S?agit-t-il d?un rêve, d?une farce, d?un cauchemar ? Sur chaque côté de la scène, deux grands panneau annoncent le « Théâtre de Guignol, nouveau spectacle dans votre ville ». Quelle ville ? D?un coup, la chandelle brûle. Le charme opère, lisse et faux comme une cire épaisse, mais il opère, cela ne tient qu?à sa voix. De la même façon qu?on peut adorer Madeleine Peyroux sans écouter du jazz, on cède à cette voix-là qu?on aime ou pas Elysian Fields. Seule en scène avec Oren Bloedow costumé jour de foire chez Christie?s, Jennifer ouvre une trappe et se retrouve drapée de velours. La même petite boîte mystérieuse que celle du Muholland Drive de Lynch. Jennifer chante le désir, Jennifer reprend Piaf, elle nous trompe, elle nous berne, mais au final on cède, parce que c?est vraiment beau. Comme si derrière ses mille pelures, ses masques, ses peaux d?héroïnes fanées, quelque chose de vrai finissait par apparaître.
Murat de haut vol entre enclume et forge.
Du désir il ne pouvait aussi qu?être question avec Murat, des lignes de peaux versées l?une - la sienne - contre les autres, de ses muses laides et belles dont il entoure ses guitares avant d?aller remuer son or sous ses forêts. Négligé de blanc derrière sa paille de chapeau, Murat honore Sédières de sa seule apparition de l?été. Neuf mois sans concert, Qu?est-ce qu?on ne ferait pas pour la Corrèze...
Rivé à son bottleneck, le barde en blanc se fond de quelques huit minutes d?ouverture blues à l?électricité sauvage. D?avant en arrière, là est le chemin, chante Murat dans une grande fournaise de sueur. C?est qu?il s?y rend bien corps et âme. Entre Jeanne la rousse, La fille du capitaine, L?au delà, les femmes font roue libre, Jennifer Charles n?échappant pas à la règle. Sa coopération passée sur Bird on a poire ne change rien à l?affaire : sur scène à ses côtés, c?est un petit chaperon noir effrayé par le loup. Murat s?enfonce dans sa mythologie. Il y retrouve les traces de visages et de corps laissées par ses chemins. Avec comme équipage la basse de Fred Jimenez aussi belle que celle à l?uvre sur Melody Nelson, et un Stéphane Reynaud plus qu?aérien sur ses fûts, c?est tout entier dans son haut-fourneau que Murat brûle ses cordes. A trois comme au naturel, dans une grange loin du rituel hypocrite des châteaux, le feux prend vite et fort. En face, on s?agrippe comme on peut à ce qu?il reste de cartes, entre les mots déjà mis en boîte et ceux qu?il chante de son apesanteur, à mi-chemin de sa forge, l?enclume pleine de chair, et du reste, plus haut.
Les pleins pouvoirs sur sa musique, le son une fois encore énorme, le trio livre un set peau sur cuir, farenheit électrique. Une fièvre lourde finissant par dévorer tout cru les accents blues du départ. Murat grand seigneur lâche ses incises, farandoles, tresses de mots pour un terrain de jeux ouvert à tous. Un peu comme s?il donnait un grand concert à la maison, pour la clôture d?un festival exactement sur la même longueur d?onde.
Car c?est un peu l?âme de Sédières qu?on retrouve là cachée. Derrière son cadre Relais & Châteaux, tous ses acteurs s?appliquent au même grand écart : jongler entre la très haute pointe, la découverte et le grand public. Une audace qui, sur les musiques actuelles, fait mouche en guise de révérence. Le festival fait peut-être des envieux. Ce qui est sûr, c?est que de plus en plus, on lui sera fidèle.
Stéphane Mas
Articles récents
Goya, les peintures noires - Yves Bonnefoy
I don?t want to sleep alone - Tsai Ming-liang
Les climats (Iklimler) - Nuri Bilge Ceylan
En avant, Jeunesse ! Juventude em marcha - Pedro Costa
Babel - Alejandro Gonzales Inarritu
The Host, conte écologique sur la paternité
Saimir - Francesco Munzi
© 2005 peauneuve.net - archives - liens - - haut de page