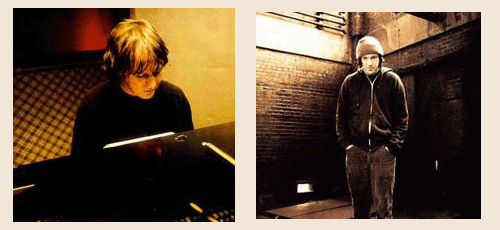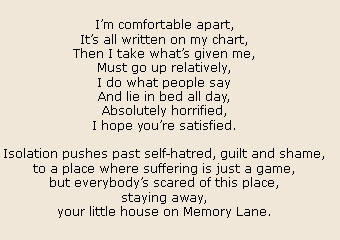Elliott Smith - From a basement to the hill.Pop de miel et cuir.
C’est de veines bien crevées, de cendres dans la bouche, d’un immense gâchis tout autant que d’une beauté lumineuse qu’il s’agit. Orfèvre pop intransigeant, lucide et désespéré, Elliott Smith nous quitte en laissant derrière lui un magnifique dernier opus.Some beautiful place to get lost*.
Cela commence par un lent tourbillon, des cordes en rafale précédant une des merveilles pop dont Elliott Smith aura passé les dernières années de sa vie à préciser l’ouvrage. Dans cet album sorti moins d’un an après le suicide de son auteur, on retrouve toute la grâce mauvaise d’un être torturé par son rapport aux autres, ses liens de dépendance, son dilemme à faire dialoguer force et fragilité dans un songwriting où la lumière le dispute au tourment. Ici, l’accroche électrique taille une incise plus rock, un contour plus électrique, plus nerveux qu’auparavant. Des guitares en aiguës, mais aussi cette voix superposée en chœurs qui tirent et ne viennent rien prendre vers le haut, puisque derrière les notes, comme à la fin de Coast to Coast, morceau ouvrant l’album, résonne une rumeur, comme le babil d’un prêche où chacun se nourrit comme il peut de sa propre parole, bien après que tous les ponts aient un à un brûlé.
The burning of bridges*.
Ceux pour qui Elliott Smith fut un des songwriters les plus doués des vingt dernières années ne seront pas déçus. Les autres pour qui sa pop malade reste par trop lancinante risquent toujours de n’être pas convaincus, car rien ne change vraiment : songwriting pop aux voix suspendues, soft rock à guitare gardant derrière un piano pour reprendre en écho la mélodie, ballades épurées guitare-voix où se retrouve le fantôme de Nick Drake, moins dans la voix que dans cette obsession : redire inlassablement, avec les mêmes outils, cette fracture qui les tient pris à part, en marge, coupés.
A little less than a human being*.
Si Pretty (Ugly before) aurait pu se retrouver sur Figure 8, son précédent album, il n’en est pas de même pour Don’t go down. Ici, le mouvement se tend, les mailles se resserrent, et l’arpège se sature, très électrique. Elliott Smith avait rarement jusque là martelé cette chape noire au fond de lui qu’il écrase contre un mur, autant dans la rythmique - plus massive – que la lourde basse en reprise. Ce n’est pas isolé. Sur Strung Out Again la voix revient fragile avant d’être envahie par les guitares qui se doublent, s’étirent et se détachent : une sorte d’Eagles habité par la grâce, renvoyant donc aux seventies, mais avec une noirceur, un désespoir qu’Elliott Smith paraissait cultiver malgré lui. Avec Fond Farewell réapparaît son génie pour sculpter des perles pop, des morceaux qu’on imagine faits pour les visages vides des rues, des couloirs de métro, ou d’un feu en pleine nuit. Il parlera vie morte, dégoût de soi, suicide, mais toujours sans l’ombre d’une pose. Cette sincérité dans les textes touche et surprend surtout parce qu’elles provient d’une voix frêle, voix de pendu, voix – et c’est peut-être là au fond ce que beaucoup lui reprochent – qui ne peut s’empêcher d’être belle.
Dominos falling in a chain reaction*.
King’s crossing fait partie des morceaux d’Elliott Smith qui, par leur structure, se placent à part dans l’architecture de chaque album. Pas à proprement parler des intros, des inserts, des cut-ups, mais d’étranges objets sonores, dont la force tient là : simples, aériens, totalement décalés, au dehors. Ainsi le début de King’s crossing, des mots, un long flottement, une mélodie en suspend juste avant le début d’un chœur. L’histoire commence au fond comme dans nombre titres d’Elliott Smith, mais le rythme se tord : des crêtes froissées sur les fûts impriment la marche à d’antiques synthés, et l’on perçoit rarement de manière aussi claire que sur ce titre cette rage mêlée de froid désespoir qui semble le tenir en joue.
Le texte se bouscule d’ailleurs d’un récit allumé plutôt rare chez lui, où il est question pelle mêle de noël, d’aiguilles sur les arbres, de juges et de parachutage avec bon gratuit pour un carton kalachnikov. Et lorsque Elliott Smith évoque a trash treasury lost in Beverly Hills, c’est bien de lui qu’il s’agit, paumé sous les guirlandes d’estime dont on le décore pour ses musiques reprises dans les films de Gus Van Sant. Un morceau où les morts parlent aux infirmières devant un petit père noël maigrichon, auquel Smith semble lancer comme par défi : Give me one good reason not to do it, juste avant de terminer plusieurs fois par Don’t let me be carried away, achevant ainsi de nous bouleverser, puisqu’on ne saura jamais à qui cette phrase fut au départ adressée, ni pourquoi elle resta lettre morte.
Those drugs you got won’t make you feel better*.
La proximité d’Elliott Smith tient peut-être d’ailleurs à ceci, lorsqu’on croit deviner qu’il ne s’adresse au fond à personne d’autre qu’à lui même. Seul à sa guitare comme en face d’un miroir, c’est là qu’il se montre le plus juste, le plus honnête, dévoilant pour chacun de ses auto-portraits une part de nous tous au passage. Si sa simplicité nous bouleverse sur Twilight, c’est aussi que jamais il n’insiste, il n’appuie, ne force la bascule qui le ferait passer de sa sensibilité propre à la sensiblerie d’un Damien Rice. Une manière de tenir l’équilibre sur un câble métallique tendu très haut, prenant bien gare à ne pas trop baisser la tête.
Elliott Smith serait le double féminin de Lou Reed, le génie mélodique en plus. Ou peut-être que si l’un se penchait vers les petits être cassés du Bowery pour raconter leur histoire, le second n’avait jamais fait autre chose que d’y vivre. Smith porte en lui cette musique fixée dans un tour d’écrou sur le chiffre soixante-dix, et qui bientôt pourrait servir d’insulte : guitares, mélodies, sentiments, bref une triade au fer rouge faisant mauvais ménage au moderne digital. Smith n’était pas défricheur de nouveaux sons. Il s’inscrit dans une lignée mélodique qui des Beatles à Grandaddy en passant par Brian Wilson, cultive cette beauté plastique un peu désuète de Barbie pop, à une exigence près : avoir le désespoir léger sans être jamais futile, plaçant partout ces chœurs de coton pour compenser l’aiguille, ce romantisme ado que n’empêchaient ni ses bracelets de cuir ni sa gentille tête de monstre. Il aura même fini avec Last Hour et surtout Little One par dépasser son modèle du White Album, avec des ballades où les inflexions à la Lennon vous collent la chair de poule, précisant un peu plus sa désarmante étrangeté - des caresses de serpents sur la joue de petites filles.
Et pourtant, c’est bien ce grand écart de Shooting Star qui fascine : la mélancolie des paroles et du chant menée d’une rage pop par une basse-batterie jusqu’à la chute en Velvet. Une force plus brute, une sorte d’urgence dans les sirènes du début de morceau, comme le héros qui jamais ne paraît aussi fort qu’au moment même où il va tomber, peut-être parce qu’il sait, qu’il a compris déjà, qu’il a fini par céder. Album plus sombre et plus puissant que les précédents ? Cela semble facile lorsqu’on connaît la fin. Reste que jamais ailleurs que sur Memory Lane, Smith n’avait fait preuve d’un humour, d’une auto-dérision si amères devant la valse des confesseurs, médecins, amis et consorts avides de dispenser leur petite morale du bien-être.
Shine on me baby,’cause it’s raining in my heart*.
Que reste t-il de cette hybride Jekyll & Hide mêlant chez Smith douceur mélodique et fureur lucide des textes ?Au final, avec A distorted reality is now a necessity to be free, derniere piste d’un album aussi lumineux que le titre de ce morceau étonne, c’est bien cette mélodie qui surplombe, ingère et survit à l’abattement. Et si l’on cherchait une couleur pour le définir, ce ne serait pas le bleu de la pochette mais bien ce rouge de l’immense et dernière toile de De Stael, Le Concert. En 1979, René Char, évoquant le peintre d’Antibes, écrivait : « On dit de lui qu’il a eu plusieurs vies, et dit-on, une mort voulue. Il en est toujours revenu, n’étant pas perdable ». Disons que la voix, les mélodies d’Elliott Smith ne cessent pas elles non plus de revenir, que c’est tant mieux, et qu’on ne risque pas de les perdre avant très, très longtemps.
* quelques mots, glanés au hasard.
Stéphane Mas
Articles récents
Goya, les peintures noires - Yves Bonnefoy
I don’t want to sleep alone - Tsai Ming-liang
Les climats (Iklimler) - Nuri Bilge Ceylan
En avant, Jeunesse ! Juventude em marcha - Pedro Costa
Babel - Alejandro Gonzales Inarritu
The Host, conte écologique sur la paternité
Saimir - Francesco Munzi
© 2005 peauneuve.net - archives - liens - - haut de page