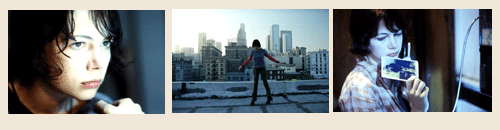Land Of Plenty - Wim WendersL’ami américain, entre intime et politique.
Un vétéran du Vietnam prisonnier du passé doit se reconstruire à travers la parole d’un autre - ici, Lana, nièce femme-enfant, elle-même en pleine reconstruction de puzzle familial. Se mêle à ce canevas la réalité de l’après 11 Septembre pour un film d’une très belle mise en scène, dont l’intérêt politique importe moins que le discours liant le déni et l’intime, paradoxe contemporain.Wenders semble depuis longtemps devoir rejouer la même scène. Avec d’infimes variations. On retrouve une fois encore cette profusion d’écrans mis en abyme, sur lesquels les visages, les corps se ressemblent trop pour qu’il n’y ait pas là quelque chose de suspect.
Suspect, Wenders l’est peut-être dans la manière dont les personnages, les décors, les thèmes de ce film reprennent en écho son uvre entière, à la croisée des espaces, des errances et des mythes. Des espaces pour la route, le passage, l’exil et son petit cortège d’incommunicabilité, espaces d’une Amérique sillonnée depuis plus de quarante ans par un réalisateur en quête à la fois de mémoire et de dette, plus ou moins imaginaires, pour l’avoir sauvé de l’Allemagne d’après-guerre. Dans Land of Plenty, les trois principaux lieux, Los Angeles, Troma, et Ground Zero, dessinent un triangle à l’intérieur duquel repose la mémoire, capitale de lieux de vie éventrés : chantiers, garages, mission homes, trailer parks, préfabriqués, tous lieux de transit et de (re)construction.
Un oncle américain entre perte et parole.
Les hommes ne sont pas à la fête chez Wenders. Ils se perdent, se parlent à eux-mêmes, sont plantés au milieu des déserts et des décombres. Ce sont toujours des hommes perdus à l’espace. Ils n’ont pas changé depuis Les ailes du désir. Ils ont chuté, depuis ils hantent les routes, espérant trouver à nouveau cette place laissée vacante, cette place d’avant la chute. L’oncle cherche des coupables. Il traque des têtes d’arabe pour retrouver la sienne et lui donner un sens. Il cherche sans voir, droit jusqu’au bout, ne s’arrêtant jamais, comme le Travis de Paris-Texas. Alors que ce dernier restait muré dans le silence, l’oncle américain soliloque, il s’invente des codes, s’oblige à rédiger des rapports, s’entoure de procédures. Il se coupe, se sépare du normal pour rendre tout suspect - le quotidien du paranoïaque. Son acolyte Jimmy cherche ses infos parmi des pièces détachées. Le pasteur qui héberge Lana prêche dans son désert urbain des visages qui déjà sont en enfer : lui aussi, en misant tout sur Dieu, en appelle au dehors. Ils souffrent du même mal, partagent cette même impasse de chercher au dehors les causes d’un mal qui d’abord est intérieur et qu’ils refusent de reconnaître. Chacun d’entre eux règne sur un univers mécanique parallèle, clôt, autonome, qui peu à peu va s’ouvrir au regard de l’innocence.
La question du déni, le rire en plus.
Si les hommes selon Wenders sont toujours perdus, en dehors, la femme, elle, touche droit au but, comme l’enfant, en plein cur. Lana est celle qui rend la vie possible. Elle joint la parole au geste dans la mission chrétienne du quartier. Elle accueille, nourrit, écoute, elle prie pour sauver le monde. Mais à la différence des autres, elle semble tout autant résolue à se sauver elle-même, ne noyant pas son mal dans une cause extérieure. Elle n’est pas au déni. Pourtant, sa manière d’offrir à la misère ses yeux humides, sa manière de pencher la tête en signe de compassion peuvent agacer parfois. Car c’est une bonté longue qui s’étale à l’écran. La candeur n’est plus en vogue depuis longtemps. On a taxé le film d’être simpliste, trop didactique. La cohérence des personnages est pourtant là. Ils sont nombreux, ceux qui, pour survivre à leur culpabilité, décident de sauver le monde. Certains finissent même chef d’état. Est-ce une raison pour les glisser en stéréotypes dans un scénario, pas forcément. Mais s’il y a dans le film tant de drapeaux et de religion, c’est parce que c’est aussi cela, les Etats-Unis. Ce n’est pas que cela. D’ailleurs, lorsque la coupe est pleine, une distance ironique en surgit et l’on se prend à rire : l’hymne nationale en sonnerie de portable, l’intervention militaire face à la menace gériatrique, oui, de vrais rires bien sonores ! Alléluia ! Ce n’est pas si souvent que l’on rit chez Wenders.
Espace + Intime + Errance + Mythe = Wenders.
C’est en se perdant par l’errance américaine que le héros de Wenders, d’habitude, finit au fil des rencontres, par se retrouver lui-même, s’accepter tel qu’il est, se raconter sans fard. Wenders ne déroge pas à ses règles. Aller se perdre dehors pour retrouver sa vraie nature : on touche aux mythes premiers d’une Amérique où les fantasmes de l’origine se mêlent à ceux - paranoïaques - de la toute dernière fin. Les parures du décor ont changé. Ainsi, ce qui est vu à l’extérieur - les restes d’une Californie à l’abandon, les rues sales et pauvres de Los Angeles - deviennent les traces visibles de ce que cache l’intérieur des corps : l’abandon, la solitude, le manque de sens. Une Amérique des désaxés pour au final quel scénario ? La rédemption d’un être perdu qui fait son initiation On the road : à priori rien de nouveau sous le soleil.
A travers ce film, Wenders pose donc la question du déni contemporain sous forme de paradoxe. Déni d’une société envers ses pauvres, sa misère, sa souffrance, que lui choisit de filmer, certes, avec un certain esthétisme. Déni de cette frange de la société exclue des plateaux de télévision, des talk-shows intimistes où, paradoxalement, plus l’on répand en surface cette souffrance et moins l’on s’attache à ses causes. Comme si le fait de l’étaler, de la montrer ainsi, ne servait au final qu’à la banaliser, la rendre transparente. Je montre, donc je suis (mais je ne résous rien).
L’oncle américain comme double d’une société américaine autiste et paranoïaque, soit. Derrière ce sujet du syndrome post-September 11, casse-gueule par excellence, ce n’est pas du côté politique mais bien vers l’intime qu’il faut se tourner. L’oncle finit par se reconnaître à travers sa nièce, en acceptant d’écouter sa parole. Par son intermédiaire, en passant du monologue au dialogue, il se recrée un lien réel, intime, qui l’éloigne du fantasme imaginaire. Au final, une sorte d’espoir survit au désastre politique Bush. C’est en tout cas le regard que semble porter Wenders pour que perdure sa filiation avec ce pays d’adoption. Un film avec beaucoup, trop peut-être d’espoir, de longueurs, mais un vrai discours sur l’intime, et une mise en scène superbe : les couleurs, le grain de la pellicule, le cadrage, la lumière confèrent à ce Land of Plenty une qualité plastique digne d’un grand cinéaste.
Stéphane Mas
Articles récents
7 ans - Jean Pascal Hattu
Goya, les peintures noires - Yves Bonnefoy
I don’t want to sleep alone - Tsai Ming-liang
Les climats (Iklimler) - Nuri Bilge Ceylan
En avant, Jeunesse ! Juventude em marcha - Pedro Costa
Babel - Alejandro Gonzales Inarritu
The Host, conte écologique sur la paternité
© 2005 peauneuve.net - archives - liens - - haut de page