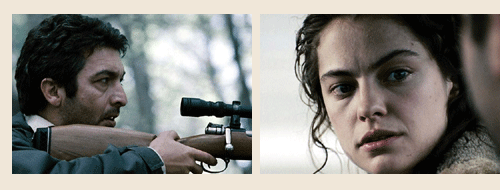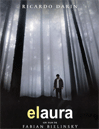
El aura - Fabian BielinskyTaxidermiste jouant sa course à l’épiderme
Suite à un accident, un col blanc obsédé par le casse parfait se retrouve soudain en mesure d’accomplir son rêve. Un canevas mille fois rebattu que Bielinsky hisse au-dessus du lot par un brillant jeu sur le vide. Film de genre, initiation hors de soi, fièvre lente bercée d’inquiétante étrangeté. Au seuil d’une forêt, un personnage prend la place d’un mort et se met à jouer.Les traces sont balisées - un casse, une équipe, un homme, un plan. Rien bien sûr ne se passera comme prévu, dans un lent tour de manège qui finira chiffon. Si le film de casse sert de prétexte à l’hommage du cinéma de genre, reste le traitement d’un personnage aussi opaque, inoffensif et mystérieux que celui de Julianne Moore dans Safe.
Jusqu’où s’adonner aux histoires ? Jusqu’où sortir de soi pour être un autre ? Comment regarder, comment voir ? Triple mouvement d’un film qui s’organise par le point, la ligne et le cercle. Ou comment du travelling faire un art de la fuite.
Bielinsky voue un culte à l’abîme. Accroupi dans un musée d’histoire naturelle (musée d’histoire du film ?), notre personnage s’attache à des bois de cerf dans une vitrine. Une scène semblable à toute la deuxième partie du film, se payant même le luxe d’annoncer une mort puisque le bois du cerf se brise. Un homme caché dans un rectangle de lumière au beau milieu d’une salle obscure, faiseur d’histoire et grand illusionniste ; ce taxidermiste-là ne serait-il pas cinéaste ?
Jeu sans faille à partir du je.
Une figure en vrille suffit à tout modifier. Cinéma du mouvement par la rétine, Bielinsky joue presque exclusivement son film sur le regard. Celui de la mémoire, seule arme du personnage. Celui du cinéma, seul bagage du spectateur. En plus d’une émotion étrange, indéfinie, jouant des airs connus pour mieux les détourner.
Bielinsky aime à bluffer son spectateur. Ainsi du début lorsqu’il synchronise sur un même lieu récit présent du (vrai) narrateur témoignant autour de lui les (faux) évènements d’un braquage qu’il imagine en train de se produire. Comme une bobine déliée sous nos yeux et les siens, annonçant là ce qui pourrait advenir.
Topographie d’un cinéma - El aura du Troisième homme à l’Est d’Eden.
L’espace est trouble. Un casino au milieu d’une forêt, des baraques de chasseurs, une route travaillée au travelling jusqu’à une cantine reprenant par son nom (El Eden) une litanie du cinéma avec lequel joue l’il en coin Bielinsky, s’offrant là Aguirre et Dietrich pour un second baptême, sans même parler du Troisième homme.
Il sera donc question de noms, mais surtout d’espace. L’errance, la perte, ramènent toujours plus ici au cinéma (américain) qu’à une géographie réelle. Cette route perdue aboutissant au parking désert d’El Eden, bordel déguisé en Diner, convoque encore James Dean, dont le pick-up Ford bleu auquel il manque un D traverse tout le film de son pouvoir performatif.
Le scénario, aussi brillant soit-il, n’est qu’un prétexte afin que Bielinsky se montre cinéaste. A la cohue des corps présents dans la banque succède l’absence de sa femme chez lui. Celui qui quitte la banque se retrouve quitté. Il part chasser dans une forêt mais c’est une femme qu’il y trouve. Comme si chez Bielinsky, toutes les évidences devaient être trompées.
Aucun symbolisme donc, si ce n’est du côté du chien, dont le double regard et le museau tâché de sang n’annoncent rien de bon qui vaille. Tout se joue d’ailleurs là, entre chien et loup, dans une suite d’allers et retour, de cercles qui se chevauchent et se recoupent sans cesse pour une chasse au genre en bon et due forme.
Film noir par l’envers.
Bielinsky est trop formaliste pour ignorer ses pairs. L’indice explicite révélé du troisième homme montre donc où chercher. Le noir d’abord, partout peint sur le cadre, un personnage ambigu, une caméra subjective enfin suffisent comme signature. Bielinsky travaille le film noir et troque la ville pour une forêt, les arbres en guise d’immeubles.
Au Big Sleep de Hawks succède la courte perte de conscience de l’épileptique. Contre modèle une fois encore, le héros ne subit pas mais déclenche la mécanique dont il devient non le pion mais l’architecte principal. Un homme qui se veut moral au lieu d’être cynique, tandis que la femme fatale censée le faire chuter se mue en fille des bois qu’il sauve par accident.
Safe - l’initiation hors de soi.
Bielinsky promène les traces du scénario comme les galets d’un conte. Son écriture prône par l’abyme un permanent retour sur elle même, où chacun peut à loisir repérer traces et signes du film à venir. Jeu de pistes où photos, chiffres et dessins d’enfants se répondent pour faire sens, et qu’on peut, à l’instar de ces lettres restées au bord des tables, choisir ou non de lire.
Le cadre précis, la lumière basse laissent la part belle à l’ombre, et impriment au film ce goût du mystère qu’incarne parfaitement Ricardo Darin. Un jeu resserré sur le regard et la lente gestuelle du corps, en parfait accord avec l’apesanteur mis en musique par Lucio Godoy.
Etrangeté, apesanteur, circularité. Ce traitement du mystère fait décidément bien du magnifique Safe, de Todd Haynes, le film jumeau dont El aura serait le frère de fortune. Une sorte d’initiation hors de soi, où le personnage réalise ce qui pour le spectateur pourrait ressembler dans un cas à un rêve (El aura), et dans l’autre un cauchemar (Safe).
Bielinsky joue et gagne. Le plus étonnant tient peut-être à son sujet : comme s’il devait pour briller raconter cette histoire d’un type de rien, poussé dans sa chimère, contraint d’avancer dans un vertige en spirale. Un film comme cette forêt dans laquelle on pénètre à mesure. Un lieu de l’errance, de la perte mais surtout du secret, avec ces trois mouvements liant les personnages à l’espace - le point d’arrêt, la ligne d’allers retours et le cercle. Certains meurent, d’autres avancent, un seul s’enferme au circulaire.
Filature d’agonie, roulette existentielle.
Sans doute n’était-il pas nécessaire d’insister tant sur cette extase (douteuse) de l’épileptique en crise. Le jeu de Darin, à lui seul, irradie cette étrangeté à lui-même et aux autres qui fait la force du personnage. Inquiétante étrangeté magistralement rendue dans la filature d’agonie où le taxidermiste file Vega des portes de l’usine jusqu’à sa dernière chute, vidé comme une bête en sang.
Scène admirable par sa manière de définir un corps à l’espace et au temps. Un personnage qui se contente de suivre au plus près, presque inconscient, qui s’approche d’un corps, le touche presque et se contente de le tenir en joue, immobile, l’il implacable. Une errance où le voyeur inquiète d’autant plus qu’il semble vide, sans d’autre motif que cette pulsion de voir.
Transparence du point de vue par le trouble.
Le jeu est présent partout. Ricardo Darin, parfait dans sa lente infusion, ne cache jamais plus qu’il ne dévoile. S’avançant toujours sur le point d’être pris, il force l’intrigue entre évitement et confrontation. Qu’importe le point de vue, braqué sans cesse sur lui, le personnage intrigue et accroche. Un type transparent concentrant une opacité trouble, et que chacun, personnage comme spectateur, accompagne avec défiance, sachant qu’il n’est pas celui qu’il prétend être, mais auquel tous finissent par succomber.
Retour en boucle après les évènements. Le taxidermiste travaille à son renard, étirant ses outils sous la peau, la mâchoire, avant de pointer une tige de fer pour rendre la jambe rigide. Deux petites billes fourrées au fond des orbites, une peinture noire au bord des yeux. Un art du maquillage à faire paraître le faux pour du vrai qui n’est autre au fond que celui du cinéaste - un empailleur de corps qui voudrait nous faire croire au vivant, quand il n’y a que montage et paraître sur commande.
Tout partait au départ d’un viseur qui vise mal, qui se décale. Il y va d’une gâchette comme du regard ou d’un film. Sorti droit des rails du film noir par l’envers, El aura s’affirme donc, outre sa plastique superbe et son scénario très hollywoodien, comme un brillant film de genre, une lente infusion de cinéma par les yeux.
Stéphane Mas
Articles récents
Goya, les peintures noires - Yves Bonnefoy
I don’t want to sleep alone - Tsai Ming-liang
Les climats (Iklimler) - Nuri Bilge Ceylan
En avant, Jeunesse ! Juventude em marcha - Pedro Costa
Babel - Alejandro Gonzales Inarritu
The Host, conte écologique sur la paternité
Saimir - Francesco Munzi
© 2005 peauneuve.net - archives - liens - - haut de page