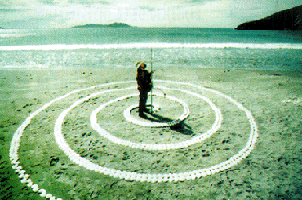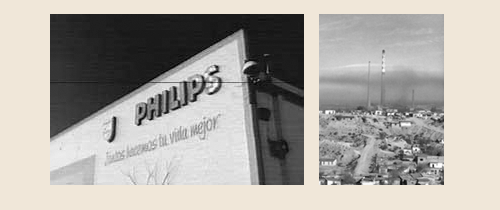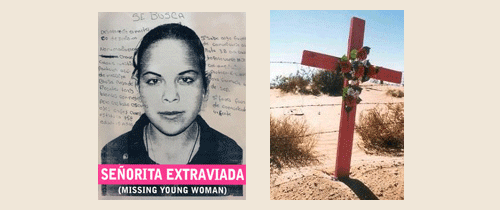Festival de cinéma de DouarnenezChicano spirit - la frontière en plan large
Parler frontière et cinéma, c’est tenir par ses deux yeux l’identité même du Gouel ar filmoù. Un festival qui, au delà des minorités, réclame de la passion et s’engage pour une cinéphilie d’action. Pas vraiment fans d’Hollywood pour réel en guise d’imaginaire, nos bretons. Mexicains aux USA. Un thème pour ouvrir la frontière à l’autre côté, regarder par l’histoire, ses balafres, ses murs, reconnaître des combats, celui du peuple chicano, mais aussi celui d’un cinéma, l’il collé au réel. Pour sa 28ème édition, Douarnenez reste fidèle à son engagement - au menu des minorités, fête et intelligence, pour une tête en plein cadre.Pourquoi la frontière est-elle si importante qu’elle va jusqu’à se constituer en genre à part du cinéma, avec la mouvance chicano ? C’est qu’elle consiste elle-même en un paradoxe : concilier le mouvement et l’immobile. Lieu double puisqu’elle démarque le bon droit de l’illégalité, ceux qui défendent une barrière de ceux qui la traversent, la franchissent, la transgressent.
Une mer immobile qui attire par ses sirènes et rejette ceux qui n’ont pas les formes, les règles, les clefs. Immigrer, passer d’un bord à l’autre, de l’autre côté. El otro lago. Ceux qu’elle accepte, migrants légaux, et les autres qu’elle refoule parce qu’illégaux, étrangers du dehors et qui doivent y rester. De l’ailleurs à l’autre monde, celui des extra-terrestres, l’anglais franchit le pas avec le terme d’alien.
Science-fiction du réel.
Entre fantasme et paranoïa, comme dans le film de Ridley Scott, l’illegal alien incarne une menace sur laquelle on pose un visage - celui l’étranger, prêt à dévorer de l’intérieur le corps de la nation. Sur des registres radicalement opposés, deux films abordent ce problème de la relation entre américains et immigrés, pour à la fois rire et comprendre afin de résister, parfait reflet de l’esprit Gouel ar filmoù.
Film culte dès sa sortie au Mexique, A day without a mexican (2004) applique sous un récit-vignette une idée simple et dévastatrice : du jour au lendemain, tous les mexicains de Californie disparaissent sans laisser trace, provoquant la paralysie totale de l’état. Pochade comique usant parfois jusqu’à l’excès sa parodie du couple cinéma/télévision entre télé-réalité et science fiction, le film de Sergio Arau n’en demeure pas moins cinglant sur le fond. Une farce jubilatoire qui révèle par l’absurde un pan schizophrénique de la politique u.s - rejeter par la loi ceux dont elle dépend pour vivre.
Splendeurs et misères du politique.
C’est par ce constat que se clôt également Farmingville, prix du meilleur documentaire à Sundance, réalisé par Carlos Sandoval et Catherine Tambini. Après plus d’un an passé dans une bourgade en plein Long Island, à quelques encablures seulement de New York, le film dresse un portrait du racisme ordinaire à travers un conflit opposant américains du cru et nouveaux immigrés devenant peu à peu la main d’uvre principale de la ville. Sans maniérisme, au plus près du sujet et de ses protagonistes, le film se fait miroir d’un mal étrange qui ronge nos sociétés - l’étanchéité des espaces.
Gazons, jardins et parcs. Rues, trottoirs et carrefours. Centres, périphéries et zones extra-urbaines. Un emploi, une maison, une nation sur ses frontières, ses cloisons, ses repères. Au cur de cette middle class galaxy, tout fonctionne lorsque chacun reste à sa place, lorsque personne n’empiète sur le territoire de l’autre. Tout fonctionne lorsque l’indifférence empêche la confrontation. Tout fonctionne lorsque les règles, qu’elles soient ou non explicites, sont peu ou prou respectées afin de laisser libre cours à l’individualisme commun.
Mais qu’arrive-t-il lorsque la frontière s’ouvre, lorsque l’espace public se modifie, qu’arrive-t-il lorsque de nouveaux joueurs entrent dans le jeu, et que la ligne, la frontière d’avant s’estompe, se dissout ? Voilà ce que montre Farmingville. Et l’on découvre de quoi sont capables les hommes, du pire au meilleur, et les réponses qu’ils se construisent, qu’elles soient intimes, politiques ou associatives. Un film anthropologique, sans jugement aucun, qui racle au fond de l’Amérique démocratique contemporaine, observe ses rouages, ses extrêmes, pour un regard plein d’humanité sur une ville emportée dans sa propre tourmente.
Parler de cette ligne tracée sur le sol c’est entrer l’il dans l’histoire, user de la caméra pour se faire une perspective. La frontière est multiple : géographique, politique, historique, économique. Mais il est aussi la frontière intérieure, celle qui se cache au creux des têtes, que l’on poursuit à travers la fuite et l’errance.
Appliquant le Tierra y Libertad d’Emiliano Zapata à la sphère de l’intime d’un plasticien contemporain, Carlos Bolado emmène le personnage de Bajo California (1998) dans une marche rédemptrice à travers les paysages désertiques de la basse Californie, imprégnant tout son film du Land Art de Richard Long et Andrew Galdsworthy. Un film qui garde avec lui, dans la reconquête intérieure de son personnage, une empreinte très forte de ce que représente le sol, la terre dans l’identité chicano : des origines, des racines qu’on ne quitte pas impunément.
Point de salut sans culpabilité ?
Tout le cinéma Chicano est ainsi marqué par la culpabilité de ceux qui traversent de l’autre côté. Dans Espaldas Mojadas (1953), premier film dont le scénario est cousu sur le fil de la frontière, Alejandro Galindo sert à grandes lampées un nationalisme naïf qui contraint son personnage à rentrer au Mexique pour y trouver son bonheur. Règlements de comptes et sang sur les mains, le personnage de Rafael incarne le bon héros national, abandonnant les sirènes de l’Amérique pour rejoindre la mère patrie.
Culpabilité que l’on retrouve mais de fil blanc et dans toute la finesse qui caractérise Alambrista de Robert Malcom Young (1977), sans doute un des plus beaux films du festival. Où l’on suit, caméra sur le corps, le parcours de Roberto, de son départ du Mexique jusqu’aux grandes exploitations où il travaille comme campesino.
Un film qui ne se distingue pas uniquement par son scénario coupé à la lame et sa très belle photographie : sa veine de fiction aux frontières du documentaire lui permet aussi de saisir avec justesse La Blessure propre à l’immigré, pour reprendre le titre du très beau film de Nicolas Kolz.
Comment faire, comment dire, comment être lorsque tout vous renvoie sans cesse à votre statut d’étranger ? La fuite, l’exploitation, la peur d’être pris, l’amour aussi, l’impossible équation d’une double vie entre ici et là-bas, grâce au personnage en abîme et hors champs du père, font d’Alambrista un immense film. Robert Young réussit là cette alliance rare d’un film autant intime que politique, et parvient à saisir, outre l’univers du migrant dans toute sa complexité, une image de l’Amérique très juste, dénuée de tout manichéisme.
Viva la Huelca, viva la Raza Unida ! Une théorie de la moustache.
Ce dont ne manque pas une autre pierre de marque du cinéma Chicano, Raices de Sangre, filmé seulement un an plus tôt qu’Alambrista, mais qui porte le kitsch seventies à son apogée visuelle. Au programme, embrassades sous couché de soleil, pattes d’eph et moustaches taillées sur mesure.
Brûlot syndicaliste à visée populaire, le film fut à l’époque le pendant cinématographique des murales peints sur les murs des barrios. Il constitue d’ailleurs une des seules traces sur pellicule du teatro campesino, théâtre d’agitation et de propagande populaire allant dans un même mouvement des droits civiques : faire prendre conscience afin d’inciter les foules à l’action.
Comprenez une intrigue minimale, des clans dessinés au marteau pour un manichéisme bon ton qui, par mise en abîme, apparaît dans le film via le traitement génial de la moustache. Aucune dégustation de mezcal ne ponctuait pourtant la sortie de salle, mais on a vérifié : la moustache des gentils chicanos en lutte, taillée chaque matin sous une lame de faucille, est presque toujours droite (entendez tous les sens du terme), tandis que celle, horrible, des très méchants gringos capitalistes et de leurs laquais, sous le signe de la fourche, pointe invariablement vers le bas démoniaque !
Une simplicité, voire un simplisme n’enlevant rien à la dimension historique du film. A travers sa dénonciation de la répression policière vis à vis des syndicalistes ainsi que la collusion entre pouvoirs économiques et politiques, Jesus Salvador Trevino évoque pour la première fois de manière frontale le problème des maquiladoras, usines profitant du côté mexicain d’une main d’uvre corvéable à merci permettant aux grandes entreprises d’éviter le (déjà faible) droit du travail américain.
Plus de vingt ans plus tard, le problème n’a pas une seule ride mais traîne beaucoup de morts. A Ciudad Juarez, on estime qu’entre deux et quatre cent femmes ont été violées puis tuées depuis 1993. Des affaires classées sans suite par manque de preuves, mais dont on retrouve les restes de corps éparpillés dans le désert au hasard des enquêtes. C’est contre ce déni de justice que Lourdes Portillo réalise Senorita extraviada (2001). Partant des faits, des zones d’ombres, la réalisatrice cherche à comprendre. Elle donne la parole aux familles des victimes et découvre bientôt un univers bien plus proche qu’on ne l’aurait pensé du Traffic de Soderbergh.
Maquiladoras - sévices au pays des moulins d’or.
L’exposé d’Ursula Biemann dans Performing the border, bien qu’un peu ardu, s’avère indispensable pour bien comprendre les faits. Au départ de la chaîne, des multinationales dont la devise propreté, efficacité et compétition leur permet d’employer de très jeunes filles sans aucune qualification en tant qu’opératrices de production. Assembler, répéter, coordonner une seule et même tâche en situation de stress, c’est adopter de fait une culture de management qui leur est totalement étrangère. Le soir, afin d’augmenter leurs salaires dérisoires et faire vivre leurs familles qu’elles ont souvent quittées, nombre d’entre elles rejoignent après leur emploi des réseaux pour une prostitution plus ou moins occasionnelle.
Ursula Biemann dresse sans ménagement la liste des sévices sexuels dont sont victimes ces jeunes filles avant d’être brûlées au milieu du désert. Son analyse établit des corrélations entre les perversions des agresseurs et certaines caractéristiques propres au néo-libéralisme extrême tel qu’il est pratiqué sur la frontière grâce au NAFTA (North American Free Trade Agreement). Absence de régulation par la loi, déni physiologique du corps, primauté accordée à la reproduction mécanique du même, du semblable, assimilation du corps à l’espace qui l’entoure, position de toute puissance, etc. Une étude au statut ambigu mais qui trace un cercle de suspicion autour des maquiladoras que vient confirmer le film de Lourdes Portillo.
Ciudad Juarez est une méta-ville, une boursouflure. Dans son expansion démesurée, certains quartiers, privés non seulement d’eau et d’électricité, n’ont même pas de rues. La réalisatrice filme cet univers de manière sensible, alternant noir et blanc et plans de coupe sur des pylônes, des bouts de déserts, des boîtes de nuits et des rues. Son travail sur l’image suit souvent des témoignages bouleversants, comme celui de cette femme violée à répétition par les policiers d’un commissariat. Dénoncés, condamnés, écroués, ils ne seront finalement que mutés après quelques jours passés en détention.
La force de Senorita extraviada est donc de confronter la parole des victimes à celles d’abord des médias, puis des services d’état censés faire aboutir le droit. Or dans presque chaque témoignage, le constat demeure identique : que ce soit au niveau de la police locale, de la direction des maquiladoras ou de l’état fédéral, on brûle des preuves, on invalide des procédures, on clôt des dossiers sans qu’il n’y ait eu d’enquête, on cherche des coupables qu’on livre en épouvantails à la presse (l’égyptien Abdel Atif Sharif Sharif, le gang Los Rebeldes).
Omission, soumission, participation. Au final, tout se joue dans un triangle reliant les pouvoirs économiques (narco-trafiquants includado), judiciaires et politiques. Des chaînes de protections, de dépendances multiples que rien ne semble menacer - il y a bien quelque chose de pourri au royaume d’Aztlan.
Queremos la formula ! La izquierda no ha muerte !
Un bilan qui pourtant n’est pas que pris au noir. Impossible en effet de voir Le sel de la terre d’Herbert J Biberman sans être emporté par son souffle mutin. Et ce n’est pas simplement parce que le film fut réalisé -en 1953 par une équipe blacklistée par la commission McCarthy - son discours, la force brute de son intrigue, de ses acteurs, en font un véritable petit chef d’uvre. Soit le combat d’une communauté de mineurs mexicains unis contre la discrimination qu’ils subissent à tous les niveaux par rapport aux anglos, leurs collègues américains. Une grève menée de front par un leader mâle et fier, Ramon Quintero, n’ayant machisme oblige que faire des revendications de sa femme.
Or c’est bien là que se joue la petite révolution du film. Partir d’un canevas très Bogart pour aboutir à un revirement total. Ce sont les femmes qui tiennent et resserrent les mailles autour de la police et des dirigeants de Silver City prêts à tout pour briser la grève. Un film de mine tenu et libéré par les femmes, tandis que les hommes en sont réduits à s’occuper du linge et des enfants !
Qu’en reste t-il un demi siècle plus tard ? Qui prendrait aujourd’hui un film de genre (combat syndical vs. injustice des puissants) pour le tourner en manifeste féministe ? Une petite fièvre d’espoir et d’humour corrosif avant d’entrer dans un des plus beaux film du festival, The City (1998) du New-Yorkais David Riker.
Petit calvaire et grande humanité.
Un film tourné sur une période de plus de cinq ans, à magnifiquement éclairé, pour un noir et blanc sans pathos venant saisir à vif l’univers des immigrés à New York. Riker s’est immergé dans cette communauté au jour le jour, il s’est mis à l’espagnol pour leur parler, les comprendre, puis en extraire quatre scénarios comme les fragments éclatés d’une fiction pleine du réel jusqu’au ventre.
Seamstress, ou la blessure d’une mère sciée par la distance, et qui, prise par les dettes, se bat simplement pour obtenir sa paye. The Pupetteer, marionettiste dans un théâtre de carton, qui vit au milieu d’un terrain vague et cherche à inscrire sa fille à l’école. Home, ou la merveilleuse intrusion dans un bal et dans l’amour d’un jeune mexicain pour son premier soir à New York. Bricks, ouvrant le film sur un décor post-nucléaire dans lequel des ouvriers se déchirent pour reconstruire des murs, un espace, un territoire.
Quatre bribes de vie pour s’imaginer le petit calvaire quotidien de l’immigration illégale, où les banales notions de normalité, de facilité ou d’évidence deviennent des spirales surréalistes peuplées de réseaux parallèles et d’intermédiaires. Un film à la beauté sobre, au cadre très composé, comme pour surélever par la mise en scène ces vies en marge du centre.
Ce plein d’humanité, The City le partageait en plein avec le Gouel ar filmoù qui l’acueillait. Pour sa 28ème édition, Douarnenez rafle à nouveau la mise du festival pour les yeux le plus convivial de l’été. Une réelle soif de montrer, faire comprendre et connaître en profondeur les peuples qui défilent sur ses écrans. Y aura-t-il pour la 29ème une aussi belle expo photo que celle de Laetitia Tura et Xolotl Salazar, sans parler des débats ou de la cantina sous orchestre festif, qui pourrait dire ? Un combat cinéphile qui partira l’an prochain chez les peuples des Balkans - préparez donc vos arrières.
Stéphane Mas
Articles récents
7 ans - Jean Pascal Hattu
Goya, les peintures noires - Yves Bonnefoy
I don’t want to sleep alone - Tsai Ming-liang
Les climats (Iklimler) - Nuri Bilge Ceylan
En avant, Jeunesse ! Juventude em marcha - Pedro Costa
Babel - Alejandro Gonzales Inarritu
The Host, conte écologique sur la paternité
© 2005 peauneuve.net - archives - liens - - haut de page