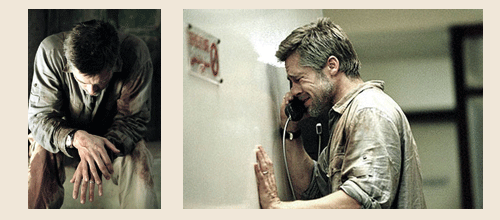Babel - Alejandro Gonzales InarrituTex-mex bible fiction ogre monster
Coup d’arrêt d’une trilogie entre vie et mort, Babel parachève le discours et la forme d’un cinéaste qui trouve sa mue dans la répétition. Une balle percute un trio d’histoires et de vies sur le fil de la mort. Des personnages en mal de parole, réduits à l’abandon chez un cinéaste jouant la corde par la caricature afin d’ouvrir sa langue aux foules d’Hollywood. La bible bien en bouche, Inarritu s’offre un portrait-monde du contemporain par l’Amérique du dehors, sous coutures post 9/11.Au départ était le verbe. Juste après le négoce, les armes, et peut-être un truc trouble qui ressemble à de l’amour. Cinq cent dirhams plus une chèvre pour décimer quelques chacals. Une poignée de corps à la poussière, au milieu d’un désert en plein vent. Deux frères bergers jouent avec un fusil que leur père vient d’acheter. Une balle sur un bout de rocher pour se défier à l’adresse, rendre manifeste leur rivalité. Ils pourraient être Abel et Caïn. Ils se nomment Ahmed et Youssef. Et leur sur n’est pas rousse, Zohra, qui sait dévoiler sa beauté ingénue.
L’innocence toujours coupable.
Inarritu s’attache aux racines. En quelques plans, c’est la bible aujourd’hui coupée d’un fantasme, un air d’accident. Des jeux d’enfants, en toute innocence. A la cible trop facile des rochers, quart de tour sur une cible vivante. Un bus blanc qui serpente sur une route en plongée. La chute, l’angle, l’incidence de l’innocence sur une vie qui bascule.
Inarritu et Arriaga, cinéaste et scénariste, pourrait-on dire comme s’il s’agissait d’un seul homme, conservent au centre de leur collaboration un noyau dur, une marque commune sur leur peau - l’innocence est toujours coupable. Seule change l’inclinaison du plan. A la nuit noire horizontale de 21 Grams correspond désormais le zénith sur les pierres marocaines. Qui n’a jamais dit que Babel cherchait à joindre Pise ?
What the boss says, you must do.
Amelia est une Mexicaine dévouée au bonheur de deux anges. Ils sont beaux, blonds et blancs. Elle est ronde, brune, hispanique. Une nourrice trop parfaite dans une grande maison sans parents près d’une ville frontière des Etats-Unis. Au téléphone, son patron impose des heures sup’ pour s’occuper des enfants. Plus longtemps que prévu. Rien d’inhabituel en somme, si ce n’était le mariage de son fils ce jour-là. Elle cherche à parer l’obstacle, argumente, rien n’y fait. Amelia gardera donc les enfants durant le mariage.
Inarritu sert d’abord la couleur. Des bruns sombres et ocres pour les frères du désert contre la transparence blanche des touristes. Le bus, la chemise, le visage de Cate Blanchett à travers la vitre. Tout est blanc immaculé chez ceux qui, en haut du bus, regardent les ombres noires courir à terre. Une bipolarité là-bas que l’on retrouve ailleurs pour mieux joindre les deux bouts d’un corps identique. Ainsi, à l’inverse du Maroc segmenté, organisé dans l’échelle des espaces, des langues et du social, le Mexique se fait passerelle et point de rencontre entre deux univers.
Bicolor Mexico : paradise of coke.
L’un bordé de sang, animal, presque indien, l’autre blanc couleur peau, purifié d’idéologie. Un territoire à la croisée de deux Amériques qu’Inarritu célèbre dans une mise en scène magnifique. Métissage de lumières, de décors surtout, d’un Mexique habité par l’Amérique jusqu’à se lover dans son coke. Les banderoles du mariage rappellent ainsi d’autant mieux les lianes blanches du cola coke que le couple Blanchett / Pitt apparaît pour la première fois à l’écran en pleine crise autour du breuvage à bulles bien connu.
Un couple à la déchirure blanche qui se teintera de rouge. Susan et Richard sont en voyage de deuil, voyage organisé auquel Inarritu prépare un coup fatal. Une balle en l’occurrence, et qu’importe si l’angle d’incidence semble par trop irréaliste, il n’empêche pas de toucher l’épaule dans un grand bruit d’éclat.
Raccord et des raccords. King of continuity.
Inarritu passe en maître au raccord. La preuve par trois pour trois raccords en un, le tout orchestré d’un magistral delayed effect. La balle, projectile au désert, devient ballon de volley chez les amis nippons. La détonation de l’arme, reprise par le smash en service de la jeune Chieko, claque le son pour un mouvement du ballon vers le haut s’opposant à la plongée de la balle vers la vitre. Grand art et dépendance, qu’on peut pousser plus loin lorsqu’on voit ces lignes blanches du terrain reprendre en plus subtil le rectangle blanc du bus. Qu’on peut pousser toujours, lorsqu’au cri d’une femme touchée par une balle correspond le silence d’une jeune fille sourde-muette qui la frappe, elle, la balle.
Montage et castration : empêcher/ajourner la jouissance.
Maroc, Mexique Japon. Un troisième lieu par le bruit, le mouvement, la stridence des sifflets d’un gymnase raccordant cut à la panique du bus. Le spectateur propulsé au japon bascule d’abord sans comprendre. Ce n’est qu’après le point, le choc analysé, que l’on trouve les échos. D’un côté comme de l’autre, touristes comme volleyeuses, tout le monde crie et personne n’entend.
L’émotion n’advient pas. Coupée dans son élan par un autre événement, un autre lieu, une autre séquence. Le principe même du film choral, exerçant ses coupes de montage avant l’événement, est ici décuplé par une coupe en plein centre, au plus haut du climax. L’événement comme éclat, suivi d’une coupe bien sèche empêchant l’empathie, l’identification, le sentiment d’advenir. Ou plutôt, leur ajournement. Car cette disparition tient en latence pour mieux reparaître plus tard, deux fois plus fort puisque l’on sait déjà et qu’on est en demande. L’effet créé, aussi simple qu’efficace, amène un vrai-faux désordre où chaque fin de séquence devient à son tour climax d’une autre séquence jumelle.
Motifs et caricatures - Du cinéma hollywoodien.
Jumelle d’un vaste monde où l’ironie pullule. Sévère contraste entre les photos de footballeur extraites d’un journal et placardées aux murs de la chambre d’Ahmed et Youssef contre la galerie d’écrans géants du bar branché où batifole Chieko. Sévère contraste encore, l’extrême pauvreté face à l’extrême richesse, une pauvre cabane en terre contre un balcon vitré d’une tour, de vilains policiers contre de gentils tex-mexs. Alors quoi ? Symbolisme appuyé, tiers-mondisme bobo, manichéisme bêta ? S’il tend lourd le bâton pour se faire battre fort, Inarritu fait pourtant bien place nette.
Niet, donc. Tous ces jeux-là d’échos, de contrastes, de rappels, sont là pour faire le jeu. D’une toile de caricatures, de traits forcés, grossiers, qui servent une fonction bien précise - l’identification la plus simple, la plus rapide possible avec le personnages. Les stéréotypes de chacun, donnés comme traits d’esquisse, vont s’affiner à mesure, subir la torsion du scénario. Des faits pour des raccords, la pointe aux lèvres en plus. Inarritu n’a pas besoin de 25 millions de dollars pour dire que riches comme pauvres font l’expérience du deuil. L’intention est ailleurs. A l’instar de Gaghan et Clooney, le cinéaste cherche plutôt à mettre en bouche d’Hollywood une chienne et solide petite mâchoire d’altérité.
L’adolescence en désarroi - Portrait d’une nippone en jeune nymphe.
Déjà dans Amores Perros, puis 21 Grams, Inarritu affichait sa science alerte en raccords. De même qu’il traitait le paradigme de l’innocence et de la culpabilité au cur de la culture américaine. Ou plus précisément, l’impossible pardon face à la culpabilité d’un paradis mis au saccage avant d’être perdu. Il en reste les corps, la bascule permanente entre la vie et la mort, pour un regard qui cette fois se déporte de la marge vers le centre. Exit la mère toxico et le taulard converti. Ne reste face caméra que de gentilles têtes blondes, une nourrice trop parfaite, une gamine pré-pubère.
La jeunesse nippone, fidèle à son iconographie, s’affiche technologique, digitale et branchée, avec une ombre en sus - elle est sourde et muette. Du moins Chieko, personnage principal dont le défaut de langue n’empêche pas le corps d’être surchargé de signes. Caricature bienveillante d’une ado portant la mini-jupe avec ou sans culotte, chaussettes blanches jusqu’aux genoux et hystérique à ses heures.
Une gamine ne cherchant ni plus ni moins que l’amour des garçons. Une presque jeune fille en quête de nourriture pour son monstre poilu. Ils sont trois qui frôleront son ardeur : un ado à mèches d’Elephant, un dentiste offusqué de pareille audace et un flic trop parfait. Inarritu saisit avec grâce l’adolescence au désarroi : une pulsion de vie dans un chaos très tendre, cette sensation aiguë d’être au mauvais endroit, hors du monde et des autres - la soif de vivre en toute candeur.
Babel de signes intérieurs/extérieurs - La survie.
De soi aux autres. Quand même dépêtrée du premier empêchement, celui de la langue, le contact ne prend pas. L’inadéquation est d’abord celle des signes. Chieko interprète mal la visite des policiers. Elle lit mal si les lèvres vont trop vite, et lorsqu’elle se dévoile entière, tout s’effondre et ne laisse dans la nuit qu’un corps vide, une chair verticale, pâle doublure en suspend d’une multitude d’immeubles. Toute la partie japonaise met ainsi en scène le gouffre entre un monde extérieur du trop plein (urbanité, technologie, communication) et une vie intérieure dévastée (de désir, de silence, de séparation).
Un conflit de l’individu face au collectif avec la survie pour seul objet. Problématique universelle qu’Inarritu transmue d’un raccord sec à l’autre bout du monde. Richard et Susan sont les doubles de Chieko. Des corps touchés au plus profond, sans aide, des corps qui battent le rouge, le blanc, le noir, dépourvus d’assistance pour extirper le mal. Si Chieko trouve la bienveillance, quand bien même impuissante, de ses amies et de son père, le couple Pitt / Blanchet se heurte à l’hostilité du groupe de touristes avec lesquels ils sont partis. Que reste t-il alors, si ce n’est Job maugréant l’abandon dans un coin de cette tour ?
Al otro lado, Babel de part et d’autre - Trilogie des frontières.
Le groupe est aveugle. Inarritu film du point de vue des victimes. Une femme blanche allongée sur une natte perd son sang près d’une vieille à la peau d’océan. Extirper la balle, recoudre à vif avec une aiguille brûlée à la flamme, sentir les regards, les mains, supplier que tout s’arrête. La femme est couchée dans l’unique pièce d’une maison de terre. A chaque angle de la pièce, un homme se tient là comme en veille. Des plans composés dans une épure de l’ombre qui rappèlent presque Pedro Costa. Bien plus tôt, Richard inaugurait une piéta contemporaine composée par l’envers. Cadré de dos, il portait Susan vers sa case, le bras tombant par terre.
Qu’est-ce donc là sinon un cinéma populaire à l’exigence démesurée ? Une exigence ramenant l’idée/le débat/la bible au centre du mainstream. Et s’il est peu question du peuple dans ce film des origines, sans doute est-ce parce qu’il n’en existe qu’un pour le cinéaste - le sien. Amores perros montrait le Mexique de l’intérieur. 21 grams s’attachait de même à l’intérieur de l’Amérique. Babel navigue de part et d’autre d’une frontera bordant Mexique et USA, des frontières au sens large, par ses thèmes, ses genres, ses rythmes.
Japan vs. Mexico - La caricature comme outil narratif.
La frontera d’Inarritu, mobile au zénith, s’étire le long de routes, de voitures, de musiques aux lourdes basses et de postes frontières. Un espace de chair et de sang où les corps s’embrassent, se serrent et se parlent sous poussière et lampions, dans un contraste total à la plastique lisse, géométrique du Japon. Ici l’on arrache la tête des poulets d’un tour de poignet dans les airs, les corps s’aiment et boivent tard pour une liesse collective aux fins de nuit difficiles.
Refusant de manquer le mariage de son fils pour garder ses têtes blondes, Amelia brave donc l’interdit du patron en confiant les bambins ricains à son mexicain de neveu. Le miroir s’inverse mais la méthode demeure. Inarritu love d’abord son spectateur dans un univers rassurant parce que reconnaissable (l’adolescence made in japan, le mariage sauce mexicaine) avant de précipiter l’ensemble au calvaire d’une émotion d’autant plus bouleversante que l’archaïsme qu’elle réveille en nous est extrêmement profond.
L’archaïque émotif - Double désert par deux fois.
Susan, Chieko et Amelia sont ainsi toutes trois confrontées à la plus archaïque des terreurs infantiles - l’abandon. Abandon physique et symbolique pour Susan au vu du passif de Richard en la matière, dédoublé au masculin chez Chieko qui a déjà perdu sa mère, total pour Amelia chargée de ses deux petits yankees. Un ressort émotif puissant parce que radical : pour chacune, comme un petit enfant, être abandonné revient simplement à mourir.
Le brio du tandem Inarritu/Arriaga consiste à déplier l’ensemble au décor. Parfait équivalent du ressenti émotif des personnages, le désert (intime pour Chieko, bien réel pour Amelia et Susan) résonne par ses échos bibliques - la fuite (Santiago), le crime (Ahmed et Youssef), l’errance surtout d’Amelia dans un espace invisible où Job semble partout présent. Un no man’s land horizontal brûlé de soleil, de mort lente (on pense au très beau Senorita Extraviata de Lourdes Portillo), trouvant son très beau double vertical et nocturne dans le désert urbain de Chieko.
Rythme & scénario sous clé de voûte hollywoodienne.
Babel déploie toute sa puissance dans le lien organique unissant écriture et mise en scène. Personnages, décors, évènements se mêlent ainsi par l’envers du contraste dans un rythme en bascule entre arrêt et mouvement, une ossature de scénario au fond très classique. Lente exposition, accélération brutale d’un événement-rupture, quête d’un retour à normal avant dénouement final, le tout multiplié par trois intrigues jumelles de corps et de propos.
Chacun finit rattrapé par son passé, le fer rouge de la culpabilité bien à vif sur la peau. Et le rythme de doubler le scénario dans sa forme de clé de voûte. Ainsi, aux plans fixes du début, puis à la légèreté, la vivacité de la deuxième partie, succèdent des plans de plus en plus longs, où l’émotion s’enfonce et s’étale à l’envie. En cela aussi, Inarritu tire ses recettes du classicisme hollywoodien - le face à face d’Amelia devant l’officier d’immigration, la dernière scène de Chieko avec le policier remplissent toutes deux parfaitement leur office de tire-larme.
Shooting pain through family.
La boucle d’origine reste sans doute la plus belle : deux gamins bergers prennent un bus pour ball-trap et deviennent des terroristes traqués par la police du monde. Inarritu s’enfile au passage une charge épaisse sur l’Amérique des pouvoirs intermédiaires. Une presse vorace d’info spectacle sans la moindre trace d’éthique, une police pavlovienne transpirant la violence, le soupçon et la paranoïa, toujours prompte à provoquer le passage à l’acte d’un individu d’abord et toujours présumé coupable.
Inarritu s’enfile aussi sur le mode des contraires la famille par le corps. Un couple tourne ses rides en tendresse (Amelia-Santiago) tandis qu’un autre renaît dans l’épreuve (Richard-Susan). Une mère redevient petite fille (Susan) alors qu’une ado peine à vivre sans la sienne (Chieko). Deux fils passent aux armes quand les pères sont soupçonnés du pire (le père de Chieko, celui d’Ahmed), et du côté des femmes, la farandole défile. Une reine mariée en blanc vole haut tandis qu’une autre en rouge erre en plein désert. Enfin Chieko, fragile reine noire, ne trouve à s’envoyer en l’air que d’une simple balançoire.
Le talion par l’ironie - presumed guilty - Homo americanus est.
Croisements d’épreuves poussées dans la survie, tous les fils de Babel salivent à la souffrance. Certains dénonceront donc ficelles à gros cordages, chantage émotif, parti-pris de bon ton. Inarritu les aura tous bien pris. Car si Babel agite les langues en spirale, il n’en est qu’une en contrefort - l’ironie mexicaine. Celle d’une balle en poitrine pour une femme en rupture, celle d’une jeune muette faisant parler sa bouche secrète, ou d’un Pitt en yankee n’ayant en gage d’amitié à offrir qu’une petite planche à billets.
Son destinataire sera le seul personnage dont le film taira le nom. Un guide faisant office de traducteur. Le seul donc à pouvoir communiquer dans Babel, capable d’opérer le passage d’une langue à une autre, quand bien même par le biais du mensonge. Un double du cinéaste donc, s’occupant à recoudre des fragments de langues et de peau comme Inarritu et consorts le font de leurs bouts d’histoires.
Cinéaste d’hollywood, bible sous coude à la frontière.
Babel s’avère donc tout sauf l’illustration chorale d’une mésentente des peuples. Ou plutôt, ce one-line-pitch pour producteurs sert justement de prétexte à montrer tout l’inverse - combien l’universel se retrouve non dans le nombre mais à l’intime de la souffrance et de l’abandon. Inarritu, plus que jamais, s’affirme donc cinéaste moral, obsédé d’une invisible articulation entre innocence et culpabilité.
S’il ausculte l’Amérique, c’est d’une lame entre coutures - intérieures dans 21 Grams, extérieures dans Babel. L’ensemble à la mâchoire d’un homo americanus peu à la fête puisque sa condition existentielle le réduit ici par ironie à n’être que flic ou touriste. Un prêté pour un rendu sans doute. il pour il, dent pour dent. Cerise de provoc sur un gâteau plein de sable, où l’émotion, quand bien même manipulée, finit toujours par advenir, et plutôt trois fois qu’une.
Inarritu signe donc avec Babel un film aussi accessible qu’ambitieux - populaire par ses veines dramatique et sensible, ambitieux moins par son abîme du biblique et du contemporain que par sa manière. Une mise en scène stupéfiante de précision, de fluidité, coupée d’un montage au grand art. Un film où l’innocence s’abîme par la bible au réel, chez un cinéaste mexicain en perpétuelle crise d’hainamoration vis à vis de l’Amérique. S’il y a bien deux frères, avec un il au centre, la balle est en plein jeu. Une balle traversant une vitre comme un avion percute une tour. Allégorie de l’Amérique post 9/11 par le désert, l’enfance et le couple, Babel assume son statut de grand film roublard et magnifique, rencontre d’Hollywood version Sirk sous le rire ogre du Mexique, avec de bout en bout, le cinéma pour seule langue.
Stéphane Mas
© 2005-2007 peauneuve.net - liens - - haut de page