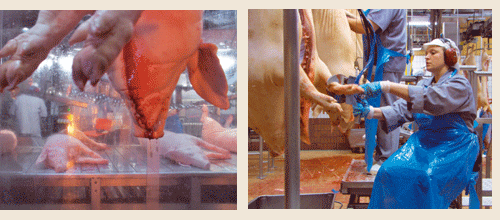Our daily bread - Nikolaus GeyrhalterChef d’œuvre bauhaus anti-économique
L’horreur économique agroalimentaire. Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter place sa caméra dans les plus grands groupes européens agricoles et filme sans commentaire employés, lieux et processus de productions. La réalité se mue en science fiction pour une inquiétante colonie pénitentiaire. Que reste t-il de l’industrie lorsqu’on la prive de discours, lorsqu’on la montre telle qu’en elle-même ? Un cauchemar à l’intrigante beauté formelle d’où l’humain disparaît peu à peu. Our daily bread dérange, inquiète et fascine. Un film d’horreur d’utilité publique.Un homme nettoie un rang de carcasses, la tête vers le bas comme les cochons saignés qui l’entourent. L’image lisse, équilibrée, cadre un banal aller et retour d’un employé dans sa tâche quotidienne. Sauf qu’en contraste à l’aller, le travelling arrière semble presque interminable, le tout dans un étrange bruit de fond.
Comme si dans son geste banal, s’assurant de l’hygiène nécessaire à l’industrie qui l’emploie, l’homme effaçait toute trace de ce qui s’était produit au cours de la journée. Comme s’il effaçait là quelque chose qu’il ne fallait pas voir, et que s’attèle à nous montrer Nikolaus Geyrhalter.
Le cinéaste autrichien est documentariste : il montre ce que l’on ne voit pas, donne à entendre ce qui ne s’entend pas. Ou comment l’industrie alimentaire, par souci de productivité hygiéniste, s’est depuis trente ans éloignée d’une réalité humaine pour entrer dans le monde de la science-fiction. Un monde assujetti à une logique et se dotant des outils nécessaires (techniques, infrastructures, mains d’œuvres) pour que les chiffres se plient aux exigences de rendement, d’hygiène et de sécurité.
Minimalisme de mise en scène contre gigantisme économique.
L’espace est immense, la science dévore la nature. Abattoirs métallisés, serres transparentes, champs démesurés, carrières abyssales. Il faut parfois deviner le sens des lieux, tant le gigantisme s’oppose ici à la réalité humaine de l’œil qui regarde. L’ingénierie technique s’accorde à la démesure de l’espace : des chariots sans chauffeur amènent des tomates dans un silence d’hôpital, des armées de moissonneuses batteuses parcourent les champs en colonnes, des tracteurs munis d’immenses pinces secouent dans un tremblement hystérique les troncs d’oliviers.
Le mouvement déborde la stupeur. D’un dispositif binaire oscillant entre le plan fixe et le travelling, le cinéaste se contente de suivre ou d’enregistrer les manœuvres. La mise en scène se réduit donc au choix des décors, de la lumière, au placement de la caméra surtout. Cela paraît mince ? Le résultat est inouï. Un formalisme aussi froid et aride que le processus filmé. Une esthétique industrielle où les lignes sont droites, parallèles, perpendiculaires. Un film de front, alliant minimalisme et sens du gigantesque - le grand Andréas Gursky a enfin trouvé son double cinéaste.
La violence comme caresse.
Le mouvement s’attache à la machine. Un défilé de chaînes, de tuyaux, d’outils, de tapis roulants surtout pour une affaire qui roule. Une mécanique rappelant de manière incongrue Les temps Modernes de Chaplin, dont Our Daily Bread constituerait le double contemporain, alimentaire et tragique. Car il y a bien de l’inéluctable dans ce glissement continuel de produits, d’aliments, de bétail où l’homme docile et mollement résigné, à l’inverse d’un Charlot, semble en permanence prêter son concours.
L’exercice implacable de la routine.
Car bien qu’il s’agisse d’élevage, la violence et la mort sont toujours en bout de chaîne. Violence d’autant plus dérangeante qu’elle s’exerce par des femmes aux mains expertes, machinales. L’une poinçonne des poussins, l’autre coupe des pieds, une troisième affine son couteau avant d’aller dépecer des cochons. Un défilé ininterrompu de séquences implacables sur la place de l’humain dans l’univers industriel.
Implacable car mis à l’œil du montage. En intercalant chaque séquence d’un personnage au travail avec un instant de non-travail, le plus souvent la pause repas, Nikolaus Geyrhalter opère le passage d’une non-vie à un début d’humanité. L’humanité par le regard, la parole, le rire parfois, quelques secondes seulement d’un film où priment la non-vie, le silence, l’indifférence qui règnent sur le lieu de travail. Comme si chaque employé n’avait pas conscience d’être l’instrument d’une gigantesque déshumanisation. Comme si tout allait de soi.
Colonie pénitentiaire.
L’homme adapté au rôle qu’on lui assigne. L’homme opérant, maillon remplaçable à tout moment d’une chaîne dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. L’homme pièce d’une machine qu’il emporte et finit par intégrer à son propre fonctionnement. Une fois leur travail accompli, les bouchers circulent dans les couloirs comme des bêtes qu’on mènerait à la louche.
Ce taylorisme moderne se double parfois de superbes moments de cinéma. Un couple s’avance le long d’un couloir où les poules mangent, pondent et défèquent sur deux niveaux. L’un à portée de main, l’autre plus haut d’un étage, pour lequel l’aide d’un chariot est nécessaire. Une structure visuelle décalquée plus tard dans la mise en scène d’un bus de l’usine. Et les hommes de figurer les poules, parqués sous les filets à bagages du niveau supérieur.
Le visuel enfonce des pointes. Instruments passifs d’une machine industrielle qu’on imagine pouvoir fonctionner sans eux, les hommes trient, récoltent, emballent et découpent. Ils donnent surtout la mort de l’exacte même manière qu’ils donnent la vie, rompus à leur routine. Une sorte d’immense et paisible colonie pénitentiaire où jamais une voix, un son ne semble plus haut qu’un autre.
Un chef de travaux habillé d’une veste kaki contrôle aux jumelles ses employés dans les champs. Entre eux, des chuchotements, des onomatopées, des bouts de phrases jamais traduits, tandis que la bande sonore continue son déballage de sons étouffés dans une lente symphonie d’infrabasses, d’engrenages mis en sourdine tout simplement comme les hommes.
Plus vite, moins cher, plus dur, plus beau.
Nikolaus Geyrhalter fait ainsi contraster la violence du fond et la presque douceur de surface, visuelle et sonore, pour un effet bien sûr décuplé. Car Our Daily Bread est au plus radical dans ses extrêmes : la naissance d’un veau par césarienne bovine, la mise à mort en chaîne des bœufs via l’échafaud, le viol comme norme de fécondation.
Pas de répit pour les braves. Nikolaus Geyrhalter ira jusqu’au bout, aux plus vaillants de suivre. Des lumières, des couleurs, des formes, des espaces. Passer des champs ouverts à une carrière monumentale, tombe étroite aux parois blanches sur un fond noir d’apocalypse, où des hommes grattent la terre et récoltent encore, raclent jusqu’aux tréfonds.
Le manque d’air au sous-sol vous pèse ? Vous prendrez bien un doigt d’aquaculture intensive. L’air, la terre puis l’eau. Les cycles se suivent et se ressemblent, avec au bout vous savez bien. Ironique pied de mise en scène, les poissons, eux, à la différence des porcs, finiront allongés au lieu d’être pendus.
La mort aux trousses des dents de la terre de King Vidor !
Ironie bien plus douce, les références au cinéma se glissent - alléluia - tout au long du cauchemar comme d’étranges bulles d’oxygène. Lorsque les dents non de la mer mais de métal fauchent les tournesols brûlés après récolte. Lorsqu’un avion déversant ses pesticides opère dans le ciel un virage identique à celui de La mort aux trousses. Lorsque des nettoyeurs aux blanches combinaisons désinfectent les serres sous de faux airs de Ghosbusters.
Le titre même du film rappelle son homonyme de 1934 dans lequel, par le biais de la fiction, le maître King Vidor mêlait art et idéologie. Las, à l’optimisme de Vidor succède l’horreur de Geyrhalter, les dents de la terre comme seule issue au triste couple collectivisme/capitalisme.
Le rire face à l’éclat.
De cette surenchère épuisante, le rire tient lieu d’ultime soupape. Un rire de film d’horreur, mis à distance pour ne pas être noyé. Deux ouvriers descendent au fond d’une carrière et laissent au film quelques secondes de burlesque. Car seul le rire peut à ce stade permettre de supporter les images qui vont suivre - le massacre des salles d’abattoirs, les sacs de chair ouverts.
Nikolaus Geyrhalter raccorde un savoir-faire narratif et formel d’une fluidité ahurissante pour mieux décalquer le discours scientiste à l’œuvre dans l’industrie alimentaire. La plastique parfaite du film imite ainsi l’arsenal idéologique, économique et législatif avec laquelle cette industrie se pavane à travers le globe.
Rêve capitaliste vs. cauchemar écologique, social, humain.
Face au seul critère exigé - produire plus vite et moins cher, que produirait un film semblable à chaque secteur d’activité industriel ? Quelle place laisser au spectateur, si ce n’est celle de la stupeur ?
L’industrie filmée par Geyrhalter, autre Cauchemar de Darwin, mais bien plus dur, n’appelant aucune polémique, révèle en silence une industrie fière jusqu’à la fissure de sa technicité, de son discours hygiéniste, de ses chiffres en queue de paon.
L’excédent agroalimentaire français représentait 8.7 milliards d’euros en 2004. Hors coût social, hors coût humain, hors coût écologique. Our Daily Bread suggère bien en hors-champ cette infernale triade ignorée des puissants. Eprouvant dans sa beauté, plastiquement parfait, le film de Nikolaus Geyrhalter ne se contente donc pas d’être un petit chef d’œuvre bauhaus. Plongé dans le réel, il devient acte politique, militant, et donc en cela d’autant plus que jamais nécessaire.
Stéphane Mas
© 2005-2007 peauneuve.net - liens - - haut de page