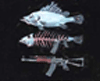
Le cauchemar de Darwin - Hubert SauperNoir, c’est noir
Une vision noire de l’Afrique pour un film magnifique, par ce qu’il montre et dévisse de systèmes aliénants, par sa mise en scène surtout. Perfiction du documentaire, ou comment faire du documentaire en l’insufflant de fiction.Un plan d’avion sur une surface bleue : le bleu du ciel et le noir de l’ombre. Hubert Sauper s’intéresse à l’ombre de l’avion, l’ombre dans l’Afrique, et ce n’est pas du ciel mais de l’eau qu’il s’agit. Première méprise d’une longue série que le cinéaste entend mettre à mal en nous ouvrant les yeux. Retour au sol. Sur la piste, des carcasses d’avions scratchés laissent entrevoir le défilé incessant des machines, tandis que dans la tour de contrôle un responsable du trafic aérien, affable, un journal à la main, s’acharne à détruire un insecte contre une vitre. Métaphore incroyable de tout un ordre absurde, inversé, qui semble régir l’Afrique et face auquel Hubert Sauper ne peut laisser lettre morte.
Mwanza, alias Fish city, est sur le bord du lac Victoria, en Tanzanie, l’endroit d’où sont issus tous les filets de perche du Nil de nos supermarchés. Pêchés dans l’eau par des noirs, transportés dans les airs par des blancs. A travers ce manège entre l’Europe et l’Afrique, entre capitalisme messianique et misère du monde, ce que choisit de filmer Sauper ce sont des hommes, des femmes en plein cauchemar. Eliza chante un mythe pris sous filet, paradis perdu qu’elle ne reverra pas Tanzania, Tanzania... Elle boit, s’abandonne au bas ventre de pilotes russes, elle fume beaucoup et ne tiendra pas longtemps. De ce trou mort en filets se retrouve, s’échange tout un monde interlope - prostituées, pilotes mercenaires, businessmen, politiques cyniques, toxicos adolescents, pour une misère si noire, si sombre qu’on n’oserait la filmer si elle n’était réelle. Un réel plus fort que la fiction, d’où le principe d’identification semble d’abord absent : impossible ici de se dire que tout n’était qu’un rêve. Bienvenue dans le cauchemar du réel.
Deux Afriques, deux cinémas, un combat.
Un cinéaste documentaire devrait se faire témoin du centre, englober un fragment de réalité, le transcrire en détail, par la longueur, l’insistance, avec le moins possible d’effets, de manigance, d’effets de manche. Aucun doute dans ce sens, Le Cauchemar est un documentaire. Si l’Afrique est un cancer, Sauper en montre l’ampleur, la progression, la démesure, pas à pas, plan par plan. Un film divisé en deux pôles autour desquels le scénario, l’enquête, la caméra s’avancent.
D’un côté la terre d’Afrique et ce lac Victoria, origine supposée du monde dont Sauper nous convainc qu’il porte aussi sa perte. Le cinéaste passe dans les villages, il en filme les acteurs : les pêcheurs, les prêtres, les ouvriers d’usine, menaçants, le couteau tranchant, des masques sur la bouche. Portrait d’une Afrique qui joue les règles - économiques, religieuses - et perd sur toute la ligne. Il filme ces jeunes adolescents défoncés à la colle, se battre comme des bêtes - littéralement - pour une ration de riz. Il filme aussi les décideurs. Cet homme d’origine indienne par exemple qui dirige la pêcherie et ne ment presque pas. Son bureau vide, très propre, mise sur la transparence. Il tire ses comptes, joue le capitalisme et constate l’invraisemblable : chaque jour, 55 tonnes de poissons pêchés en Tanzanie, bien trop chers pour les noirs, seront exportées vers l’Europe. On entend presque simultanément la demande de 17 millions de dollars d’aide alimentaire des Nations Unies pour lutter contre la famine dans ce même pays, cette même région.
Noir, c’est noir : le tranchant des coupes.
Inversion des valeurs et des systèmes que les politiques Africains, érigeant le cynisme en guise de politique générale, s’empressent de cautionner. Une scène suffit à passer des noirs aux blancs. Sauper décrypte le rôle des émissaires de l’Union Européenne en une séquence de quelques secondes. Tandis qu’ils se congratulent sur la pêcherie de Mwanza comme d’un bel exemple à suivre pour les futurs projets économiques locaux des pays émergeants, une légère ouverture du cadre permet d’apercevoir au bas de l’immeuble une troupe d’unijambistes se pressant dans les rues. Coupe sèche ; ou de la relativité des discours sur les jambes.
Mwanza ne serait rien sans la perche, rien sans les avions-cargos ni leurs équipages russes. Voici donc le versant de l’Afrique blanche, celle des chasseurs, des mercenaires. Serguey d’abord, figure de proue d’un Ilioutchine 76 faisant la navette entre Mangwa et la communauté européenne. Son équipage se compose de quadras mariés, la bouteille bien en main, arborant une nostalgie très russe lorsqu’ils regardent les images en DV de leurs femmes et enfants. Ils boivent beaucoup, chantent très faux et ne peuvent s’empêcher, peut-être parce qu’il est blanc comme eux, de prendre Sauper comme presque l’un des leurs. Ce travail du temps, Sauper l’articule au long cours. Il fait l’inventaire de l’exil, des souvenirs, puis montre les noces improbables de ces russes avec les prostituées de bars, il rentre à l’intérieur des chambres, s’immisce avec lenteur. Ils se dévoilent, ils hésitent, mais on aperçoit par incises comment, derrière la culpabilité qui les ronge, Sauper les guide, les mène lentement jusqu’à l’aveu.
De même, l’intérêt fabuleux du film repose entre deux pôles du cinéma : Sauper filme d’abord un documentaire. Il accumule des faits, confronte des points de vue, analyse les nuds, le fonctionnement des systèmes - religion, politique, libéralisme, permettant au spectateur d’avoir une vue d’ensemble. Mais cette distance des faits est toujours mêlée à la proximité de la fiction. La prostituée Eliza, le peintre Jonathan, le guerrier Raphael, le mercenaire Serguey, personnages réels et figures de théâtre, sont les acteurs d’un drame à la fois intime et collectif, dont l’exposition, l’enchevêtrement et le passage de l’un à l’autre, confèrent au film sa force rare.
Mise en scène et cinéma : l’artiste comme double.
De tous ses personnages, Sauper ne filme qu’un artiste : Jonathan, adolescent, peintre de son état, affirmant que dans son art comme dans la rue, dans son monde, son Afrique, la règle est celle du fight to survive. Le plan suivant montre un chant de femme pour mettre en terre un cercueil. Ces plans de coupe marquent tout au long du film un véritable art de cinéaste : exit le voyeurisme spectaculaire des cris, des coups, du sang. Sauper dramatise par échos, par touches, par contrastes entre ce qui est dit et ce qui est montré. Ainsi lorsque le patron de l’usine de la pêcherie active hilare son jouet mécanique en forme de perche, la queue du poisson bouge et une chanson retentit. Don’t worry, be happy. Lorsque le journaliste indépendant Richard Mgamba explique le gain financier induit par le doublé importation d’armes/exportation de poissons, lorsqu’il demande pourquoi l’Union Européenne et les Nations Unies tentent de guérir le mal au lieu d’essayer d’en empêcher l’apparition, un fantastique effet de réel charge le ciel d’éclairs. Menace physique sur une parole que personne ne veut entendre : nier la cause pour mieux s’occuper du symptôme. Médecine, social, politique, économie : l’axe du déni par isoloir mental se porte toujours bien.
Ce travail sur la mise en scène, sur le montage, révèle donc avant tout un cinéaste. Un homme tire d’un antique filet des poissons de toutes tailles, puis un léger mouvement vers l’arrière permet de lire un nom à l’étrave de la barque : Jesus. De la bible, le cauchemar ne garde que l’enfer de l’ancien testament. Sauper ramène cet enfer au western, avec pour seule arme visible l’arc et les flèches enduites de poison de Raphael. Lui seul concentre le regard fou d’une fiction. Il garde pour 1$ la nuit les entrepôts de la compagnie de pêche. « You must be ready for fight », dit-il l’il menaçant. Il parle de guerre, la souhaite, l’espère même. Une guerre, synonyme de fonds occultes provenant de régimes pour qui l’argent ne manque jamais. Se faire soldat, être payé, vivre et manger à sa faim, quitte à laisser des morts. Quel mal à cela ?
Abyme et politique.
Les politiques ne sont donc pas en reste. Collusion des pouvoirs locaux à l’exploitation libre et non faussée de leurs pays, de leurs peuple, les dirigeants agissent souvent sous la férule d’un pouvoir religieux collaborateur dans l’âme. Ils se débattent mollement, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes commanditaires du suicide collectif. Ainsi cette scène de mise en abyme où, filmant caméra cachée, Sauper montre la diffusion d’un documentaire expliquant les dommages irréversibles de la perche sur le lac Victoria. La scène se déroule lors d’un congrès écologique au Kenya devant un parterre de politiques parés comme des maquereaux. Le temps de quelques secondes, on retrouve le commentaire expressionniste, la voix gonflée de testostérone, la surdramatisation de tout un pan des documentaires u.s. Le verdict est pourtant sans appel : à ce rythme, l’écosystème du plus grand lac de Tanzanie sera bientôt irréversiblement détruit. On aimerait voir l’indignation sur les visages de dirigeants. Que nenni. L’un d’entre eux se contente d’une plainte contre les effets négatifs d’un tel document sur l’avenir économique de la région. « We are here to sell our countries. Why only show the negative aspects ? » .
Ouvrir à l’aveu : filmer le temps du documentaire.
Aussi vrai que le documentaire inséré à l’intérieur du cauchemar est bavard, Sauper au contraire, à travers les silences, les plans vides, met en scène la patience nécessaire à l’aveu. Durant les premières conversations avec l’équipe de pilotes russes, il se contente d’observer, de placer quelques inserts, et l’on devine à mesure comme il traque. Il se prépare, se couvre, s’avance à petits pas avant d’embrayer lentement. Tout son travail d’enquête à l’intérieur de ce monde s’en ressent à l’écran, faisant de cette lente progression vers l’aveu, vers l’humain, une des grandes forces du film. De même, lorsque le prêtre applique à la lettre le génocide catholique en matière de préservatifs. Un fondu au noir en dit plus que cent commentaires. Sauper conserve donc les codes du documentaire mais filme en cinéaste. Sa grammaire évolue sans cesse : plan séquence en portrait, caméra à l’épaule en extérieurs dans les villages de pêcheurs, travellings dans les rues de Mwanza, mise en abyme, caméra cachée, tous les moyens sont bons. Il veut tout prendre, ne rien laisser. Le monteur seul reconnaîtra les siens.
Qui viendra mettre fin ?
Dans l’usine de traitement des poissons, une fois la tête arrachée, le poisson est emballé, mis sous barquette, sous cellophane, expédié pour l’Europe. Les déchets, seulement eux, resteront en Afrique. L’emballage sera brûlé, transformé en colle toxique sniffée par de jeunes adolescent à la rue, tandis que les queues, les têtes, le pourri seront brûlés, mis à sécher sur des barrières de bois, dans un charnier grouillant de vers où ceux qui travaillent se décomposent à l’ammoniac. Les enfants, les femmes, se nourrissent des ordures de l’usine. Ils y perdent parfois un il. Les hommes encore valides plongent au lac pour rabattre les perches. Ils y croisent parfois des crocodiles pour y perdre une jambe. Ceux qui n’ont plus la force consomment trop d’alcool, de prostitution, et finissent par abandonner ces enfants qu’ils ne peuvent pas nourrir. L’Afrique noire, sans qu’il ne soit question de peau, l’Afrique des Misérables, où l’on vendrait ses dents pour se nourrir de pain, cette Afrique là est aussi celle d’aujourd’hui. Dont acte.
Même s’il y ressemble parfois, le Cauchemar n’est pas un traité d’hygiène mentale dix-huitièmiste. Alors comment faire accepter au spectateur cet enchaînement du pire ? Comment le faire tenir jusqu’au bout ? Comment ne pas le plomber face à une telle noirceur du réel ? Par la mise en lumière de la fiction, à l’intérieur même du réel. Jonathan a choisi la peinture - compositions brutes, couleurs fauves, cadre naïf pour mettre ce cauchemar en couleurs. Des carrefours à la nuit, des enfants qui dorment dehors, des combats de rue. Puis cette toile où des noirs portent les perches du lac jusqu’aux avions-cargos, mais sur sa toile, on ne voit plus des poissons, mais des obus.
Tout le film s’attache à ce trait. D’un coup de pinceau surgit l’impensable. Ce n’est pas simplement un avion qui atterrit, décharge son aide humanitaire et décolle le lendemain avec 50 tonnes de poisson frais. Ce n’est pas simplement d’exporter vers l’Europe sa richesse quand son propre peuple meurt de faim, il y mieux. Les avions n’avaient pas à leur bord que la nourriture qui permettait aux réfugiés de vivre la journée. Ils transportaient aussi les armes qui les tuaient la nuit.
La toile de Jonathan reprend donc le film de Sauper, chacun trouvant dans son art un même besoin de montrer, de sortir au dehors. Utiliser des codes - pour le cinéaste, la mise en scène de fiction, la rigueur du documentaire - afin d’être témoin d’une horreur qui, pour une fois, s’échappe de l’abstraction des mots (libéralisme, mondialisation, concurrence non faussée) pour rentrer dans les corps, les vies d’hommes et de femmes qui font face. Le résultat est bouleversant.
Stéphane Mas
Articles récents
La forêt de Mogari - Naomi Kawase
Alexandra - Alexandre Sokourov
Paranoid Park - Gus Van Sant
4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007)
Control - Anton Corbijn (Prix Label Europa Cinéma à la Quinzaine)
Garage - Lenny Abrahamson (Prix Art et Essai à la Quinzaine)
Festival de Cannes - Bilan du 60ème (part one)
© 2005-2007 peauneuve.net - plan du site - liens - - haut de page



