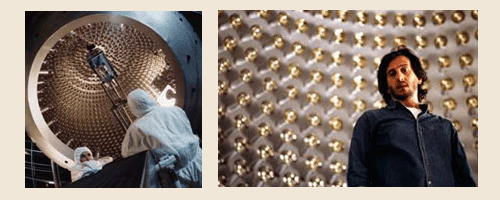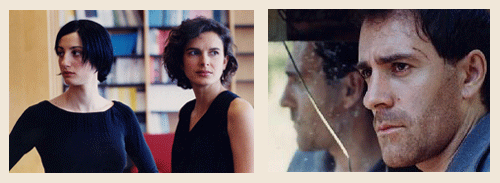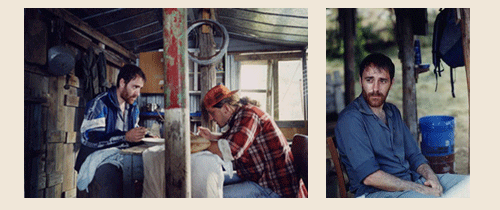L’horizonte degli eventi - Daniele Vicari.Physique nucléaire d’un moderne archaïque.
Le film s’ouvre sur un cran d’arrêt lame ouverte, plaqué sur une poche arrière. Un film par l’arrière, pour chercher à comprendre, le cadre plaqué sur le souffle d’un homme qui court dans sa fuite après en avoir tué un autre. Il sera donc question de perte, d’amour, d’ombre et de fuite, d’un passage de la mort à la vie, du fantasme de toute puissance au réel, par une mise en scène proprement ahurissante de maîtrise. Un grand cinéaste est né, jouant du mythe en plein cur de la modernité.Max est un chercheur scientifique en physique nucléaire. Appuyé par le professeur Revelli, il est en passe de prendre la tête du programme de recherche Hélios, quelques semaines seulement avant la tenue d’une conférence internationale sur les neutrinos où son équipe doit faire bonne figure face aux chercheurs étrangers. Difficile de rentrer dans ce personnage qui lors de l’enterrement de son père, croise son frère à qui il n’adresse que quelques mots glacés. Une haine froide et profonde.
La mise en scène la reflète dans les couloirs, les murs dénudées des appartements, les courbes de béton du laboratoire sous terrain où travaille Max nuit et jour. Vêtus de combinaisons blanches immaculées, les scientifiques parlent d’huile, d’eau pure, de citernes de refroidissements, sous un large panoramique en 360° d’une cuve entièrement couverte de petites lampes ocres. En toile sonore, le bruit des machines, des larsens en stridence, de lourdes basses qui résonnent.
Périphérique et sous-terrain.
Daniele Vicari insiste avant tout sur l’arrière plan, l’atmosphère. Refusant toute explication pour faciliter l’entrée du spectateur dans son film, il filme la tension sourde, le secret, le mouvement vers l’avant. Vieux sage et figure paternelle inversée du vrai père de Max, le professeur Revelli affirme « qu’il faut vivre avec le doute et l’ignorance », la liberté la plus importante étant celle de « pouvoir lutter contre toutes ces certitudes qui paraissent des vérités » alors qu’elle ne sont en réalité que des croyances.
Vicari applique ce point de vue scientifique à la construction du film. Adaptant son scénario et sa mise en scène à l’activité de son protagoniste, le réalisateur place le spectateur dans une position identique à celle de Max - il cherche à comprendre, analyser, dévisser les indices, les traces, les faits qu’on lui distille au compte goutte. Cette manière d’éviter le centre du personnage - sa parole, ses pensées, pour l’aborder par sa périphérie, son environnement visuel et sonore, Vicari l’applique sans retenue et jusqu’au bout, conférant à son film une très forte intensité.
Homme moderne et fission amoureuse.
Max ne parle pas, il dirige et s’impose. A l’instar du personnage, la mise en scène est sèche et tranchante. On passe ainsi des poussière d’un chantier à un corps nu d’Anaïs, principale collaboratrice avec qui Max entretient une liaison. Présence/absence. Un amour de fission en quelque sorte, Max étant incapable, même après l’amour, de dormir aux côté d’Anaïs, comme auprès de quiconque, ajoute-t-il aussitôt. Cet détail cerne l’ensemble : une sorte de surhomme dénué de sentiment, laconique, cérébral et ambitieux, exigeant des autres ce qu’il s’impose à lui-même par orgueil.
A mesure que la conférence approche, la pression compétitivité/résultats se traduit par les sons : l’association des basses à des carillons synthétiques entretient une tension, palpable également sur les êtres. Tandis qu’Anaïs cherche l’amour, Max est en quête de pouvoir.
Ce double mouvement de forces inconciliables se cristallise dans l’admirable scène du repas, où deux univers s’affrontent. D’un côté la parole, le raisonnement, les justifications d’un homme enclin au virtuel, de l’autre la ligne droite, infranchissable d’une femme défendant une éthique. Et c’est précisément là, dans l’attention portée aux détails - lumières, peintures, statuettes en bois décorant l’appartement d’Anaïs, que le film trouve sa force, sa gageure, et s’affirme autant moderne qu’archaïque.
Mort et renaissance : place au mythe.
Max a failli, il a franchi la ligne. Programmé pour réussir, il ne peut accepter la faute, l’échec. Une impasse intérieure que Vicare matérialise grâce au modèle de la fuite qui ne mène nulle part, grand classique du cinéma. Quelques minutes pour fondre vitesse, perte et danger, dans une superposition lumière/marquage au sol, présent/passé proprement époustouflante, tant par sa qualité visuelle que sonore. L’accident - inévitable - et la disparition de la voiture-épave sous la forêt préfigurent donc une reconversion. En passant du l’univers sous-terrain à l’espace du dehors, le film dessine le mouvement d’une renaissance.
Recueilli dans une cabane en tôle, Max découvre le réel - le sang, la faim, la souffrance physique. Cloué sur un lit, enfermé au cadenas, à moitié prisonnier, il entame au sens le plus littéral qui soit le mouvement de la naissance, celui de la descente. Inutile d’insister sur le sous-texte biblique. Son sauveur, un berger, est aussi geôlier. Un albanais clandestin lui même pieds et poings liés à la mafia locale. Au milieu de la roche blanche et verte du Gran Rosso, Max renaît à l’archaïsme - la traite des bêtes, le froid, la tempête et le risque de mort. Il prend conscience du temps, tout autant de l’espace, forçant le film au silence, à un rythme plus lent.
Ecce homo.
Un homme est une bouche à nourrir. De ce présupposé, Vicare décide de traiter au plus sobre la relation entre les deux personnages. S’ils s’apprécient, l’un reste une charge pour l’autre. Incapable de marcher, pas même bon à faire une soupe, Max descend jusqu’à l’humilité, jusqu’à marcher avec les chaussures d’un mort. Son sevrage terminé, il entreprend son retour aux monde, et c’est peut-être là, dans cette tout dernière partie, que le film est le plus bouleversant.
Ce n’est que dans les derniers plans que sera décryptée la scène d’ouverture du film. Dans son trajet de retour en bus, Max redécouvre le banal, l’anodin, le bruit et la mêlée des corps. Il semble alors comprendre par la perte et le deuil ce qu’être humain signifie vraiment. Une fin dont la grammaire visuelle, toujours extrêmement sobre, reprend le film entier, la ville inondée d’un bleu sombre s’opposant aux scènes de montagne prises entre marron, vert et blanc.
Ce traitement des couleurs, le travail du son, et surtout la qualité de sa dernière partie, confèrent donc au film de Daniele Vicari une densité, une dimension mythologique qui, sur un sujet identique à celui de Castaway, renvoie les Robinsonades de Tom Hanks très loin derrière. D’abord parce que ce n’est pas seul mais grâce à l’intervention d’un tiers que Max parvient à survivre. On quitte donc le mythe occidental du surhomme pour un point de vue plus humble - l’homme n’est rien sans les autres, il lui faut composer avec cette dépendance. Enfin parce que le film, par sa forme brute et intense, démontre un savoir faire de cinéaste tout simplement à couper le souffle.
Stéphane Mas
Articles récents
La forêt de Mogari - Naomi Kawase
Alexandra - Alexandre Sokourov
Paranoid Park - Gus Van Sant
4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007)
Control - Anton Corbijn (Prix Label Europa Cinéma à la Quinzaine)
Garage - Lenny Abrahamson (Prix Art et Essai à la Quinzaine)
Festival de Cannes - Bilan du 60ème (part one)
© 2005-2007 peauneuve.net - plan du site - liens - - haut de page