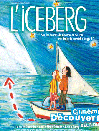
L’iceberg - Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno RomyHurluberlu burlesque belge
Tati en embuscade, L’iceberg éclabousse le cinéma d’aujourd’hui par un grand bond en arrière. Un cinéma de bouts de ficelles pour un combat inégal - Bretagne plus Belgique contre reste du monde. Un retour aux sources du burlesque avec des corps de clowns déléguant la parole aux Inuits. Une histoire d’amour prenant l’eau de toute part, croisant dans ses décors en carton le cirque, l’animation et le muet via Buster Keaton. Grande lucarne d’imaginaire décalé dans un petit monde de brutes. L’iceberg ou l’innocence bobo ?Au départ était Tati - l’univers géométrique, lisse, minuté d’une économie semblable à son architecture : lignes droites, couleurs tranchées, sans écart ni angle. Qu’il s’agisse du travail ou de la maison, Fiona maîtrise son asphyxie avec grand savoir faire. Le travail, c’est la santé. Prise de remord à l’idée d’un oubli, elle revient sur ses pas et s’enferme dans une chambre froide. Signe manifeste ou latent d’ironie politique, c’est à son écharpe rouge que la manager se retrouve pendue, prise à la gorge, otage d’une porte-hublot.
Travail, santé glacée.
Un l en moins et reparaît Hulot, dont les auteurs offrent ici une version amoureuse, aquatique et glaciaire. L’expérience du grand froid fait parfois naître d’insoupçonnés désirs. Fuyant mari, enfants et foyer, notre manager délaisse sa dignité confortable pour l’aventure amoureuse, initiation qui la verra s’essayer avec malice à l’escalade progressive de ses objets du désir - le freezer, le marin, l’iceberg enfin.
Fiona, René et Julien. Trois personnages épigones décalés d’un formule narrative en vogue depuis quelques siècles - une femme délaisse son besogneux de mari pour tenter fortune avec un autre. Au départ de la quête, convenons-en, un iceberg aux proportions phalliques fort avenantes. Fiona tombera ensuite amoureuse de René, marin solitaire, sourd et ne sachant pas nager, tandis que Julien, mari délaissé, poursuivra désespérément sa femme contre vents et marées.
Le corps, doublure de langage.
L’une s’enfuit, l’autre pêche, le dernier suit, mais presque aucun ne parle. Des personnages quasi muets contraints donc d’utiliser leurs corps pour pouvoir s’exprimer. Un parti pris rappelant Tati bien sûr, mais surtout l’alliance du cirque avec le cinéma d’avant-guerre, Keaton en tête. Il s’agit de montrer, faire spectacle en ne partant de rien. Un minimalisme au pied de la lettre allié à un sens très sûr du corps comme premier vecteur du comique. Un réveil, un bâillement infini, une séance d’habillage somnambulique pour un porte-manteau polaire : trois plans, un personnage. Ni plus, ni moins.
Autant dire que la science, quand bien même minimale, s’avère huilée comme une petite quiberonnaise. Les cous du troisième âge jouant Wimbledon entre le suicide et la vie, l’admirable scène de la sculpture sous drap contiennent cette inventivité d’un comique faisant mouche sans effort. Une écriture où la mise bout à bout de séquences presque indépendantes n’empêche pas la fulgurance burlesque. L’escarpin patineur de la chambre froide, la sortie momifiée du carton, l’agression à l’ancre formant ainsi un corpus idéal de scènes cultes pour l’amateur éclairé.
Slapstick burlesque - hurluberlus et consorts.
Le corps avale les dialogues, un corps burlesque redoublant son pouvoir comique par l’immédiateté de son langage. Sans doute faut-il en chercher l’origine chez Mack Sennett et ses slapstick comedies. Un visage noirci par des explosifs, une course poursuite dilatée dans le temps pour un minuscule habitacle, un corps boiteux raide comme une paire d’échasses. Rire d’autant plus efficace qu’il ramène à l’enfance, à son innocence radicale. Fiona emprunte à Buster Keaton son visage stoïque en toute circonstance et rafle d’emblée la mise : le burlesque comme mutation du banal déformé par l’outrance.
La mise en scène continue cette épure immédiate du comique par des plans fixes assez larges où le cadre ligne claire s’envisage d’abord et surtout comme scène de théâtre. Le mouvement cédant le pas aux transparences, l’humour se mue clin d’il et Fiona intrépide navigatrice rappelle James Stewart au volant dans North by Northwest. Reste que ces décors construits avec un goût certain du kitsch, auréolés du label rouge artisanal, posent tout de même en sous-main la question de quel cinéma faire aujourd’hui.
Le malentendu nostalgique.
Certes, le minimalisme, poinçon du film, traverse les décors, la lumière, la structure même du film. L’humour surtout distille cette fraîcheur du punch propre au cinéma muet et d’animation. Mais vient toujours un temps où le défilé de gags doit cesser. Une respiration nécessaire aux personnages pour qu’ils sortent du papier, de la pellicule, pour exister vraiment. Seul bémol donc, les scènes de Barfleur peinent à convaincre tout à fait. Comme si L’iceberg, si proche de l’univers de Tati, devait aussi porter le malentendu nostalgique longtemps reproché au créateur de Jour de fête.
Barfleur porte sa poésie particulière d’un village d’irréductibles où la vie douce s’organise au café, entre des vieux tous gentils et un maire en écharpe pratiquant la taille forcenée de crayons. Une sorte d’éden breton d’un temps bien révolu où il suffisait de botter le cul de la jeunesse pour que docile, elle obéisse aux injonctions des adultes. Où hommes et femmes s’aimaient et partaient vivre d’amour dans un rêve animé d’eau fraîche sous une gentille caméra en plan fixe.
Social teinture jaune pour le rire. Du grain dans le lissage.
Cette partie Barfleur (la moins convaincante), plus proche des Deschiens, n’offre qu’une satire tendre mais plate d’une carte postale vieille France sans réel point de vue. Plus fine apparaît en revanche la relation entre Fiona et son hôte septuagénaire qui lui offrira son maillot de bain vert mythique de chez Daxon grande collection. Plus ambiguë aussi, ses rapports avec les hommes cherchant après elle un goût de vie à laquelle tous deux semblent autant étrangers l’un que l’autre.
Le rire serait donc la partie émergée de L’iceberg. Sous la blancheur des dents, apparaît un portrait plus doux-amère du couple. Comme dans Mon oncle, les personnages moitié aveugles, moitié sourds, sont avant tout de merveilleux inadaptés. On croirait voir ainsi les Arpel, pour qui vivre ensemble reviendrait à ne pas se parler (Fiona/Julien), à ne pas se toucher ou à ne pas s’entendre (Fiona/René). Sauf qu’ici, la douleur du mari, bien réelle, se fait jour à l’écran, comme par intermittence, revenant sans cesse à l’assaut en parodie de film d’horreur.
Sociologie du couple comme sport de glisse et de combat.
Au propre comme au figuré, le personnage de Julien diminue, passant du visible à l’invisible, du bateau à l’annexe, du principal à l’accessoire. L’iceberg, plus exigeant qu’il n’y paraît, s’envisage alors en sociologie comique du couple comme sport de glisse et de combat. On y trouvera en vrac surprise d’anniversaire avant-coureuse de dépression, mode inédit d’anti-communication par les couettes, fusées de sauvetage lancées à l’aveugle pour bouquet d’artifice en plein océan.
Il faut donc parler poésie. Un carton pâte artisanal qui agacera certains par son kitsch désuet tandis qu’il ravira les autres par sa merveilleuse fraîcheur. Quant à la régression, elle s’assume par le pouce. Celui de René mais aussi des auteurs dans la séquence de la reconduite aux frontières. Une sorte de défense préventive face à l’accusation d’un passéisme trouvant refuge dans l’imaginaire, quand la séquence opère justement ce point de jonction entre réel et imaginaire.
D’un corps pouvant comme les trains en cacher un autre, Fiona et le petit noir tournent autour de l’agent comme le film autour du réel. Une manière d’affirmer à son corps défendant que le réel est là, loin d’être oublié (mais qu’il est parfois bon d’y mettre des parenthèses). L’iceberg rejoint alors Aki Kaurismaki et son Homme sans passé - un cinéma de l’improbable, amoureux de l’absurde pour un burlesque des glaces. Un cinéma aux frontières du théâtre, prônant cette forme particulière de l’innocence qu’on appelle aussi l’ émerveillement.
Stéphane Mas
Articles récents
La forêt de Mogari - Naomi Kawase
Alexandra - Alexandre Sokourov
Paranoid Park - Gus Van Sant
4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007)
Control - Anton Corbijn (Prix Label Europa Cinéma à la Quinzaine)
Garage - Lenny Abrahamson (Prix Art et Essai à la Quinzaine)
Festival de Cannes - Bilan du 60ème (part one)
© 2005-2007 peauneuve.net - plan du site - liens - - haut de page




