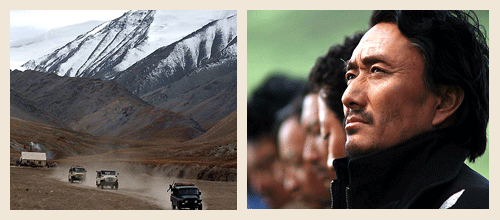Kekexili - Chuan LuWestern oldschool au pays des yaks
Jouer du western pour en saisir la substantifique moelle. Un western sans chevaux mais rempli de carcasses d’antilopes, le ventre et la bouche ouverts. Chuan Lu pratique l’intensité sèche et aride, dans une mise en scène, une narration aussi simples qu’efficaces, dégraissant la violence de tout esthétisme. Qui parle d’écologie ? Un film où l’on hache le corps d’un mort pour le laisser aux vautours, où un homme embrasse la femme qu’il aime avant d’être avalé par la terre, tandis que d’autres plus loin meurent lentement de froid.Un homme qui dort au volant, immobile, est menacé par une kalachnikov, avant d’être abattu comme une bête quelques minutes plus tard. Autour de lui, des dizaines de corps livides d’animaux jonchent le sol en désordre. L’ouverture de Kekexili concentre en quelques plans le cur du film : tension, violence et mutisme pour un western filmé à 4700 m d’altitude. Au milieu des rapaces, des morts et des déserts, une traque sans merci entre une étrange patrouille et de vrais braconniers.
Ampoule narrative et gratitude.
L’histoire est pourtant vraie. En quelques décennies, suite aux ravages du braconnage, le nombre des antilopes du Tibet sur le Kekexili est en effet passé de plus d’un million à moins de 20 000 têtes. Pendant les années 90, la patrouille de montagne dirigée par Ritai, composée de volontaires souvent non rémunérés par l’état, s’est bien livré à un combat contre les braconniers afin que le Kekexili devienne une zone protégée.
Commençons par le pire. Ce basculement entre le vrai et le faux, le réel et la fiction, est à la base du film et constitue son seul vrai défaut. Suite au meurtre de l’ouverture, le journaliste Ga Yu, double du spectateur, suit Ritai dans sa traque des braconniers jusqu’au confins du Kekexili afin de réaliser un reportage photo, lequel sera la base du vrai travail de Chuan Lu écrivant son scénario. En signe de gratitude, le cinéaste choisit donc de faire de Ga Yu le narrateur du film. Une intention louable qui offre un cadre narratif semblable au personnage, inutile et maladroit, s’accordant mal à l’intensité sèche du film.
Tibet - Mexique : un désert sous la neige.
Car le Tibet de Kekexili a aussi peu à voir avec celui d’Hergé et de Tintin que l’Antilope locale avec un cochon d’inde en cage. Il serait davantage sous les neiges et les glaces un parent lointain des déserts mexicains de Sergio Leone : même transformation d’un décor exotique en piège infernal. Même étendue immense où la beauté cède vite la place à l’horreur, se transformant en univers hostile et implacable pour tout homme s’y aventurant.
Avec le motif de la traque au centre du film, les hommes sont des trappeurs qui reniflent la terre, interprètent les indices et laissent des traces de leurs passages. Un western sans chevaux mais dont les 4x4 évoluant sur la piste, en plus de rouler, s’enlisent, s’ébrouent, meurent presque et continuent d’agoniser - des bêtes qu’on achève par le feu lorsqu’il le faut, s’assurant ainsi qu’ils ne serviront pas l’ennemi.
Archaïsme et austérité. L’humain fluor plus
Ritai est construit en contraste de ses hommes. A son austérité correspond la simplicité, la joie, la fraternité de personnages à peine entrés dans l’âge adulte, tous engagés volontaires, le rire aussi blanc qu’un dentifrice. On s’attache à ces corps, à l’innocence qu’ils représentent, d’autant plus vite que le froid les rappelle dans de très belles scènes de danse et de chant. Une simplicité qui, rapprochant le film du documentaire, permet aussi de décupler le basculement vers le drame, la violence et la mort.
Il y a bien du Traffic de Soderbergh dans ce jeu entre poussière et lumière, d’une mise en scène tantôt très proche des corps, tantôt très distanciée. Par son propos, ses conditions de tournage, le film revendique par ailleurs un dénuement qui, des personnages à la mise en scène, réinvente avec force l’effet de réel au cinéma.
Une sorte d’archaïsme, de force brute extrêmement efficace habite ainsi la mise en scène. Un plan rapproché sur les bottes des hommes de la patrouille qui marchent puis soudain se mettent à courir, ou cette scène magnifique dans laquelle tous doivent se déchausser afin traverser le fleuve en caleçon.
Trafic d’influences : visite d’une iconographie.
Au-delà de la simple citation, Chuan Lu se réapproprie le western pour en travailler l’iconographie, s’autorisant l’humour et parfois l’émotion. Le passage du gué, l’enlisement du convoi, ou encore cette scène avec des dizaines de carcasses d’antilopes éparpillées sur le sol, reprise et décuplée plus tard avec cette fois des centaines de peaux éparpillées, comme pour donner mesure de l’étendue des massacres.
On se rappelle les corps d’indiens jonchant le sol dans Little Big Man d’Arthur Penn. Echos, métonymies, répétitions. La mise en scène travaille son ouvrage, reborde ses coutures pour un très bel hommage au genre.
Que dire donc de l’espace ? Chuan Lu ne cède pas au piège de l’illustration et parvient à fondre sans pose dans son récit les paysages magnifiques du Kekexili. Peut-être est-ce dû au support DV d’origine, au manque de profondeur de champ. Reste un paysage massif et austère dont l’entrée dans le cadre, souvent morcelée, figure surtout le caractère agressif d’une nature impitoyable pour l’homme.
Autant sinon plus qu’à la dimension visuelle de l’espace, Chuan Lu reprend du western l’importance de l’environnement sonore. Les sons de cliquetis rappellent durant toute la première partie la présence des prisonniers dans les véhicules. Puis viennent le vent, la musique off et les différents chants qui rythment la vie des hommes de la patrouille. Témoignages de la culture traditionnelle tibétaine, ils participent surtout à cette mystique de l’espace propre aux lieux. Comme si le chant, au-delà de son rôle dans la cohésion du groupe et la transmission d’une culture, enjoignait la nature à plus de clémence.
On achève bien les chevaux. Mouvement et disparition.
Comme tout bon western, Kekexili joue constamment sur l’alternance entre immobilité et mouvement. Dès que le temps, les personnages, les lieux se figent, l’action s’apprête à surgir. Chaque instant de calme n’est qu’une respiration dans un film qui, à l’image de personnages pris dans le froid et les glaces, se doit d’être en mouvement pour continuer à vivre.
Ce double mouvement de la disparition et du dénuement habite le film entier, dans sa forme comme dans son style, jusqu’au sommet visuel de la scène des sables mouvants. La disparition des antilopes fait écho à celle des hommes. Disparition du regard, puisque pas une seule fois le spectateur ne verra l’antilope. Disparition des corps, qu’il suit le souffle court, pas à pas.
Chuan Lu dilate le suspense dans l’espace et le temps. Les personnages subissent de plus en plus de privations à mesure que la traque avance. Ils manquent d’abord d’essence, d’eau et de nourriture, d’argent puis d’armes, jusqu’à finir à pieds, titubant dans les glaces, dans une lente agonie.
La nature, déesse de mort.
Cette soumission d’un univers à l’extrême renverse donc la norme : la patrouille de protection est contrainte de vendre les peaux qu’elle saisit pour se nourrir, les vieux survivent au froid et à la faim tandis que les jeunes périssent, et les prisonniers, souvent, doivent aider ceux qui les ont arrêtés. Ce qui n’était au départ qu’une solidarité de circonstance finit par tout dissoudre et soumettre les corps à un même destin.
A mesure que les personnages s’enfoncent dans leur traque, le manque d’oxygène ralentit leur progression, jusqu’à les transformer en automates déglingués à peine capables de jouer leurs rôles de gendarmes et de voleurs. Ils se confondent alors, incapables de marcher, de prononcer un mot, contraints de s’incliner. Des hommes égaux face à la nature, déesse immorale et mauvaise, châtiant aussi bien ceux qui cherchent à lui nuire que ceux décidés à la sauver.
Humanisme cruel : archétype et violence.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes que ce long trek vers la mort soit effectué au nom de la vie. Il s’agit bien de sauver des antilopes menacées d’extinction autant que de venger l’assassinat d’un homme de la patrouille. Dans son acharnement, Ritai incarne l’archétype du héros de western partagé entre sauvagerie et civilisation. Une nature sauvage au verbe rare bien que pourtant enclin à la justice et la bonté, dont on retrouve l’ambivalence dans ses rapports avec ses hommes, ses prisonniers, qu’il protège et rassure avant de les sacrifier.
Le chef de patrouille possède donc au niveau des hommes les mêmes caractéristiques que la nature au niveau cosmique -mystère, puissance, mais aussi cruauté. S’avancer vers la mort et la répandre autour de soi au nom de la vie et/ou d’un combat pour la justice pourrait faire croire à la violence cynique de La horde sauvage de Peckinpah. C’est au contraire vers un héroïsme humain, dégraissé de guimauve, que Chuan Lu ramène toujours ses personnages.
L’engagement par l’hommage.
L’idéologie passe donc son il au centre. Chuan Lu est assez proche de Clooney lorsqu’il évoque l’engagement total d’hommes défendant un point de vue sur le monde. Si les deux cinéastes réinventent des héros, au sens classique du terme, c’est en leur prêtant des valeurs complètement galvaudées par la culture occidentale mainstream - solidarité, sacrifice, fraternité.
La violence, non esthétisée, provient ici du milieu, et le fait de tourner dans d’extrêmes conditions ajoute au récit la force brute de l’épopée. Enfin la mise en scène, à l’instar des héros, se caractérise par une sécheresse hachée, en mouvement, s’accordant au cadre narratif de la traque.
Derrière son très bel hommage au plus codé des genres du cinéma, Chuan Lu conserve son regard propre. La scène attendue tout le film du duel final entre Ritai et le chef des braconniers tombe ainsi à bras raccourcis sur la convention. Des hommes que le froid a rassemblés les uns sur les autres se défient par des mots lorsqu’un coup de feu part au hasard. Plus tôt, un autre membre de la patrouille, pour ne pas s’endormir au volant, s’attachait la tête par les cheveux comme un pendu à son rétroviseur. Une corde tirée du Hang’Em High de Ted Post, pour un film à mettre, qu’importe la température et l’altitude, droit dans les yeux de chacun.
Stéphane Mas
Articles récents
La forêt de Mogari - Naomi Kawase
Alexandra - Alexandre Sokourov
Paranoid Park - Gus Van Sant
4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007)
Control - Anton Corbijn (Prix Label Europa Cinéma à la Quinzaine)
Garage - Lenny Abrahamson (Prix Art et Essai à la Quinzaine)
Festival de Cannes - Bilan du 60ème (part one)
© 2005-2007 peauneuve.net - plan du site - liens - - haut de page