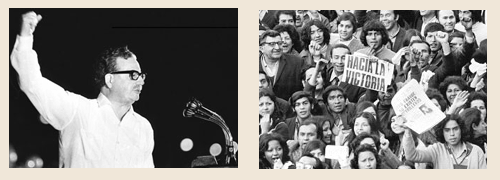Salvador Allende - Patricio Guzman.Documentaire d’utilité publique.
« Un pays sans documentaire, c’est comme une famille sans photo. Une mémoire vide. » Depuis le coup d’état de Pinochet du 11 Septembre 1973, Patricio Guzman s’acharne à reconstruire la mémoire du Chili. Une ténacité à rebours d’histoire qui tient pourtant son miracle humaniste. Retour sur un film qui, par sa ferveur, sa force, sa beauté, nous parle au présent de politique.Le film s’ouvre près d’une autoroute, par un mur : le passé ne passe pas, dit pour la première fois la voix off de Patricio Guzman. Aucun esthétisme, mais le son, la lumière bien en face, à cet instant précis. Un archaïsme très efficace de mise en scène où l’on voit, préhistorique, un bras qui s’avance, une pierre à la main pour cogner contre un mur, arracher la couche de peinture grise dont il est recouvert. Derrière les éclats de gris, des couleurs, des formes apparaissent et laissent deviner sous cette peau d’apparence une fresque réalisée trente ans plus tôt pour la campagne présidentielle de Salvador Allende. Les murs alors, dans l’entrelacs des couleurs, portaient des lettres noires et scandaient partout ce nom, Allende. Si la droite possédait les journaux, le peuple tenait les murs. Chaque jour, dans l’impulsivité collective d’un Arte Povera avant l’heure, des sortes de brigades se réunissaient pour peindre avec Roberto Mata, dire et montrer l’art, ses mâchoires politiques, faire de la rue un musée libre pour y mettre l’explicite en besoin : du pain, un toit, du travail.
Un cinéma pour répondre au déni : l’incontournable de l’Histoire.
Guzman pourrait ajouter de la mémoire, tant il s’associe par sa démarche à cet art de la nécessité. C’est bien la démesure, la ténacité de son projet : défaire une amnésie collective par l’accumulation, le martèlement de ce qui a effectivement constitué pendant près de vingt ans la mémoire d’un peuple mis au bâillon par la dictature. Redonner tout un faisceau de preuves, d’images, de paroles pour faire cesser le fatalisme politique. De retour à Santiago, face aux tours de verres qui la placent en semblable de toute mégalopole, une militante de l’Unidad Popular voudrait elle aussi, à l’image de Guzman, bâtir un pont pour les siens : d’un rêve, d’un mythe à l’autre, elle parle à demi-mots de la génération des fils qui, si elle s’étouffe au consumérisme, ne peut reprendre la flamme vide du rêve de leurs parents.
Pour cette génération qui n’a connu du Chili que la dictature et sa succession libérale, l’avenir politique ne peut se construire sur une mémoire réduite au silence. Moins qu’à se réapproprier leur histoire, Guzman veut donc par ce film, son uvre entière de documentariste, permettre aux chiliens de la voir sous leurs yeux, réelle et pleine de chair. Une sorte d’Histoire incontournable qui le place avec d’autres - Lanzman, Ophuls en tête - dans cette chambre noire d’un cinéma qui répond au déni.
Trente ans de silence pour s’ouvrir une parole.
C’est d’abord la force de ces images. Où tout le sens d’archive se défait de la connotation poussiéreuse dont on l’affuble trop souvent. La liesse, le noir et blanc pris sur la rue, les images qui traversent les néons de nuit, les carcasses de train sous le soleil, les corps qui littéralement jaillissent, exultent de joie, nous montrant là ce qui pour nous appartient presque au mythe : du pouvoir politique à faire naître l’espoir. Sa fille pourrait aussi bien parler de l’Odyssée lorsqu’elle évoque les campagnes successives d’Allende, usant au long des mois plusieurs équipes de collaborateurs, s’invitant chez ce peuple du Chili pour écouter d’abord, apprendre, expliquer ensuite sa vision politique. Jusqu’aux villages les plus reculés, Allende s’avance, convainc, le sourire sincère aux lèvres. Cette incroyable proximité d’un homme porté par son désir réapparaît lorsque l’on voit sa sur, préparant des enchiladas, évoquant les réunions politiques improvisées chez elles. Plus tard, lors d’une visite chez sa nourrice alors qu’il est en campagne, les photos captent encore l’humain, la main qui soutient le bras de la vieille femme, les traits, l’émotion, les yeux retrouvés trente ans plus tard chez sa fille, ses mots trop longtemps retenus, presque chuchotés. Car la force du film de Guzman tient là : donner voir, à entendre aujourd’hui cette parole neuve de ceux qui se sont tus durant trente ans.
Comme dans la cène figée, sans repas ni prophète, des membres fondateurs du parti d’Allende, l’Unidad Popular. Quatre hommes aux soixante ans sonnés, pris dans la cire en plan fixe sur des chaises qu’ils débordent. Leurs visages pourtant suffisent. Deux d’entre eux sont brisés, livides, comme ces anciens combattants sortis pour l’armistice qui gardent loin enfouis cette gloire passée si proche et pourtant si lointaine, leur histoire, leur mythe. Quatre hommes à l’image d’un pays, brûlés de soleil mais le regard, les jambes en fuite. « On a peut-être manqué de courage , finit par avouer l’un. Il aurait fallu sortir défendre la Moneda, combattre avec lui, notre président, pour notre pays ». « L’armée n’aurait pas tiré sur des citoyens », reprend un jeune cheminot trente ans plus tard. Guzman n’insiste pas. Il n’est pas à charge dans une pose de juge : il veut juste montrer, ouvrir, rendre possible l’émergence d’une parole, reconnaître une mémoire.
Socialisme pacifique : rêve et cauchemars.
Aux images d’espoir et de liesse succèdent le réalisme politique. Les paroles du goguenard Consul des Etats Unis pendant la bataille du Chili sont sans appel. L’histoire semble rongée dès le début. Afin d’éviter la dérive communiste du continent, les américains déversent des millions de dollars pour aider la droite des chrétiens démocrates à renverser le président élu le 4 septembre 1970. Un mois plus tard, le général Schneider est assassiné. Allende applique son programme et nationalise systématiquement les industries durant sa première année de pouvoir. L’inquiétude puis la panique s’emparent des Etats-Unis, de la droite anti-communiste, soutenue par l’armée. Ils provoquent et entretiennent la grève des camionneurs d’Octobre 1972 qui, sans le soutient des services publics, devait dévisser le gouvernement. Nixon, impuissant devant Castro, a choisi d’éliminer pour de bon ce S.O.B d’Allende. Son of a bitch. Il parle d’un Fidelismo sin Fidel, plus dangereux encore par son projet de révolution socialiste alliant démocratie et légalité, érigeant en principe le refus de la violence des armes, qui partout ailleurs gangrène l’Amérique du Sud.
Une révolution pacifique et socialiste d’autant plus effrayante qu’elle semble réussir. Car c’est comme le dit Guzman « parce qu’il est convaincu qu’une vraie démocratie conduit naturellement au socialisme » qu’Allende fonde le socle de haine profonde qui cimente la droite et permettra à la dictature de durer si longtemps. De plus, Allende revendique des valeurs qui jusqu’alors constituaient le fond de commerce rhétorique de ses opposants : l’intégrité, le patriotisme, auxquels il rajoute la morale du peuple.
Aussi, malgré la pression de la droite et fort de sa victoire aux législatives de Mars 1973, il décide avec les communistes de rester dans la légalité et fait rentrer les militaires au gouvernements, ce qui provoquera la première tentative de coup d’état en Juin 1973. Elle n’échoue que grâce à l’appui du général Prats, qu’Allende est forcé de remplacer par Augusto Pinochet. Les socialistes et les ouvriers réclament en vain des armes pour contrer l’armée. Le 11 Septembre, aidé par la CIA, Pinochet bombarde le palais présidentiel de la Moneda et les chars entrent en scène pour un combat de quelques heures. Les témoins que Guzman convoque parlent d’un homme calme et résolu, debout devant son bureau, le combiné du téléphone à la main, qui s’adresse à la nation pour ses adieux. Un son de voix à peine couvert par les explosions qui résonnent autour de lui.
Au delà de l’Histoire, une certaine forme de cinéma.
Guzman pose à peine la question. Allende a-t-il sous-estimé le machiavélisme en politique ? A-t-il eu peur d’armer son peuple ? Peut-être, et au fond qu’importe. Allende fut avant tout humaniste, visionnaire de surcroît. Il n’y a pour s’en convaincre qu’à revoir ce discours du 4 décembre 1972 [1], l’écouter défaire avant l’heure le nud principal de la mondialisation. Au delà du discours, c’est d’ailleurs la tension palpable dans l’assemblée, le souffle, le silence précédant l’ovation finale qui étonnent.
Car bien plus qu’historien, Guzman est cinéaste. Il s’attache aux mouvements, au montage, aux sensations, à la parole. Son commentaire très personnel s’efface à mesure et laisse parler ses images. La visite dans les autobus en ruine du service public au milieu d’herbes et de barres rouillées. La Moneda le jour de l’assaut, noir, rongé de flammes, contre sa façade actuelle de blanc cassé. Il revisite les lieux, apprend comment la structure entière fut délibérément transformée - bureaux, salons, couloirs. Il montre comment la mémoire fut défaite. Un lieu reconstruit pour que ceux qui y vivent n’aient jamais à se pencher en miroir vers un passé qui ne passe pas, que l’on cache, que l’on recouvre à la façon des fresques murales du début. Le cinéma de Guzman met à jour ce déni en forme de maquillage, il revisite les pièces, parle aux personnes qui étaient là, aux témoins dont il fait lui même parti. Cette confrontation du passé au présent se retrouve au montage : accoler, juxtaposer les corps avec les mots, pour un cinéaste qui, résolument, se place avec (son peuple, son histoire) plutôt qu’à contre.
Ainsi, vers la fin, évoquant l’intimité d’Allende, Guzman ne mentionnera de sa femme que son âge. Il a choisi de filmer la Chucha, secrétaire personnelle, amante de toute une vie. Guzman lui dira tout net : son amour avec Allende fut le plus beau du continent. Pas de secrets, de révélations, de complaisance. Se tenir seulement là, dans une proximité permettant de saisir l’émotion, la reconnaissance, et presque le vertige lorsqu’on songe que cette femme a du garder, taire pendant trente ans ce que durant toute une vie elle avait construit avec l’homme qu’elle aimait.
Tombeau pour une retraite en l’air.
Guzman nous montre aussi ses doutes. On le voit cogner, sonner aux portes voisines de l’ancienne résidence personnelle d’Allende. Il cherche ces témoins du dernier jour où durant l’attaque de la Moneda, la maison du président fut pillée, mise à sac alors que seule sa femme s’y trouvait. L’autre mémoire d’un saccage. A toutes ces portes voisines, Guzman ne trouve que des Jesus de fer qui se referment au sec, des excuses drapées de mauvaise conscience : le temps manque toujours à se voir bien en face. Il constate l’ironie cinglante de l’histoire qui a transformé cette résidence en maison de retraite pour l’aviation chilienne militaire.
Réplique de la mise en scène calme et glaçante des derniers moments d’Allende à la Moneda, les quelques plans fixes des murs blancs crème d’aujourd’hui face au traces noirs et grises des violences d’hier provoquent chez le spectateur un trouble identique. Effaré face à un tel pouvoir couvrant de l’amnésie, celle d’un peuple entier qui, à l’image de ces voisins, se laissa glisser dans le déni collectif : oublier le tout, n’en rien garder, comme si la souffrance de la dictature avait fait payer bien trop cher ce rêve à gauche d’une société plus juste, tandis que la droite était rongée d’une haine d’autant plus souterraine et coupable que les espoirs suscités furent défaits dans le sang.
Reconnaître l’autre et le rendre visible, ne serait-ce que pour mieux le combattre.
A travers ce film, Guzman en appelle donc à rebâtir une mémoire, à restaurer dans l’imaginaire collectif la figure d’un de ses pères fondateurs. Faut-il parler d’hagiographie ? La partialité du réalisateur n’enlève rien à sa force, au contraire. Affirmant explicitement dès l’ouverture tant sa position personnelle que la nature de son projet, Guzman semble plus libre. Derrière Allende, c’est avant tout à son peuple et son pays qu’il rend hommage, en tant que partisan exilé. Guzman sait qu’il ne suffit pas d’être d’un camp. Qu’il est nécessaire de reconnaître l’autre, lui donner une parole, une représentation, pour pouvoir avancer, fut-ce pour le combattre. C’était il y a quelques années La Mémoire Obstinée et Le cas Pinochet. Depuis, aux antipodes d’une dialectique manichéenne à la Michael Moore, ce portrait d’Allende vient renforcer ce lien, cette force d’un cinéma acteur du réel. Ce qu’il nous montre, cette ferveur sincère d’un peuple amoureux, cet humanisme politique, c’est une invitation à faire, les pieds plantés bien droit pour entrer dans la danse.
Stéphane Mas[1] « Le drame de ma patrie est celui d’un Vietnam silencieux. (...) Nous sommes face à un véritable conflit entre les multinationales et les Etats. Ceux-ci ne sont plus maîtres de leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires à cause de multinationales qui ne dépendent d’aucun Etat. Elles opèrent sans assumer leurs responsabilités et ne sont contrôlées par aucun parlement ni par aucune instance représentative de l’intérêt général. En un mot, c’est la structure politique du monde qui est ébranlée. Les grandes entreprises multinationales nuisent aux intérêts des pays en voie de développement. Leurs activités asservissantes et incontrôlées nuisent aussi aux pays industrialisés où elles s’installent. Notre confiance en nous-même renforce notre foi dans les grandes valeurs de l’humanité et nous assurent que ces valeurs doivent prévaloir. Elles ne pourront être détruites. »
© 2005-2007 peauneuve.net - liens - - haut de page