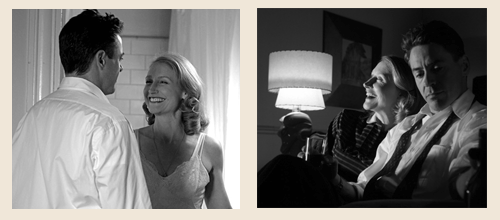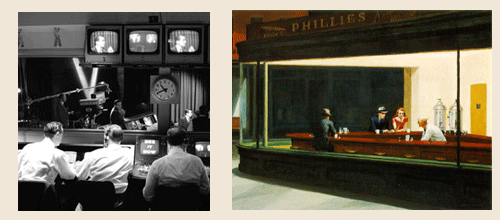Good Night, and Good Luck - George ClooneyDiamant noir pour didactique de désobéissance
Comment questionner l’hyper-spectacle en Amérique ? Clooney répond par le cinéma. Austérité, rigueur morale et mise en scène d’orfèvrerie classique. Dupliquant l’éthique de son personnage principal par son film, Clooney questionne, interroge, déplace des blocs d’ombres, de lumière et de paroles. Maniant l’équilibre entre docu et fiction par un jeu subtil de la tension dans l’immobile, Clooney compose un huis clos nourri au film noir, mais aussi paradoxalement au western. Une manière de prôner l’engagement tout en montrant la peur, le soupçon, la faiblesse. Un grand film réconciliant histoire et cinéma.Dans un ballroom encombré de tables, des corps passent entre les visages. Des verres transparents, des nappes blanches contre un fond noir, très noir. Le film s’ouvre sur la fin du héros : sur la scène, un journaliste résume la carrière d’Edward R. Murrow devant ses pairs lors de son départ forcé à la convention des patrons de presse de 1958.
Présentation et ouverture d’une boucle narrative qui se terminera, ainsi que le film, avec le discours qu’eut Murrow ce jour-là, journaliste quittant le navire CBS news après avoir lutté pendant plus de cinq ans contre Joseph Mc Carthy et sa commission anti-communiste bafouant les libertés civiles et individuelles américaines.
Si le mot network se retrouve si souvent dans les paroles des personnages, c’est bien également le motif premier du cinéma de Clooney. La caméra double ici les volutes de fumées qui partout saturent le cadre : ample, fluide et multiforme, elle passe entre les corps, s’arrête un temps sur un plan fixe, contre-plonge puis repart à nouveau. Les mouvements, à l’intérieur du cadre comme ceux de la caméra elle-même, servent donc une mise en scène très fluide, un savoir-faire tenant sans doute beaucoup au travail de Robert Elswit, dont on reparlera pour Syriana.
Le mouvement saisit la vie. Celle de la rédaction comme ruche, par les constantes allées et venues entre journalistes, techniciens et dépêches, dans une saturation de voix, de bruits parasites, non-synchronisés, d’images et de mouvements qui se figent soudain lorsque arrive le direct. Un quotidien de rédaction chorégraphié avec grâce, assez éloigné de la furie du chef d’uvre d’Hawks His Girl Friday. Comme si tout devait en surface paraître lisse et souple, d’autant plus que le fond et les bords de l’image reflétaient la noirceur des enjeux politiques.
De la fluidité. Un film entre vide et tension.
Une des plus belles réussites de Good Night, and Good Luck réside dans cette constante dialectique entre forme et fond. La rigueur, l’austérité se dégageant du personnage de Murrow, imperturbable de sang froid même lorsqu’il joue en aveugle et sans filet, se retrouve dans l’espace toujours plus géométrique de l’immeuble CBS à mesure qu’on s’approche du bureau de son patron, William Paley.
D’où le contrepoint apporté par les très belles scènes de jazz qui s’insèrent par magie de l’autre côté de la cloison. La voix profonde de Dianne Reeves, portée par le timbre des instruments, crée alors au-delà d’une illustration sonore un peu facile des années 50, une respiration, un relâchement magnifique.
Ce relâchement se retrouve aussi dans la matière du noir et blanc de Clooney. Le film fut en effet tourné sur pellicule couleur avant d’être retravaillé par niveaux de gris en post-production. Des raisons financières (un véritable éclairage de noir et blanc aurait pulvérisé le budget) qui finalement servent une double fonction dans le film.
D’abord achever l’unité stylistique d’un hommage aux années cinquante avec une tenue, une sobriété à l’écran qui s’accordent à la rigueur de Murrow. Mais aussi une manière de fondre parfaitement la partie documentaire à la fiction en rendant McCarthy lui-même acteur de son propre rôle. Idée aussi simple qu’efficace, permettant de placer au centre du film le souci d’exactitude historique.
La gageure de Clooney tient à la nature même du docudrama qu’il entend réaliser, dans l’équilibre constant entre deux buts contradictoires - l’exactitude historique du documentaire face à l’imaginaire de la fiction. S’il manifeste une vraie grâce de funambule, c’est essentiellement grâce à sa mise en scène, ses lumières, son travail sur l’atmosphère, entre tension historique et relâchement du drame.
Ombres et silence, figures du soupçon.
Le film organise des retrouvailles entre le cinéma, l’aspect glamour et le machisme des années cinquante - la voix de Murrow rappelant les off des films d’alors, les hommes manches retroussées, cigarette aux doigts, pleins de crânerie, buvant du whisky et délaissant leurs femmes dans l’ombre, littéralement hors de la vie, hors du film. Il s’agit là de filmer le groupe, le team volontaire et solide, souvent entouré de lumière pour le paradigme d’une Amérique qui lutte, tandis que derrière, le mal s’avance.
Une fois encore, le recours au noir et blanc participe d’un choix approprié. Filmer cette entrée dans une aire de soupçon revient pour Clooney à privilégier l’ombre face à la lumière, effet lui-même décuplé par la fumée de cigarette. En dehors de la surface immaculée des chemises, tout le film semble gagné par la demi-teinte des niveaux de gris.
Souvent, le cadre se remplit presque à moitié d’ombres (des visages, des corps vus de dos), de formes rectangulaires mises en abyme (vitres, écrans de projection, de télévision), de câbles renforçant cette sensation de piège, d’enfermement. Le producteur Freddy Friendly, joué par Clooney, est ainsi toujours posté aux pieds de Murrow, camouflé dans le noir.
Montrer l’affect par l’immobile. Edward Hopper au cinéma.
L’ombre fonctionne comme double du silence. Dès que le groupe se disperse, le bourdonnement sonore non-synchronisé de vie perd en puissance et les personnages se retrouvent isolés, entre malaise et mutisme. Clooney privilégie sa cohérence stylistique au dépend de l’humanité de ses personnages secondaires. A leur niveau, toute la tension réside entre la solidarité envers le groupe, l’éthique journalistique d’une part, et le silence issu de la peur d’être dénoncé. On aura donc compris : la peur coupe la parole. Mais en privant de manière unilatérale les personnages de celle-ci, toute intrigue secondaire est vouée à n’être qu’embryonnaire, frustrant du même coup le spectateur dans son désir de fiction.
Clooney a fait son choix. Ce sera l’histoire avant la fiction, le tout pris sous l’art et la manière du cinéma classique. En filmant en plan fixe ces personnages qui deviennent muets, figés par la peur et le doute, Clooney, davantage que sur la mécanique, insiste sur les effets de la chasse aux sorcières. Lorsque les personnages sont seuls, la mise en scène devient plus sobre, presque minimaliste. Elle se rapproche alors de la peinture, immobile, classique au niveau esthétique, empreinte d’une certaine gravité, convoquant au moins à trois reprises les tableaux d’Edward Hopper.
D’abord ce plan assez court où des passants regardent le show de Murrow à travers la vitrine d’un magasin, repris une deuxième fois avec le gardien de l’immeuble CBS près de son long comptoir en angle, dont Nighthawk aurait pu figurer le modèle. Enfin surtout cette très belle scène où les Wershba discutent côté à côte dans leur lit, yeux ouverts, chacun miroir de l’autre dans l’introspection, l’isolement presque.
« We might just as well go down swinging ». Du jazz dans le suicide.
Une teinte plus intime passe donc en filigrane de l’histoire officielle. Au-delà de la solidarité du groupe dont on voit surtout la réussite, derrière l’histoire d’amitié entre Edward R. Murrow et Fred Friendly, la solitude, l’esseulement gagnent les personnages. On semble alors quitter le docu pour entrer dans la fiction. Le couple Wershba sur son lit, puis Murrow lui-même, lorsqu’on le voit en fin d’émission pencher son buste vers ses genoux, sa tête seule sortant du moniteur de télévision situé sur la droite du cadre, comme en amorce à la fin du film avec son retrait définitif de CBS.
Malgré son annonce un peu trop appuyée pour vraiment surprendre, l’acte le plus sombre du film demeure le suicide de Don Hollenbeck. La façon dont Clooney le filme révèle d’ailleurs son penchant pour un certain excès de zèle dans la mise en scène. Clooney est depuis trop longtemps amoureux des sirènes pour résister toujours au plaisir de faire beau. Ainsi, au lent mouvement circulaire de caméra manifestant l’enfermement d’Hollenbeck avant sa mort, le cinéaste renchérit en faisant disparaître dans la vitre le corps flou de Diane Reeves. Un peu trop classy pour une mort d’asphyxie.
Film de couples (presque) sans femme. Western dans la lucarne.
Si les femmes sont presque invisibles dans cette Amérique du travail au centre de laquelle Clooney met en scène son huis clos, beaucoup de couples en revanche traversent le film. De ces derniers, celui des Wershba est d’ailleurs le seul où Murrow n’intervienne pas directement. Par ailleurs, on s’explique assez mal la complicité assez molle de Murrow et Fred Friendly, avant de s’apercevoir qu’elle reflète de manière inversée les rapports entre Murrow et le patron de CBS William Paley.
Clooney traite du pouvoir et botte en touche le romanesque autour du couple ou de l’amitié. Si par ses idées, son rôle de producteur et sa présence physique Fred Friendly semble bien sur le papier le plus proche collaborateur du journaliste, les duels entre Murrow et Paley donnent à chacun de ces personnages bien plus de profondeur qu’au gentil Fred.
Duels à distance, où chacun s’observe, se tient en joue avec ses propres armes. Duels où s’affrontent, sinon deux visions du monde, du moins de la télévision -l’entertainment rentable pour Paley contre l’éthique d’un journalisme civique pour Murrow.
Le scénario place ainsi aux deux extrémités d’une même ligne des personnages moins opposés qu’il n’y paraît. Homme de l’ombre et des coulisses, Paley se tient au plus loin du téléspectateur tandis que Murrow, sous les feux du direct, en est l’interlocuteur direct. Comme au réel d’ailleurs, le décideur reste tandis que le journaliste passe.
Au-delà de leurs différences pourtant, Clooney les montre comme deux héros de western qui se respectent et se ressemblent. Deux hommes distants, austères et tenaces, détenteurs chacun d’un pouvoir (l’argent pour Paley, l’audimat pour Murrow) dont Clooney filme avec beaucoup de justesse la solitude inhérente.
Engagé ou didactique ? Du cinéma, rouge, noir et blanc.
Inutile de s’appesantir sur Joe Mc Carthy : il s’agit là du sujet du film. Un méchant, très vilain, qui ne respecte pas les droits les plus élémentaires accordés à tout citoyen par la constitution. Comme s’il lui accordait une ultime chance avant de l’abattre froidement (le western encore), Clooney laisse Mc Carthy s’exprimer longuement. Jusqu’à provoquer des longueurs dans son film, comme l’épisode Annie Lee Moss. Souci d’honnêteté, d’exactitude historique, ou simple rééquilibrage pour compenser son parti-pris de réalisateur ? Dégainant les trois d’un même coup, Clooney remplit son contrat et peut rendre son coup de grâce sous forme de final cut.
On peut donc parler de didactisme moral lorsque Clooney filme le duel entre Murrow, que David Straithairn cite presque à la virgule, et le très vilain Mc Carthy. Cet aspect-là est à l’origine du projet : ramener de manière explicite l’histoire d’hier à celle d’aujourd’hui. Dénoncer la télévision comme média de spectacle cupide quand elle pourrait être vecteur de progrès.
Histoire et médias. Hier, c’est ici, maintenant.
A travers le personnage de Murrow, Clooney rappelle un fondamental de l’identité culturelle américaine dont l’origine remonte à Henry David Thoreau et sa Désobéissance civile (1849) : l’engagement individuel contre une dérive politique contraire aux valeurs fondatrices d’une nation.
L’Internal Security Act de 1950 renvoie donc ici au Patriot Act de 2001 et l’Amérique soutenant McCarthy dans sa croisade anti-communiste fait bien sûr écho à celle de Bush contre le terrorisme, de même que l’ambivalence de CBS à l’époque rappelle la désinformation de droite-ultra incarnée par Fox News. Hier c’est ici, maintenant. Le discours final de Murrow sur lequel se ferme le film s’adresse donc bien davantage aux dirigeants actuels de la télévision qu’à ceux de 1958.
Good Night, and Good Luck tient donc tout entier dans son titre. Un film bi-fluoré, qui fait de la politique en prospectant sur le drame, jouant sur la tension et l’immobile. Good night puisque le drame et la fiction s’effacent lentement dans un minimalisme tendu auquel se prêtent personnages, paroles et actions. Good luck car le film enregistre la trace d’une éthique, d’une morale en journalisme qu’il convoque et espère pour l’avenir. A l’opposé de Michael Moore, Clooney réussit donc à faire un film politique au centre de l’histoire tout en restant au cur du cinéma. Une écriture ciselée à l’extrême comme Diane Reeves reprenant Nat King Cole, Straighten up and fly right.
Stéphane Mas
© 2005-2007 peauneuve.net - liens - - haut de page