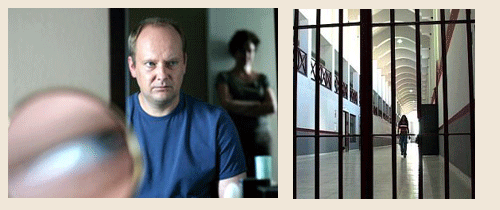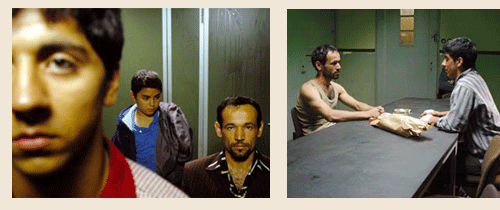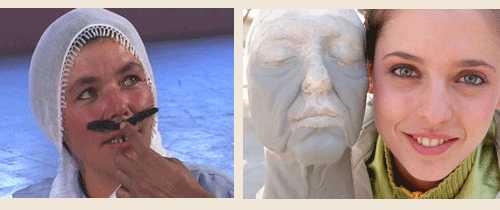Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier - 27ème éditionNuit d’hiver sur la plage.
Un pied dans la fiction, l’autre bien ancré au réel, c’est fort de sa diversité que Montpellier continue d’offrir une vitrine la plus large possible d’un cinéma qui s’il se berce à la méditerranée, n’en reste pas moins avant tout contemporain. Une édition marquée par les femmes, les Balkans, et surtout la Turquie, confirmant la vitalité d’un cinéma s’invitant comme par ironie en plein centre de l’Europe.Méditerranée et cinéma, premier couple d’une longue série. D’abord le couple séparé, le couple impossible : Igor Sterk part sur l’excellent Tuning d’une écriture à l’épure très fine, habitée par l’ellipse, qui traite avec beaucoup de justesse du délitement, de l’enfermement, de l’étouffée qui vient un jour cingler un couple. Une tension dans la mise en scène et l’écriture manquant à Travail = Liberté (Delo Osvobaja) de Selo Osvobaja, portrait d’un homme ordinaire en restructuration sociale et intime.
Il s’agit pourtant du même. Peter Musevski incarne en effet dans ces deux films la même figure d’un homme à la chute en pleine quarantaine. Dirigé par Sterk, il offre à la petite musique tranchante de Tuning une dissonance dont on reparlera. Le ton était donc donné dès le départ : cette 27ème édition serait celle des femmes.
Cinéma turc et mythologie contemporaine.
La brèche à fleur de peau ouverte avec Head-On de Fatih Akin poursuit avec les films de 27ème édition d’ancrer la Turquie en plein centre de l’Europe du cinéma. Energie vive, rage à prendre et tenir sa vie l’il ouvert de personnages que l’on retrouve dans 2 filles (2 Genz Kiz) de Kutlug Ataman. Où la rencontre, l’histoire de Behiye et Handan, deux adolescentes d’Istanbul, constitue une sorte de pendant turc au My summer of love de Pawlikovski.
Un pendant moins maîtrisé, assumant son goût du paradoxal pour montrer l’adolescence à crue, entre désirs fous et contingence au réel, donnant à ce film une puissance cependant ternie par un montage trop flou. Un quart d’heure de trop qui finit par ôter au réalisateur des ailes pourtant bien méritées.
D’ailes et non plus de désirs, c’est une chute brutale d’illusions que l’on retrouve dans Fratricides de Yilmaz Arslan, avec le destin tragique d’Azad, jeune berger kurde retrouvant son frère en Allemagne pour une trajectoire en forme de cauchemar. Un film droit, rêche et sanglant, à la croisée du théâtre antique, du cinéma et du politique.
Le front collé aux questions du mal et de la vengeance, Yilmaz Arslan s’offre un précis contemporain de mythologie plaçant le verbe et le travail de la parole à égale hauteur de la violence. Aucun déni donc, mais davantage, entre provoc et rigueur de mise en scène, la confirmation d’un (grand) cinéaste que le festival aura bien eu la malice de programmer comme avant-première surprise.
Le mariage infernal.
Surprise de taille par la noirceur d’un propos que Vent de terre (Vento di Terra) reprend de manière implacable dans sa condamnation d’une société broyant du pauvre avec indifférence. D’une société l’autre, Anat Zuria réalise quant à elle avec Condamnée au marriage (Mekudeshet) un documentaire au poing du monde orthodoxe juif. Un film en forme de couteau dans les antichambres de la justice rabbinique.
Tandis qu’un homme peut vivre avec d’autres femmes, une femme doit rester fidèle à celui dont elle demande le divorce, jusqu’à ne pas même pouvoir rencontrer physiquement d’autres hommes. Malgré des dossiers de maltraitance accablants, certaines peuvent demeurer des agumas pendant dix ans dans l’attente que leur divorce soit prononcé.
Anat Zuria place sa caméra dans un sac et filme les murs, les salles d’attente, les chambres d’audience et les vies balafrées de femmes contraintes à l’attente. La solution ? Acheter à prix d’or son mari pour qu’il consente à divorcer. Où comment la justice rabbinique, avec un cynisme révoltant, finit par défendre le coupable pour condamner la victime.
L’attente ou l’enfermement.
Au monde des femmes et de l’enfermement littéral, La troisième vie (La tercera vida), de Vanja d’Alcantara et Carmen Pérez-Lanzac s’impose comme documentaire pris de face, filmant une parole nue, entre quatre murs. Celle de Purificacion Crego, entrée en prison à dix-huit ans, et sur le point d’être libérée à l’âge de vingt-neuf ans. Elle parle de sa première vie (avant la prison), de sa seconde derrière les murs puis de sa troisième dont elle rêve en osant presque y croire.
Une parole douce et lucide, calme, apaisée, qu’il faudrait faire entendre, diffuser au sénat, et qui malgré un dispositif victime de ses limites (pas une once d’effet visuel) garde lame ouverte sur sa fin.
L’attente et les femmes sont également au cur de L’enfant endormi de Yasmine Kassari. Filmé dans le désert de Taourirt, au nord-est du Maroc, ce film à la beauté sèche suit le quotidien de deux femmes dans l’attente de leurs maris partis immigrer en Espagne. De magnifiques plans fixes ouverts sur le désert minéral, comme pour marquer cet espace oscillant entre ouverture et enfermement, lui même reflet de l’attitude de Zeinab et Halima - l’une soumise et patiente tandis que l’autre réclame vie pleine.
En fondant sa mise en scène à l’épure de l’intrigue, Yasmine Kassari signe avec cet Enfant endormi un film très fort, pris dans l’attache à ses personnages et à leur forme si particulière de dignité.
Métamorphoses par la racine.
Dans La pièce (Oyun), documentaire turc de Pelin Esmer tourné sous les contreforts des Torros, neuf femmes issues des travaux de la terre montent sous l’égide d’un écrivain une pièce de théâtre basée sur leurs vies. Le théâtre comme seconde naissance, rêve attaché au réel des planches. Où il suffit de gribouiller du noir sur un bout de sparadrap pour se faire une moustache, de se couper les cheveux pour devenir un homme.
Une manière non d’échapper à leur condition mais de la faire imploser par l’intérieur. A la métamorphose des corps succède une autre manière d’être, plus assurée, plus fière. Toute la beauté du film passe par la puissance de cette transformation, par ce qui à l’origine du théâtre, relève de l’incroyable, du surnaturel presque : pouvoir tout dire. On y parle d’injustice, de maltraitance et de mort, mais toujours avec le rire, le grotesque, la farce au coin du visage. Une pure jouvence.
Du cirque à l’horreur - petite malice du rire.
Un monde de femmes aussi placé sous la caméra des réalisatrices espagnoles, pour une surprise en forme de grand éclat de rire. Semen, una historia de amor de Daniela Fejerman et Inés Paris réussit le miracle trop rare dans le cinéma actuel d’une comédie hilarante au cerveau frappé d’intelligence, le tout servi par une mise en scène à la mode kitsch du jour.
Il y a bien un peu de Tati dans cette histoire de sperme baladeur et de méandres d’insémination, entre l’espace clinique des scientifiques et l’apesanteur des cirques. Une petite claque légère et aérienne qui donnerait fort envie d’y goûter plus souvent.
Un cirque par ailleurs multiple, et dont la programmation au cur même du festival, à l’initiative du bouillonnant Jean-François Bourgeot, continue de tracer son étrange route colorée, que le festival aura, finesse oblige, présenté deux jours avant la désormais traditionnelle nuit de l’enfer, consacrée au maître nihiliste de l’horreur Lucio Fulci. Hémoglobine et putréfaction de l’horreur en contrepoint des trajectoires physiques, des corps et des voix du cirque, dont on retiendra, entre autre des Numéro(s) Neuf(s) le très beau Impacts, de Maripaule B.
Maladie des corps.
Chutes, mouvements, impacts entre le corps de Mathieu Hocqueiller et le sol noir de la scène. Un corps en vie contre le corps défait, celui qui se délite, s’absente de lui-même et n’existe qu’en automatisme décalé. Avec Présence Silencieuse, Laurence Kirsch tord par l’intime le documentaire avec la maladie d’Alzheimer dont souffre son père. L’intime et la vie d’un film qui s’il se tient face au mal et à la souffrance, montre en quoi la mort lente du corps fait aussi grandir et vivre ceux qui l’accompagnent.
Etre là et dépasser la culpabilité, le rapport à la dépendance, l’acharnement dans la lutte, combattre le silence mais aussi finir par l’accepter, c’est tout ce parcours auprès des siens, de sa mère notamment, que filme Laurence Kirsch sur la durée. Un regard sur le temps et la dégénérescence qui ne se fige, ne se résigne pas. Les mots perdus deviennent mordillements, le langage renaît sous une forme physique, et ce sont au final les autres qui apprennent à se parler et mieux vivre.
Ce regard sur la maladie est aussi celui de Goran Paskaljevic dans Songe d’une nuit d’hiver (Sam Zimske Noci). Enfin primé d’un Antigone d’Or, il réalise un film magnifique sur l’autisme individuel et collectif à travers l’histoire de Lazare, de retour chez lui après dix ans d’absence. Sur fond de guerre des Balkans et d’ambivalence entre présent et passé, le réalisateur serbe signe un gemme noir comme la nuit pour une rencontre sous la neige entre un homme, une femme, et une enfant autiste de douze ans.
Auteurisme vain contre courts en hauteur.
Le noir dans une version plus clinquante encore à l’uvre d’Une merveilleuse nuit à Split, d’Arsen Anto Ostojic. Deux heures précédant la nouvelle année, une demi douzaine de personnages se croisent dans un récit centré sur la drogue, son trafic, ses dépendances.
De la naïveté d’un jeune couple à la prostitution d’une jeune junkie en manque en passant par la trahison d’un passeur, le scénario très écrit fonctionnant par boucles et changements de point de vue n’évite pas le catalogue de clichés servis par un noir et blanc à l’esthétisme plus que déplacé. Un choix d’autant plus regrettable que l’éclairage et la photo, magnifiques, desservent un film où l’humanité ne sert que de prétexte à une virtuosité au final assez vaine.
Une tare dont souffre également Amor idiota, du catalan Ventura Pons, tandis qu’à l’inverse de l’échelle égotique, toute une partie des court-métrages programmés, notamment via le partenariat du Court-Circuit d’Arte, remisent le film court à sa juste hauteur. On retiendra le lauréat Samoure de Théo Papadoulakis, Be Quiet de Sameh Zoabi et le très beau Cadeau de noël de Nana Janelidze pour son traitement sur le mode de la comédie douce-amère du retour au pays d’un émigré géorgien. Goût de la fête pour un atterrissage en force, une descente au réel qui s’achève masque à terre.
Le film méditerranéen n’oublie pas ses classiques. Les documentaires entre mer et feu de Vittorio de Seta, qui déjà dans les années cinquante, jouaient d’une forme courte en guise de sabre. L’arbre décapité des Oubliés, les Paysans de la mer dont les visages ressemblent à des filets, à des toiles, et le conte sarde du coupable idéal dans Bandits à Orgosolo. Un regard dur sur une terre marquée par « le début des temps », bien loin de l’univers des studios fêté par ailleurs comme il se doit dans une contre-allée pleine de merveilles.
Go West - Folklopunk et rigueur classique.
Faire ainsi la liaison Cinecitta-Hollywood reviendrait presque à dévaliser la confiserie sur le chemin d’école d’un gamin trop gourmand, l’occasion unique de dévorer sur grand écran des chefs d’uvres comme Scarface, Une nuit à l’Opéra ou le merveilleux Quinze jours ailleurs de Minnelli. Un film sur les acteurs au cinéma comme nul autre pareil, et sur le double en soi inaugurant une thématique explicitée avec la diffusion du Blow-up d’Antonioni face au Blow Out de De Palma.
Ce thème des doublés, des allers retours sous influence, de manière inattendue, forme d’ailleurs le sous-texte d’un des films les plus discutés du festival (Prix du public et de la critique). Dans sa panoplie transformiste de personnages et de genres, Go West offre en effet le pari de puiser dans les aux sales d’Il était une fois dans l’ouest projeté parallèlement. Même sensation de western fin de siècle, d’effritement d’un monde païen où les femmes sont des hommes et au centre duquel la violence lutte à mort face à l’émergence d’une parole.
Faisant de l’homosexualité latente des westerns la base explicite de son film, Ahmed Imamovic dépasse le cinéma folklopunk des premiers Kusturica pour s’aventurer entre vampires et cowboys sur un territoire hybride qui marque l’empreinte d’un réalisateur à suivre de très près. Un film multiple, concentrant peut-être toutes les veines de cet immense corps méditerranéen visible à Montpellier, dont on ne manquera pas de guetter la prochaine édition avec impatience.
Stéphane Mas
Articles récents
La forêt de Mogari - Naomi Kawase
Alexandra - Alexandre Sokourov
Paranoid Park - Gus Van Sant
4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007)
Control - Anton Corbijn (Prix Label Europa Cinéma à la Quinzaine)
Garage - Lenny Abrahamson (Prix Art et Essai à la Quinzaine)
Festival de Cannes - Bilan du 60ème (part one)
© 2005-2007 peauneuve.net - plan du site - liens - - haut de page