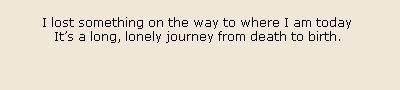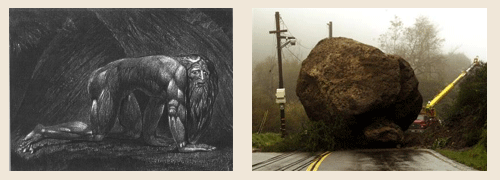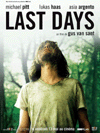
Last Days - Gus Van SantLongue attente avant de s’élancer, one trip
Quelque part entre Kurt Cobain et William Blake, Gus Van Sant filme la désarticulation, à lui-même et au monde, d’un personnage en chute libre. Prélude au suicide par le vide, le cinéaste s’extirpe du réel et place son cinéma du côté du mythe, de l’esthétique, en tirant son cadre vers la peinture.Le médecin psychiatre Patrick Declerck sortait en 2001 Les Naufragés, un livre à la fois très beau et terrifiant sur les clochards, leur vie rythmée par la souffrance psychique et physique, la dépendance, leur abandon à l’alcool, à la rue. C’est plus à ce livre qu’à l’univers rock de Dig que fait penser ce film retraçant les derniers jours de Blake, rock star échappé d’un centre de désintoxication en pleine déshérence. Exit concerts, sauteries, strass et paillettes. C’est une bicoque victorienne de film d’horreur pour séance d’autisme en forêt. Un film dur, à la beauté noire comme l’ébène, sur la mort et la solitude. Une histoire qui, forcément, finit mal.
Fuite et dépendance : chute, noyade
Il porte au poignet un bracelet de plastique comme indice de détail qui s’affirme dans chaque plan où il apparaît, signe paradoxal d’un homme qui dérive, flotte, s’abandonne, s’extrait du monde au moyen d’une dépendance qui le possède. Gus Van Sant s’attache aux conséquences, aux effets, sans ne jamais montrer les faits. En occultant la prise, l’injection de drogue et/ou de médicaments, il s’extrait lui aussi, par la mise en scène, d’une réalité qui ne l’intéresse pas, pour se tourner vers le traitement d’une figure. Sortir du réel, du biographique, pour entrer dans un mythe par son envers, son côté sombre. Ainsi, ce n’est pas de Kurt Cobain (qu’il avait rencontré), ni d’Elliot Smith (un ami personnel, lui aussi suicidé) dont traite le film, mais des deux réunis dans cette figure d’un homme en dérive, dont la douleur psychique l’entraîne vers la mort. Le scénario commence d’ailleurs après que Blake ait quitté le lieu hors-champs censé le ramener à la vie, lui faire sortir la tête de l’eau - la clinique - lorsqu’on le voit, dès le début du film, plonger près d’une cascade au milieu d’une épaisse forêt dans laquelle il erre, mi-ange déchu, mi-Robinson post-nucléaire arborant sa panoplie grunge - converses au pieds, pantalon bouffant, t-shirt sale déchiré.
La droite vers le bas, le cercle
Cette plongée du début sert de métonymie pour tous les mouvements du film, repris par la caméra même, ceux du cercle et de la droite, de la descente. La piscine naturelle en forme de cuve ronde et l’eau qui s’abat verticalement de la cascade reprennent donc par métaphore ce qui constitue le personnage : un homme qui tombe, replonge, qui ne s’en sort pas et tourne en rond. Cela reviendra tout le film. Pendant que les autres dorment, Blake descend dans la jardin pour creuser la terre, presque sa propre tombe puisqu’il en extrait une caissette, qu’on imagine remplie de drogue. Lorsqu’il s’abandonne dans la bibliothèque/salle de télévision, la caméra tourne lentement autour de lui comme autour d’un animal en cage. Lorsqu’il fuit Donavan et le détective, c’est dans un mouvement de descente jusqu’à l’eau, en tombant près de l’escalier dont il manque les marches. Plus tard, bel exemple de mise en scène, on le voit progressivement quitter la grande maison victorienne qu’il partage avec les autres pour se réfugier dans la petite cabane à outil du jardin, complètement vide.
Enfin, lors de la deuxième vision de la fuite pour éviter Donavan et le détective, un long plan séquence silencieux sur la terre immobile annonce la dernière demeure à venir de Blake. Ce mouvement de rétrécissement de l’espace, de la forêt, à la maison puis à la cabane, et à la terre, suit en écho la trajectoire psychique du personnage et la chronologie du film : la célébrité hors-champs, l’amitié ou tout du moins coexistence avec les autres, jusqu’à l’extrême solitude et la mort.
Ce principe esthétique était déjà présent dans Gerry et Elephant. On se rappelle les lents travellings de la caméra, en avant, en arrière, de profil puis en cercles autour des jeunes adultes, et au delà, d’une Amérique prisonnière de ses codes, de ses mythes dans un gigantesque autisme identitaire. Gus Van Sant adoptait déjà cette position de la lisière, sa caméra placée dans une sorte de distance tendre. Le cinéaste ne condamnait pas, n’expliquait pas, ne justifiait pas, mais il se tenait là, témoin buvard d’un monde montré à l’écran avec grande empathie, au moyen d’une grammaire esthétique dont l’épure formelle se précise et s’affine de film en film.
Seul au monde : mythe et cinéma
A travers le grain de l’image, les décors, les personnages surtout, une teinte sombre, crépusculaire s’empare de tout le film. Mis à part l’intervention de Kim Gordon, sa bienveillance à lui faire quitter cette maison, les autres personnages servent de poupées fantômes en bascule. Un groupe interchangeable de corps plus que d’amis qui apparaissent dans une suite de noms, de visages et de corps qui se ressemblent beaucoup sans être tout à fait les mêmes, sans non plus que l’on sache s’il s’agit de membres de son groupe, d’amis ou de connaissances. Gus Van Sant les filme en brouillant la frontière insouciance/indifférence : pas un d’entre eux ne s’approche vraiment de Blake, sans qu’ils l’évitent vraiment non plus. Comme s’il n’était déjà plus là, vide, transparent.
Une des filles se contente de lui prendre le pouls pour vérifier qu’il ne soit pas mort, puis le pose droit comme un vase qu’elle aurait avec maladresse fait tombé en ouvrant la porte. C’est ironiquement l’agent des pages jaunes avec qui il parle le plus. Malentendu, ironie dramatique, incongruité rappelant la très belle nouvelle de Carver Collectors, dans laquelle un représentant d’aspirateur s’introduit chez un homme vivant reclus chez lui pour lui démontrer les merveilles d’un appareil dont, de toute façon, il ne se servira pas.
Recyclage des mythes (suite)
A travers cette référence à Carver, Gus Van Sant continue surtout son recyclage des artefacts de la culture américaine. Après le road-movie mental effectué à pied et non en voiture de Gerry, puis les couloirs du lycée, symboles du teen movie auquel il administrait une éléphantesque dose de prosac, le cinéaste se pare de la très visitée maison victorienne des films d’horreur pour à nouveau en pervertir le code.
Le fantôme, le monstre, l’horreur sont ici humains, ils ne viennent pas d’ailleurs. L’enfer, ce n’est donc pas les autres : le mal est bien en nous (Cf Alien). Ceux qui le voudront pourront donc y glisser quelques lignes sur l’Amérique malade d’elle-même, la fin du messianisme et blah, blah, blah, quant l’important tient à Hitchcock.
Impossible en effet d’évoquer la mort dans une maison victorienne sans penser à Psychose, surtout compte tenu de l’obsession personnelle que Gus Van Sant voue à ce film. Leçons tirées de son remake, le cinéaste construit ici tous ses plans - avec sa seule grammaire, et parfois une lourdeur inutile. Pourquoi faut-il que tous les murs soient moisis, que tous les placards soient sombres, que tout soit teinté d’abandon ? Gus Van Sant semble pêcher par excès sur la décrépitude intérieure, alors qu’il réussit à merveille à la faire dialoguer avec le dehors, la nature luxuriante des bois, permettant à son film de respirer, d’éviter l’angoisse du huis clos.
Apocalyse Now, Blake = Rebel without a cause
En cadrant cette forêt en plan très larges, de loin, Gus Van Sant lui confère une impression de grandeur, d’univers minéral dans lequel Blake vient se perdre, s’abandonner. Lorsqu’il extrait son personnage des autres, lorsqu’il l’isole dans le décor de cette nature, un même mouvement se dessine : transformer Michael Pitt en épigone complètement vaincu du Brando d’Apocalypse Now ou du Kinski d’Aguirre, la colère de dieu : un homme perdu qui se confronte au mal.
Seule différence de taille : son combat n’a pas d’objet, il ne tend pas vers ou contre quelqu’un ou quelque chose, sinon lui même. Ou plus précisément, ce combat a déjà eu lieu ; Blake a quitté le ring, il a rendu ses armes.
Ainsi pourrait-on considérer la surprenante et - très- longue scène de la bibliothèque. Au centre de cette pièce, sous une lumière aveuglante, un poste de télévision. Passons sur le fait de reléguer la télévision au centre tandis que les livres tiennent la poussière à l’intérieur des vitres. C’est surtout le clip et la musique qui retiennent l’attention : Boys II Men, torture visuelle autant qu’auditive, avec plus de lave mielleuse arôme bons sentiments en un clip qu’une saison entière de la pire des séries Brésiliennes. Et pourtant, Gus Van Sant tourne autour de Blake et du poste, il filme en continu, presque au ralenti, jusqu’au terme du combat. Commentaire ironique du cinéaste d’une victoire du marché sur un art authentique incarné par Blake ? Peut-être. A travers cette scène de boxe métaphorique, Gus Van Sant semble surtout faire sa profession de foi, refusant d’être d’un bords ou de l’autre, ni sacrifié ni vendu, on oserait presque dire ni pute ni soumise - toute sa filmographie le prouve.
Au delà de ce discours sur l’artiste qu’il veut continuer d’être, que filme Gus Van Sant sinon la chute d’une icône contemporaine ? Il choisit de ne faire réellement parler Blake qu’une seule fois dans le film à travers les paroles d’une chanson, et ne trahit ainsi personne, ni l’artiste, ni les fans. Au milieu de cette route vers la mort, il filme Blake/Cobain vivant dans ce qu’il sait faire de mieux, dernière accroche pour lui d’un art-survie sur lequel il se jette avec une bouleversante lucidité.
Peinture et cinéma : exubérance de l’épure
Cette vision d’une vie entière à son art se retrouve ailleurs dans le film, et de manière assez surprenante. On attendait beaucoup de musique, Gus Van Sant parle peinture. Ce n’est pas un hasard s’il accole à son personnage le nom du grand poète et peintre anglais du XVIIIème siècle. Même intransigeance que Cobain dans l’art-survie, même dégoût à la fois du monde matériel et de la corruption de l’innocence. Et si le film fait de ces éléments sa matière première, il l’expose avec la teinte mythique de la malédiction. Le corps prostré du personnage, son affaissement à mesure, rappellent certaines gravures du vrai William Blake, comme le Nabuchodonosor de 1795. Et Gus Van Sant inverse la conception du vrai Blake d’une exubérance qui soit beauté tant dans l’esthétique que dans le rythme très lent du film. A moins peut-être d’oser l’exubérance dans l’épure. Vous hurlez ? Comment qualifier autrement ce plan-séquence de la terre et de fines branches d’arbustres en prolepse à la mort du personnage, ou celui très composé de la nature morte à mi-étage sur l’escalier de la grande maison ? Dans un vase, quelques fleurs séchées aux longues tiges penchées, d’une mort à l’uvre dans l’ascension à la célébrité, comme le corps de Blake que l’on voit replacer droit - en vain - contre la porte par une des jeunes filles au début du film, puis plus tard dans la cabane en bois.
Cette nature morte aux fleurs n’est pas la seule incursion du cadre vers la peinture. Dans le salon où sont reçus l’agent des pages jaunes puis les deux jeunes missionnaires de l’Eglise des Saints des Derniers Jours, on découvre dans un assez large tableau d’autres thèmes du film : la chasse, la traque, la fuite des autres/de soi par un homme acculé dans sa remise et dont la peur se mue, le temps d’une réplique, en paranoïa. Un rapport à la peinture qui transparaît encore dans la scène la plus réussie du film, l’unique moment où l’on voit Pitt/Blake/Cobain en train de chanter. Scène d’épiphanie puisqu’en elle sont révélés autant les liens que Blake tisse avec les autres que les racines plus profondes de son mal.
Le joueur de guitare, par Gus Van Sant
Dans un plan assez large, l’ensemble du cadre est composé avec une très classique rigueur picturale. Chaque élément, son sens propre, font résonance avec les autres éléments de la composition. Cette stylisation du cadre peut rappeler de manière très lointaine La joueuse de Guitare de Vermeer ou Les Ménines de Velasquez. Vous hurlez à nouveau ? Pourquoi cet éclairage en demi chandelier dans la partie en haut à droite du cadre, quel mort veille-t-on alors ? Pourquoi Pitt/Blake se tient-il assis, une guitare dans les mains, à la batterie ? Cogne-t-il plus fort sur ses cordes que sur les fûts qui l’entourent ? Pourquoi ne joue-t-il pas debout, derrière un micro, surtout lorsque celui-ci occupe la partie gauche du cadre, avec rien ni personne derrière, sinon au second plan un tableau éclairé ? Pourquoi, dans une maison glaciale où l’on ne fait pas de feu, éclaire t-on un tableau au contenu incertain ? Ce tableau parle-t-il ? Car si l’on ne voit pas en effet avec précision tous les traits, on distingue deux figures : celle assise et vue de face d’une femme, aux pieds de laquelle, de profil, on distingue la silhouette d’un enfant. Des corps juxtaposés qui ne se parlent plus, comme en écho aux rapports qu’entretient Blake avec les autres. Enfin, cette scène magnifique sonne d’autant plus juste qu’elle fourmille d’effets de réels - l’interruption, la corde cassée, la reprise du morceau jusqu’au final.
Cette séquence filmée en plan séquence contraste d’ailleurs avec l’autre scène de musique - électrique cette fois, tournée plus tôt dans le film. On y voyait Blake organiser par superposition un morceau en jouant tour à tour de chaque instrument, la caméra d’abord très près, au bord de la fenêtre, avant qu’elle ne s’éloigne dans un long travelling arrière pour établir une distance visuelle, qui là, comme dans tout le film, trouve son envers dans le travail du son.
S’identifier par le son, s’extraire par l’image
Car autant la caméra se tient à la lisière, comme à distance, se contentant d’enregistrer cette longue descente des derniers jours, autant le son est partout présent, par le silence, le bruit de feuilles, les poignées de linges mouillés qu’on essore, les cloches d’églises, les churs d’enfants, comme les bribes d’une mémoire interne au personnage. Tandis qu’il reste visuellement au dehors, le spectateur, grâce au travail sur le son, est propulsé dans la subjectivité de Blake. Gus Van Sant se sert de ce mouvement d’intrusion sonore/expulsion visuelle pour ne pas être roublard. Une sorte d’anti Oliver Stone filmant la saga des Doors avec l’ambition de tout dire, tout montrer.
De Kurt Cobain, on n’apprendra évidemment rien. Des plans répétés d’abandon, de déchéance, d’un corps à la dérive, parfois ridicule. Un type qui change de vêtements sales pour des plus sales encore, qui s’étale par terre, titube, marmonne comme un clochard. On peut dire stop, halte là, halte au grotesque. On peut se sentir floué. On peut rire de ce type en chemise de nuit noire satinée qui s’effondre devant un agent des pages jaunes. On peut rire au début. Et puis Gus Van Sant nous refait le coup de la longueur. Après quelques secondes, le rire devient gênant, ce n’est plus drôle du tout, voilà, et puis boum. On devient bouleversé.
Il y a ce temps propre à Gus Van Sant, cette lenteur qui vient reprendre en boucle, qui se découple, qui se remontre. On n’avance pas, on ne cesse de tomber, de reprendre au long cours une agonie qui n’en finit plus. Grand film de la désillusion, de la mort à l’uvre des mythes, Last Days peint son sujet, littéralement, à même l’écran. On voit toujours trop vite, on ne regarde pas assez, pourrait nous dire le cinéaste. Est-ce la raison pour laquelle il affuble l’un des personnages d’yeux grossis démesurément par le verre de ses lunettes ? Et qui, s’il voit gros, reste celui qui voit le plus mal de tous ? Alors on tourne en rond, on répète, on suit la trajectoire de la voiture blanche lentement s’abîmer vers le bas. Puis un type, pas une faucheuse, s’approche de la cabane à outil avec une sorte de longue serpette à la main, il regarde à travers la vitre, et voilà, c’est fini. Pas une seule goutte de sang, l’horreur est dans les têtes. Le générique peut commencer, puisqu’il n’y avait rien au début. C’est toujours à la fin que quelque chose commence.
Stéphane Mas
Articles récents
La forêt de Mogari - Naomi Kawase
Alexandra - Alexandre Sokourov
Paranoid Park - Gus Van Sant
4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007)
Control - Anton Corbijn (Prix Label Europa Cinéma à la Quinzaine)
Garage - Lenny Abrahamson (Prix Art et Essai à la Quinzaine)
Festival de Cannes - Bilan du 60ème (part one)
© 2005-2007 peauneuve.net - plan du site - liens - - haut de page