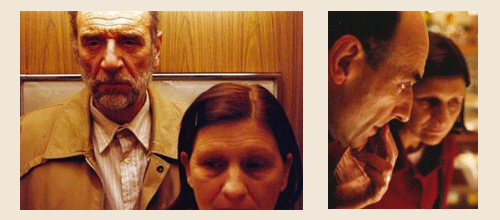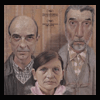
Whisky - Pablo Rebella & Pablo Stoll.Métaphysique d’un quotidien chaussette.
Etrange vrai-faux ménage à trois entre deux frères et la plus fidèle des employées de l’un deux, la tête dans les chaussettes en bordure de Montevideo. Whisky n’est pourtant pas un film à boire, ni à dire tant les corps restent muets, sanglés dans un quotidien mis à nu avec brio par deux jeunes réalisateurs Uruguayens. Minimaliste et féroce.Il ne dit rien. Ce n’est pas qu’il se venge, mais il ne parle pas. Sans questions, ni pour lui, ni pour les autres, avec le minimum à vivre, au dedans comme dehors, il ne dit juste rien. Jacobo Köller dirige près de Montevideo, Uruguay, une petite usine de chaussettes de quatre employées, dont Marta, la plus fidèle, l’attend chaque matin devant la grille de la fabrique. Elle n’en aura sans doute jamais la clef, bien qu’elle consigne chaque jour le départ, l’arrivée des autres employées - une femme-fonction, elle non plus ne dit rien. D’ailleurs personne ne parle vraiment dans Whisky, personne ne boit non plus. Le film s’ouvre dans l’intérieur noir d’une voiture, puis d’un café, où, demandant plus de lumière, Jacobo, au lieu d’ouvrir les stores de bois pour y laisser entrer le jour, regarde le patron monter sur un tabouret pour éclairer un néon. Voilà Whisky. Un film dont la boucle s’opère et se clôt par de lents mouvements de corps, un film d’où perce une lumière minimale, des dialogues minimaux, dans un temps ralenti qui traverse les lieux jusqu’à lentement nous serrer dans son étreinte et nous fondre dans ses personnages.
Une femme, en quelque sorte.
Ce jour-là, en écho à la scène du café qui ouvre le filme, Jacobo ne parvient pas à ouvrir le store de son bureau lorsque Marta lui apporte son thé. La lumière ne passe pas, les paroles, les regards, rien ne passe. Un homme et une femme qui se frôlent dans cette petite usine depuis vingt ans peut-être, à l’existence réglée comme une machine. Chaque jour la cadence identique se referme sur elle-même. Il vient d’enterrer sa mère et attend l’arrivée de son frère Herman du Brésil pour inhumer les cendres. Un fier haï, jalousé depuis l’enfance. Le regard fuit, la langue se plie, raide comme carton, lorsqu’il demande à Marta de l’aider quelques jours chez lui, être sa femme, en quelque sorte, le temps de la visite de son frère. Absolumente. Une femme, n’est-ce pas cela en quelque sorte - ménage, repas, photos, sourires. Marta comprend, mais son regard se transforme. Elle ne dit rien, mais comme une vie souterraine la parcourt. On ne devient pas au hasard la femme de quelqu’un, ne serait-ce que quelques jours.
Répétition, la mort à l’uvre.
A cette vie ritualisée des personnages - l’entrée par la grille d’atelier, l’allumage des néons, des machines, le détour au vestiaire, le thé sur le bureau, correspond la rigueur de la mise en scène : très peu de mouvement, un cadre fixe, sans effet : géométrie austère, lumière froide, minimalisme oblige. Des premières machines qui apparaissent à l’écran, une sorte d’enfileuse de chaussettes à l’armature métallique plantée vers le ciel qui épouse la forme du pied mais aussi celle d’une potence, et se duplique en série au milieu de l’atelier. Une mort à l’uvre donc, celle des corps et des mots. L’histoire des frères Köller, tous deux chaussetiers de leur état, peut sembler trop écrite, tant le rapport symétrique les sépare d’entrée : l’un quitte son Uruguay natal et réussit sa carrière au Brésil, se marie, fait des enfants, l’autre reste vieux garçon frustré jusqu’au bout des ongles, se contentant de faire survivre la fabrique familiale. Le contraste n’est pas assez net ? Disons qu’il vit et soigne sa mère malade jusqu’à la mort de cette dernière. Que faire des cendres d’un mort ? On comprend vite, moins de celles de la mère, qu’il s’agit bien de celles du fils. Une vie de mort dont le film s’habille comme d’un vague suspens métaphysique : mourra, mourra pas ? ou plus précisément aimera, aimera pas ? si tant est que vivre soit simplement histoire d’aimer.
Jacobo ne s’aime pas, Jacobo n’aime personne. La solitude, c’est aussi, et peut-être surtout l’orgueil, qui permet de tenir, survivre à l’identique, ne pas sombrer. D’où cette idée du faux mariage, dont Jacobo a l’idée pour apparaître moins diminué face à son frère Herman, pour éviter ses questions et la gêne d’avoir à y répondre. Cette idée du faire semblant à l’intérieur du film, discrète abyme sur le processus même du cinéma, qui fait semblant dans la fiction pour mieux montrer le réel, s’affine dans les détails : fausse vraie alliance qu’emprunte la femme vivante à la morte, fausse photo de mariage, fausse complicité créant du coup un vrai comique minimaliste.
La femme d’à côté, possible amante le temps d’une bague dans une piscine.
Les retrouvailles au cinéma : toujours un prétexte de scénario pour confronter le présent au passé et jouer du décalage introduit pour en faire naître du comique ou du drame. Ici, toute la rivalité d’une enfance transparaît en quelques plans. Mais derrière ces deux frères que tout sépare sinon le fait de posséder une usine de chaussettes, l’important est cette femme qui leur sert de lien. Passons sur la mère, qui vient de mourir pour se concentrer sur l’autre, la possible amante. La femme d’à côté, la captive, désert ou pas ; c’est toujours celle que l’on n’aime pas encore mais qu’on pourrait aimer qui nous fascine au cinéma.
Marta remplit son rôle de presque-épouse et sert d’entre-deux aux vivants et aux morts : elle nettoie, cuisine, range, mais elle se coiffe aussi, se maquille, s’habille autrement. Et lorsqu’elle fume devant la mer, ce n’est plus l’ouvrière mais la femme que l’on voit - le rêve d’une autre vie sous ses yeux. Tout le film tient sur cet amour possible entre Marta et Jacobo, qui se déplace lentement, par petites touches, sur un amour possible entre elle et Herman. Ce glissement de l’un à l’autre, très finement mis en scène par les réalisateurs urugayens se cristallise dans la scène de la piscine de l’hôtel, où Marta perd dans l’eau sa fausse alliance. L’espoir noyé d’une relation entre elle et Jacobo se transforme en miroir avec celui d’Herman. On retrouve là cette progression dans la lenteur, l’effet de réel qui en découle, et ce qui fait une des principales réussites du film, cette manière très simple de dilater l’espace et le temps. Comme lorsque la caméra filme Marta en temps réel, sans coupe, traverser de dos le couloir qui sépare sa chambre de celle d’Herman. Elle devient alors la seule véritable héroïne du film, celle qui se défait, se transforme, cherche sa liberté.
Le charme du vide : esthétique de lisière.
A travers les mouvements de Marta dans le monde étriqué de Piriapolis, Stoll et Rebella filment un univers à l’agonie qui semble attendre son coup de grâce. L’hôtel au charme décrépi, son karaoké, sa piscine, son casino, presque tout dans le film rend avec justesse ce parfum suranné des stations balnéaires d’institution où l’on suit de couloirs en chambres, puis de pièce en pièce l’absence, la morne conservation du peu de vie qui subsiste à ces lieux, aux personnages qui les traversent. On retrouve cet aspect désuet d’un temps arrêté le jour où la mère mourut - tapisseries, meubles, bibelots, trace des cadres sur les murs, tout ce kitsh passéiste dont Good Bye Lenin s’est fait le chantre, et qu’on retrouve ici sans la nostalgie du film est-allemand. C’est un appartement laissé à l’abandon d’un type à moitié muet dont le visage semble vissé de l’intérieur dans une rancune tenace. Marta s’habille, se coiffe et se maquille comme au premier bal, en vain. Elle reste pour Jacobo aussi transparente qu’au premier jour. Rien ne bouge, que par d’infimes tropismes, et l’on retrouve chez Rebella et Stoll cette esthétique de la lisière où le commun, la chair triste gagnent en beauté plastique ce qu’ils perdent en rugueux de l’humain, de sa résistance.
Scénario coupé au rasoir, temporalité admirable.
Pablo Rebella et Pablo Stoll, en maîtrisant leur scénario dans chaque détail, font preuve d’une efficacité implacable. Ils parviennent à triturer le temps d’une vie, le dilater par endroit en recourant à l’ellipse, pour mieux le concentrer ensuite. Ils créent ainsi un film dont la simplicité résulte en réalité d’un travail très complexe, tant sur la temporalité, les décors, que les personnages, à l’exemple de cette partie de Dynamo Hockey et cette salle de miroirs où toute la rivalité, la jalousie du gamin qu’est resté Jacobo et la position médiane de Marta se trouvent cristallisés.
Les deux cinéastes affleurant la trentaine filment avec justesse ce trio de quinquas pris dans une impossible histoire d’amour. Leur écriture, leur mise en scène minimalistes, la place faite au non-dit, au silence, donnent au film son humour rare et précieux, son intelligence. Pourtant, l’on ne peut se départir d’une certaine frustration à la sortie de la salle : on voudrait plus. Bien que cela fasse partie du contrat - minimalisme oblige -, et malgré les derniers soubresauts du final, les personnages semblent bel et bien pris. L’enfermement de Jacobo, parce qu’il est total, sans appel, nous renvoie en miroir cette question du refus, de l’énigme de celui qui répond « Je ne veux rien, laissez-moi ». Un corps définitivement mort. Une opacité qui dérange, en écho à l’absurdité du quotidien, qui dès lors qu’elle nous est montrée avec autant d’empathie, place le cinéma dans son rôle de miroir, nous reflétant au fond d’un verre, à la surface d’une toile tendue.
Stéphane Mas
Articles récents
La forêt de Mogari - Naomi Kawase
Alexandra - Alexandre Sokourov
Paranoid Park - Gus Van Sant
4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007)
Control - Anton Corbijn (Prix Label Europa Cinéma à la Quinzaine)
Garage - Lenny Abrahamson (Prix Art et Essai à la Quinzaine)
Festival de Cannes - Bilan du 60ème (part one)
© 2005-2007 peauneuve.net - plan du site - liens - - haut de page