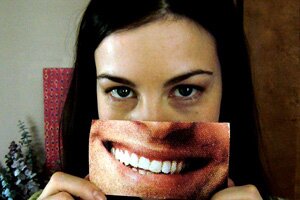Lonesome Jim - Steve BuscemiI’m wide awake, it’s morning
Quel bilan tirer de votre vie lorsque, la trentaine sonnée, après avoir écumé les petits boulots alimentaires à New York, vous échouez dans le home sweet home au fin fond de l’Indiana, affublé d’un frère suicidaire - vous luttez vous-même contre une dépression récalcitrante -, un père despotique et une mère encombrante ? On frise le zéro pointé plus d’une fois chez les personnages de Steve Buscemi. Mais, miracle à la petite semaine, l’amour pointe le bout de son nez, l’équipe de basket rentre enfin un panier et votre frère se remet au polar d’enfance. Avec en filigrane une histoire de drogue improbable, Lonesome Jim dépeint avec bonhomie et bonheur les trajectoires retorses d’une ribambelle d’Américains hors cadre, préposés irrécupérables et terriblement attachants. Welcome back, Jim.Kilomètre zéro
Un film rare. Rare, simple et juste. Peu de réalisateurs savent encore témoigner de cette Amérique profonde-là, exemptée des clichés racoleurs d’usage. C’est par une course sur fond de bitume trouble que débute le nouvel essai de Steve Buscemi. Jim/Casey Affleck, s’essoufle dans un sprint peu convaincu, fuyant un passé en forme de semi-échec. Revenu patraque de New York où il exerçait en tant que promeneur de chiens, c’est un retour à la case départ. Les poches vides et le moral en berne, désespoir chronique, c’est dans la maison familiale qu’il échoue fatalement. En quelques plans au cordeau défilent l’Indiana et la bourgade tranquille où le trentenaire revenant pose ses guêtres et son regard de chien battu.
Les lumières (blafardes) de la ville
Les rues sont quasi désertes, les cohortes de distributeurs de boissons et les bars vides comme autant d’indicateurs géographiques intemporels. Jamais très loin d’un regard frontal à la Walker Evans, Steve Buscemi filme sobrement la ville et ses quelques habitants qui hantent les dinners. Le cadre n’est pas des plus accueillants pour qui débarque avec une vie à (re)construire. Une Amérique sans histoire, middle class, pétrie de solitudes à noyer dans les néons de bars fantomatiques, comme un écho aux peintures d’Edward Hopper.
C’est dans les déambulations d’un Jim à la recherche de lui-même, au volant du van familial ou arpentant les trottoirs glacials, que Steve Buscemi livre un portrait tout en nuances et profondément réaliste d’une ville où seuls les panneaux de signalisation et les enseignes de bars semblent faire office de signes de vie. Espaces désincarnés, balisés par répétition du semblable, Jim doit écumer le Ricky 1, 2 et 3 pour échapper à la solitude ou à l’hostilité ambiante. Comme pour mieux prévenir toute sortie de route inopinée.
Mainstream America : de la convention à la marge
Amérique des villes, Amérique des champs, Amérique des conventions sociales et familiales. Les parents de Jim, après avoir fondé la petite entreprise familiale à l’âge de 20 ans, coulent une existence paisible dans une banlieue résidentielle ouatée. Si loin, si proche, l’oncle, employé dans la même usine, vivote dans une autre dimension. Celle des reclus, des aspirants à l’exclusion qui, malgré l’emploi, se terrent dans des trailers parks disséminés ça et là au milieu de nulle part. Mais l’oncle est aussi un collectionneur de crânes d’animaux. Son rêve ? Acquérir un crâne humain qu’on lui propose dans le sud du pays.
Accessoirement, il s’adonne frénétiquement à la fumette, s’offre une pute de temps en temps - parce qu’elles "coûtent moins cher qu’une copine" - et bricole des trafics en tout genre à l’usine. Le registre n’est pas au pathos ou au brûlot social, mais bien plutôt à l’humour vachard et tendre. Une typologie en bonne et due forme d’un certain Homo Americanus.Ici plus qu’ailleurs, les lieux agissent comme autant de marqueurs sociologiques indélébiles. Mais Buscemi parvient à leur conférer une touche empreinte d’humanité et d’empathie par le biais d’une pellicule au grain brut, d’une mise en scène alerte, ponctuée pêle-mêle de clins d’il à Taxi Driver, Macadam Cowboy ou Twin Peaks.
De la révolte sous Tranxène : Portrait en oblique d’un kidult démissionnaire
Jim, de son côté, accuse le coup. Si la transition New York - Indiana est brutale, il ne semble pas plus enchanté d’avoir à cohabiter avec parents, frère et nièces. Coincé entre un père mal dégrossi et fruste, un frère éjecté de la police locale, père de deux filles mutiques, et une mère possessive, il trimballe son apathie et ses ambitions d’écrivain comme le boulet d’un destin qui vous écrase. Mais les perdants chers à Buscemi ont ceci de particulier qu’ils s’avèrent réjouissants. Leur histoire semble tracée, gravée dans le marbre tant leur passif familial, social et géographique est chargé. Les seules armes dont ils disposent, Jim en tête, sont l’humour à froid, tout proche du Big Lebowski, l’autodérision, et surtout une sensibilité à cur ouvert.
Une sensibilité étrangère à tout ce que Jim retrouve dans l’Indiana. Si le père exhorte son fils à choisir un avenir, qui transite implacablement par l’usine familiale, celui-ci choisit l’aboulie et la fuite en guise de refus aux sacro-saintes valeurs ambiantes : non à l’abrutissement grande échelle à la chaîne, non aux retrouvailles cordialement feintes en famille et, hérésie ultime, Jim, en guise de confession intime au coin d’un bar, avoue à Anika, infirmière du cur, qu’il n’a jamais aimé sa famille, que tout ce qui lui est lié a l’odeur de l’échec et de la frustration. Looser lucide sur le papier, il ne s’encombre pas, par ses dérobades et ses maladresses d’éternel adolescent, de faux semblants.
Sirop d’érable vs gueule de bois
Mais Buscemi ne se contente pas de dresser un portrait constamment drôle et acerbe du microcosme familial. Sa force est de jeter des passerelles inattendues, comme pour mieux montrer que tous ces personnages ne peuvent se réduire à une caricature démagogique.
Au-delà des fonctionnements quotidiens où la mère s’évertue à éteindre toute amorce de conflit ou de désaccord par l’harmonie retrouvée autour du repas, les masques tombent. Le réel fait brusquement irruption dans la bouche de la mère s’interrogeant sur les raisons d’avoir mis au monde des enfants aussi malheureux. La réponse de Jim n’en est pas moins cinglante.
Dégel en Indiana
Si ces personnages sont croqués avec autant de bonhomie, c’est sans doute que le réalisateur surfe avec aisance entre les écueils du cynisme sclérosant et de l’humour potache. Conscient du chemin qu’il reste à parcourir, chacun des personnages amorce un bout de chemin vers la reconstruction par le biais d’un scénario inventif à souhait. Jim le premier, au fil de ses déambulations nocturnes, s’acoquine avec Anika/Liv Tyler, gironde à réveiller un eunuque, infirmière de son état, ambulance idéale pour mettre sous perfusion un anti-héros en pleine léthargie.
Si celui-ci traîne sa mélancolie admirative au fil de portraits d’écrivains dessoudés, Woolf, Poe, Pound, Anika accroche un sourire à la face endeuillée d’Hemingway. Entre parties de baise vite expédiées et confessions sur l’oreiller, une esquisse de relation amoureuse point. Pourquoi la thématique de la seconde chance serait-elle l’apanage des puritains zélés ?
Comédie romantique underground
Il y a une naïveté assumée, une candeur intrinsèque à chaque personnage que Buscemi imagine, excepté l’oncle/Evil le bien nommé, qui redonne du baume au cur du spectateur. Et à celui des protagonistes cabossés par les désillusions, la routine et la perspective d’un avenir en pointillé. Il s’agit d’une transcendance à la petite semaine, faite de rencontres improbables, une fille pour Jim, un roman policier d’enfance pour son frère Tim et ses filles, une lettre ouverte pour les parents.
Buscemi nous réconcilie finalement avec une certaine Amérique rongée par l’incertitude. Un film en forme de cure de jouvence, qui devrait être remboursé par la Sécu contre toute tentative de déprime hivernale. A regarder avec un double whisky dans un bar colonisé par des infirmières en tenue et un disque de Chicago.
Guillaume Bozonnet
Articles récents
La forêt de Mogari - Naomi Kawase
Alexandra - Alexandre Sokourov
Paranoid Park - Gus Van Sant
4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu (Palme d’Or 2007)
Control - Anton Corbijn (Prix Label Europa Cinéma à la Quinzaine)
Garage - Lenny Abrahamson (Prix Art et Essai à la Quinzaine)
Festival de Cannes - Bilan du 60ème (part one)
© 2005-2007 peauneuve.net - plan du site - liens - - haut de page